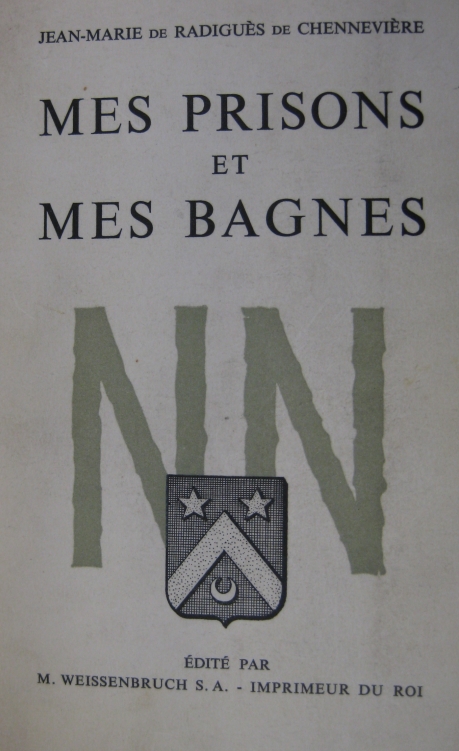|
|
|
Mes prisons et mes
bagnes, |
|
TABLE DES MATIÈRES |
|
PREMIERE PARTIE : A SAINT-GILLES I. - Au secret DEUXIEME PARTIE : AUX BAGNES I. - Posen TROISIEME PARTIE : LE RETOUR Quelques réflexions |
|
... I. - Posen ....
II La portière roule sur ses coulisses. Un coup de sifflet, le train part. Dans le fourgon, la résonance amplifie jusqu'à un tintamarre assourdissant les grincements des roues et des butoir., les bruit, de tôle du châssis. Debouts, écrasés les uns contre les autres, nous sommes dans l'impossibilité de nous asseoir. Nous formons, tous ensemble, une masse compacte que les courbes de la voie, les coups de frein, les arrêts brusques jettent contre les parois. Les prisonniers, que le hasard a placés au bord de cette masse sont, à chaque mouvement, presque écrasés. Leur colère, leurs jurons, leurs cris de douleur n'y peuvent rien changer. Puis le tapage éreintant du roulement du wagon reprend comme une dominante infernale. Les prisonniers deviennent silencieux. Leur silence morne, passif, n'est plus troublé de temps à autres que par une plainte, quelques cris, des gémissements. Nous sommes dans une obscurité de cave. Par des fissures entre des planches disjointes de minces raies de lumière s'arrêtent sur des visages épouvantés. A hauteur du plafond, une ouverture de ventilation laisse filtrer un peu d'air. Mais, douloureusement compressés, nous passons successivement de la sueur à l'étouffement, à une sorte de fièvre dans une atmosphère pestilentielle d'haleine, de transpiration, de flatuosités. L'absence de récipient aggrave encore la situation. Comme par un réflexe nerveux, tous à la fois nous nous sentons pris de besoins pressants. Après quoi, nous tentons de couvrir de débris de pailles les excréments. Mais ces horreurs s'agglutinent aux chaussures, se plaquent à nos vêtements. Un prisonnier a ramassé, dans le wagon une bouteille et la passe à ceux qui l'entourent, seul moyen d'éviter d'être trempé par l'urine de ses voisins. Toujours enchaînés deux à deux, bras serrés contre le corps, poitrine contre poitrine, nos corps souffrent de tous côtés à la fois. Picotements des pieds, crampes dans les jambes, douleurs des reins, maux de tête, démangeaisons... Je cherche un changement de position permettant une détente à mes nerfs exaspérés. Je lève un instant le pied; involontairement, j'enfonce mon genou dans le ventre d'un faubourien excédé. Il riposte, parvenant à me donner un coup de coude dans le visage : N... d... D... Tu me les casses ! Les souffrances de notre masse augmentent toujours. Cris, blasphèmes... Un corps flasque s'effondre lourdement sur les poignets liés de deux prisonniers. Dans une bousculade abominable, l'un fait des efforts surhumains pour se dégager tandis que, poignet tordu, le compagnon de chaîne de l'homme tombé hurle comme un damné. Un malade vomit sur ses voisins. Derrière moi, j'entends comme des pleurs saccadés d'enfant. En tournant la tête, j'aperçois la calvitie et le dos voûté d'un vieillard. La somme des souffrances qui nous torturent semble ne pouvoir mener qu'à la folie ou à la mort. Une seule pensée tourne à la hantise. Sortirons-nous vivants de ce fourgon ? Mon poignet droit est attaché au poignet gauche d'un jeune homme efflanqué, à la figure maigre. Ses grands yeux tristes, malgré leur enfoncement dans les orbites, prennent une place démesurée dans son visage tiré. Ses mouvements nerveux, ses tics me font redouter une crise. Est-il fou ou malade ? Pendant que je le surveille du regard, ses yeux rencontrent les miens. Il se met alors à parler avec volubilité dans un langage à peine compréhensible, mélange de français, d'allemand, de polonais. Les quelques mots dont je perçois le sens suffisent pour me faire deviner une douleur immense : avant la guerre, il était professeur d'université et médecin. Sa femme est morte dans le bombardement de Varsovie. Sa mère et ses enfants aussi. Sa maison et tous ses biens ont été incendiés. Il n'a pu se résoudre à accepter les Allemands vainqueurs. Ceux-ci l'on condamné à mort.. Maintenant, douloureux, mais sans haine, il considère ses bourreaux comme les instruments de la fatalité! - L'Allemand, dit-il, pas encore civilié. De temps à autres, le train s'arrête. Sommes nous en gare? en rase campagne? Malgré nos efforts, nous ne pouvons comprendre ou deviner ce qui se passe au dehors. Les arrêts prolongés retardant l'arrivée à l'étape, terme de notre supplice, nous exaspèrent. Les cerveaux s'échauffent. De violentes colères se déchaînent avec d'ordurières grossièretés. Un parisien élargit, avec un couteau, la brèche d'une des cloisons. Un prisonnier - un gendarme français - craint le représailles des allemands, veut l'empêcher. La réaction est brutale: - Ta gueule, vieux grognard ! Moulin à cacas ! Le train repart, s'arrête, continue à nouveau. Après un temps que je n'ai pu mesurer, un coup de frein fait s'entre-choquer les wagons. Le convoi s'immobilise... Quelques instants après, la portière est ouverte. Nous sommes à Kreuz. Des S. S. furieux, aboyant, nous ordonnent de descendre. Toujours liés deux à deux par les poignets, nous devons sauter simultanément avec notre compagnon de chaîne sur le ballast et courir nous ranger le long d'une voie. Sautant avec mon compagnon, je me relève aussitôt, échappant ainsi aux coups de crosses, de matraques qui pleuvent sur les vieillards, les malades étourdis par la chute et qui ne peuvent se remettre debout assez vite. Peu à peu, le fourgon se vide. Des S.S. y entrent, gueulant sans arrêt. L'un d'eux, avec des hurlements de brute, commence l'appel. Je m'efforce de garder mon sang-froid cherchant à dominer une révolte de dégoût qui me torture. Dans le fourgon, un homme demeure étendu, le visage dans la paille, un autre est emporté sur une civière. Un S. S. culbute sur la voie de chemin de fer, un cadavre... C'est atroce. Trois compagnons viennent de mourir dans l'horrible entassement, les cris, le bruit infernal de notre "transport". Ma pensée ne peut se détacher de mes camerades morts. Je cherche un écho à ma peine, à mon indignation, mais tous les prisonniers paraissent apathiques, engourdis. Et je ne parviens pas à comprendre que des hommes puissent être épuisés jusqu'a perdre leur sensibilité, jusqu'à devenir d'une indifférence totale pour autrui. Sont-ils tous devenus fous ? ou trop de souffrances les ont-ils usés presque complètement ? Mon camarade polonais se signe au passage de la civière. Son geste me fait penser à prier... De nos rangs, une vingtaine d'hommes dont mon compagnon, le Polonais, sont désignés pour une prison de la région. Moi, au contraire, je dois continuer le voyage. Un S. S. me détache du médecin. Adieux rapides. Nous sommes tous deux navrés et profondément émus de nous quitter. Les perspectives du nouveau transport semblent meilleures. Le fourgon a été nettoyé. Nous sommes soixante au lieu de quatre-vingts prisonniers. Je n'ai plus de menottes. Brève illusion ! Un troupeau de prisonniers se range auprès de nous. Nous montons dans le fourgon. Deux des morts y sont hissés. Les cadavres aussi doivent arriver à la destination inscrite sur leur ordre de transport. Le train part. Le fourgon, d'aspect banal, glisse à travers le paysage, cachant sa charge de morts et de mourants. L'atroce voyage reprend usant nos dernières forces, exacerbant nos souffrances. Nous sombrons dans une épouvantable angoisse. Je me sens perdu. Je murmure presque machinalement de courtes prières, des appels confus, désespérés... Lors d'un arrêt, un prisonnier entend crier « Landsberg ». La portière s'ouvre. Un détachement de la Wehrmacht attend. Des prisonniers descendent à l'appel de leur nom. Quand le train se remet en marche, l'air vicié du fourgon a pu se renouveler par la portière un moment ouverte, nous disposons d'un peu plus de place, nous nous apaisons un peu. A partir de Landsberg, les arrêts se multiplient. Enfin, à Custrin, j'entends crier mon nom. Je saute du fourgon en clignant des yeux. L'air vif au dehors, après tant d'heures dans le wagon fermé, me saisit. Nous sommes douze : deux camarades de la chambrée de Posen et Jean Sterkmans, mon compagnon de voyage de Bruxelles. Des Schupos coiffés de casques à pointes mènent notre groupe sur une voie en contre-bas. Quelques wagons y stationnent. Cette fois, nous entrons dans un compartiment de troisième classe, heureux de pouvoir nous asseoir sur une banquette. J'essaye de me distraire en regardant les manoeuvres d'une locomotive préhistorique chauffée au bois. Je grelotte des pieds à la tête; j'ai faim. Mon voisin, persuadé que j'ai du tabac, demande, insiste, me conjurant de lui en donner rien qu'une pincée. Pour le convaincre, je me lève et retourne la doublure de chaque poche. Devant moi, un prisonnier d'une vingtaine d'années, gratte obstinément le givre de la vitre, faisant semblant de regarder par la fenêtre pour cacher ses larmes. Je pense à ses parents. Mes deux fils sont de son âge... J'aimerais tant de le réconforter, mais il ne comprend pas un mot de ce que je lui dis. Il est Norvégien et ne connaît que sa langue. Après un tamponnement, la locomotive entraîne le convoi. Je regarde le paysage que nous traversons : sapinières, plaines neigeuses, marais qui s'estompent peu à peu dans l'obscurité tombante. Nous devons descendre du train en gare de Sonnenburg. Alors, encadrés de Schupos, nous suivons une route bordée de grands ormes. Comme chez nous, beaucoup de ces arbres, atteints de maladie, ont perdu leur écorce... II fait presque noir maintenant. Rien ne me permet de situer l'endroit où nous nous trouvons : une grand-route bordée d'arbres et de fossés comme tant d'autres. Dans le ciel, je reconnais les étoiles que, de ma paillasse à Saint-Gilles, je pouvais voir par la lucarne. Nous atteignons puis traversons le village. La promenade me fait du bien; je reprends courage... A la sortie de Sonnenburg, nos gardiens nous dirigent vers un grand bâtiment. Son portail encadré de deux tilleuls majestueux semble mysterieux et paisible comme l'entrée d'un vieux monastère. Un Schupo de l'escorte tire la corde de la cloche. Un portillon, découpé dans la grande porte cochère, s'ouvre. Nous sommes attendus. Après l'appel, un gardien me conduit au troisième étage devant la chambre IV. Tandis que j'attends devant la porte fermée, tout à coup un bruit de foule en mouvement se répand dans le bâtiment. Montant et descendant les escaliers par les corridors de droite et de gauche arrivent des hommes habillés d'une veste de toile et d'un pantalon de couleur foncée à liserés. Un petit calot sur la tête, ils marchent nu-pieds, les sabots à la main. Ils sont maigres, sales, pas rasés et sentent mauvais. Ce sont les prisonniers politiques devenus forçats qui sortent des ateliers et regagnent leur chambrée. Le soir même, nous sommes des amis.
SONNENBURG Les travaux forcés LA PRISON Sonnenburg, aux confins d'une forêt de sapins et d'un grand lac, à une quinzaine de kilomètres de Custrin, est, en temps de paix, un des rendez-vous des Berlinois. Les bâtiments hideux de la prison, édifiés à l'écart, échappent aux regards des passants. Construite en 1869, ses gardiens nous ont rappelé à tout propos que les premiers hôtes avaient été les soldats de Napoléon III emmenés en captivité après Sedan. De ma chambrée du troisième étage, je dominais une partie du chemin de ronde entre la double enceinte des murs. Des sentinelles de la Wehrmacht et des S. S. y veillaient, préférant sans doute la monotonie de cette garde aux plaines glaciales de Russie. La prison comportait une exploitation agricole qui s'étendait au delà des murs. Des forçats allemands y travaillaient suivis de gardiens armés. Les charrues passaient lentement dans des terres sablonneuses parsemées de silos où étaient enfouis les pommes de terre et les rutabagas, réserves de la prison. Nous le savions, et par les fenêtres grillagées, des centaines de prisonniers politiques regardaient souvent avec envie ces amas de nourriture. Au delà des champs, des saules suivaient dans la plaine les méandres de la Warthe. Marais, lacs, se confondaient dans le lointain avec le ciel incolore et triste qu'animaient parfois des vols de canards, d'oies, de cygnes sauvages. Les bâtiments, les chambrées, cellules, ateliers, cuisine, infirmerie étaient vétustés et malpropres. Les marches d'escaliers étaient usé par les pas traînants de plusieurs générations de forçats- les plan' chers noueux, raboteux; les dallages déchaussés, les murs décrépis servaient de nids aux parasites. La prison de Sonnenburg n'était pas dotée de guillotine, de fours crématoires, de chambre à gaz. « Ici, m'avait dit un copain, les Allemands n'exécutent pas. Nous sommes aux travaux forcés. On se contente de nous tuer à la besogne A toi à te défendre. » Nous vivions dans l'ambiance d'une vaste manufacture dont la main-d'œuvre était uniquement composée de prisonniers. Jadis, les détenus de Sonnenburg pouvaient effectuer un travail en rapport avec leurs aptitudes. Au-dessus des portes se lisaient encore des noms de métiers dont l'apprentissage me tentait: horloger, relieur, graveur. Mais les inscriptions étaient des souvenirs de paix. La guerre avait transformé la prison en une grande usine où plus de mille travailleurs se relayaient jour et nuit. Des contremaîtres qualifiés, venus de l'extérieur, dirigeaient le travail pour compte de sociétés privées. Les « Kapos », forçats comme nous, sorte de volontaires du travail, collaboraient avec les contremaîtres dans l'organisation et l'exécution du travail. Les gardiens s'occupaient du bon ordre. Certains prisonniers clivaient du mica pour compte de la société A. E. G. D'autres, au service d'une manufacture de ruches et d'extracteurs de miel, ayant conservé sa pacifique raison sociale, fabriquaient, en série, des « détonateurs ». Des vanniers tressaient des paniers en osier pouvant contenir deux obus de 77. Les entreprises de récupération absorbaient une main-d'œuvre importante. Des forçats déchiquetaient des uniformes pour en récolter les boutons, les boucles, les agrafes, les morceaux de toile ou de cuir. D'autres rassemblaient des bouts de ficelle, raccommodaient des chaussettes. Des tailleurs remettaient des uniformes de bagnard en état, des cordonniers faisaient de même pour les chaussures. Enfin, la maison comportait une équipe de cuisiniers et de lessiveurs . Quelques prisonniers faisaient, en une certaine manière, du travail à domicile. Ils restaient enfermés suls à longuer de journée, comme au secret, tressant du rotin et du raphia destiné aux empeignes pour chaussures à semelles de bois. Les portes de leur cellule ne s'ouvaraient qu'à l'heure des repas et de la promenade ou pour recevoir et livrer le travail. Le rendement des forçats était fixé par un règlement verbal qualifiè de pensum, imposant une production journalière; toute insuffisance étant santionnée par une privation de nourriture. L'ouvrier métallurgiste très recherché était mis aux machines pour tourner des obus, des vis de culasse, des pièces de fusée. Les anciens marins étaient envoyés de préférence à la câblerie pour épisser des câbles d'acier destinés aux sous-marins. Les menuisiers, enfin, par suite des circonstances, se spécialisaient dans les cercueils dont la fabrication en série restait insuffisante, en présence du nombre de morts. Les prisonniers, nouveaux arrivés, étaient d'abord envoyés à la « Bindfaden » au travail à la ficelle. J'ai fait mes débuts de forçat dans cet atelier. Il se trouvait sous les combles. Trois lucarnes l'éclairaient. Quand il y avait du soleil, trois blocs lumineux où dansait la poussière, coupaient des tranches nettes dans la grisaille du grenier. Par temps couvert, les lampes électriques dissipaient à peine le brouillard poussiéreux dans lequel nous devions travailler. En été, la chaleur devait être torride mais à mon arrivée, au cours de l'arrière-saison, le froid me faisait claquer des dents. Un grand poêle consumait en peu de temps les rares pelletées de charbon allouées quotidiennement à notre atelier. Après quoi, nous n'avions d'autre ressource que de profiter du moment où le gardien tournait le dos pour enfourner dans le poêle le contenu entier des sacs de ficelle à trier. Le feu ronflait alors comme un haut fourneau et le tuyau de la cheminée, passant au rouge vif, menaçait de mettre le feu à la « boutique ». L'administration de la prison mettait à la disposition de ces cent forçats de l'atelier de la ficelle, cinq à six tabourets, trois à quatre bancs, une table. Nous nous installions où nous pouvions, sur des sacs à ficelle, sur des caisses ou sur le plancher. L'outillage se composait de paires de ciseaux qui avaient une singulière tendance à disparâitre et de morceaux de bois pour enrouller les ficelles. Toutes espèces de cordes, câbles, raphias, ficelles, lacets, cordons récupérés par suite des ordonnances sur l'économie de guerre, arrivaient dans de grands sacs postaux à la prison. Un premier tri séparait les matières fibreuses utilisables dans les filatures. Dans mon atelier, nous ne manipulions que les ficelles et les cordes de papier II nous fallait les relier bout à bout, d'après leur grosseur et après quoi, les rouler en boules d'un kilo. Au milieu de ce travail, je prélevais mon butin sur certaines cordes épaisses que je découpais en morceaux de dix centimètres Chaque fragment de toron, déroulé et aplati formait un petit rectangle convenant parfaitement comme papier hygiénique, chose rarissime que les Allemands nous refusaient systématiquement. J'en bourrais mes poches et le soir, à la sortie de l'atelier, je subissais l'assaut des camarades qui les répartissaient dans leurs chambrées. Il ne manquait même pas de trafiquants pour les échanger contre de la nourriture. Les gardiens ne s'occupaient guère de nous. L'essentiel était d'avoir l'air de travailler. * * * Fréquemment, l'inspecteur du travail venait prélever, chez nous, de la main-d'œuvre pour d'autres ateliers : — Qui veut apprendre le métier de tourneur ? de bourrelier ? Que savez-vous faire ? L'aveu d'une profession libérale ou administrative le mettait en fureur : — Taugenichts ! Ce n'est pas ici que vous vivrez de la sueur du peuple et que vous engraisserez de son travail... Je vous apprendrai à travailler... Heraus ! (hors d'ici !). Je fus ainsi jeté à la porte des « ficelles » et envoyé chez les tailleurs où je trouvai une installation sensiblement meilleure. L'atelier destiné, théoriquement, à la confection des vêtements des bagnards, était situé au premier étage, dans un local aéré et bien éclairé, propre et calme. Le poêle consumait, en un jour, une quantité de charbon égale à celle de plusieurs autres ateliers réunis. Une douzaine d'ouvriers, les uns aux machines, les autres assis à la turque, cousaient. Ici, le chef d'atelier était un prisonnier comme nous. Maître-tailleur à Oslo, il avait fait partie d'une équipe de marins qui avaient tenté de s'emparer d'un navire allemand pour gagner l'Angleterre. Des mannequins en bois, revêtus d'uniformes militaires, flirtaient parmi nous avec des mannequins d'osier portant des robes, des manteaux, des tailleurs pour dames. Il y avait même un salon d'essayage dans lequel je n'ai pu entrer. Les gardiens utilisaient les "compétences" pour leurs besoins personnels et pour arriver à réaliser quelques profits. Ils venaient nombreux et, à tous propos, faire examiner leurs vêtements par le tailleur norvégien qui, d'une main experte, déplaçait un bouton de veste, enlevait un pli à l'épaule, rendait la silhouette plus élégante... Le chef d'atelier me mit à la main un fer à repasser et m'apprit à faire des plis aux pantalons, à arrondir des revers, rectifier des cols. Sur les vêtements à traiter, je devais, au préalable, poser une loque mouillée. Le contact du fer brûlant en dégageait une vapeur chargée de relents capables de faire chavirer les cœurs les plus endurcis. Hélas ! je ne fis pas un long feu chez les tailleurs. Le lendemain de mon arrivée, un candidat mieux qualifié fut préféré et le Norvégien me congédia sans autre forme de procès. L'inspecteur du travail m'expédia alors à la « chaussette ». Le travail consistait à remettre en état des chaussettes pleines de boue, de sang, puantes, remplies de poux que nous envoyaient en vrac les services de l'armée, les ambulances et les hôpitaux. Le pied encore solide d'une chaussette était cousu à la tige encore bonne d'une autre. Les déchets étaient soigneusement réunis pour l'Office des lainages. Les réparateurs de chaussettes étaient installés, faute de local, dans un coin de l'atelier du mica, déjà surpeuplé. Ils étaient tous âgés; le cadet pouvait avoir quarante ans, le plus âgé, soixante-treize. Parmi eux, un braconnier, condamné à mort pour avoir détenu un fusil de chasse, avait comme idée fixe de tirer des présages du vol es cris, des passages d'oiseaux. Ses observations se limitaient for cernent aux rares oiseaux aperçus dans les parages de la prison. Le corneilles mantelées, les corbeaux, les mésanges à tête noire, notam ent, étaient tous, pour lui, annonciateurs de mort. Nez en l'air pendant les promenades au préau,
il
observait attentivement. Au retour, il avertissait, non sans ménagements,
les camarades menacés du danger imminent révélé par un survol sinistre: La surveillance dans l'atelier de la chaussette était quasi nulle. Les ciseaux, fil, aiguilles servaient aussi à nos travaux personnels. Le jour même de mon arrivée, j'ai déplacé les boutons de ma veste trop flottante, rétréci le fond de ma culotte large comme si j'y dissimulais un sac de pommes de terre. L'entente entre tous était facile et permettait de concilier sans difficulté ceux qui, pour passer le temps, aimaient travailler et ceux qui préféraient s'occuper d'autre chose que de ravaudages et de « stoppages ». Malgré les misères et les tristesses, j'y ai connu bien des joies. Les prisonniers respectaient ce qui semblait démonétisé dans les prisons allemandes : l'honneur, la dignité, la pitié, la prière. Prier pour ceux qui étaient au loin, prier pour ceux qui souffraient autour de nous. Prier, c'est penser aux autres, c'est aimer... Les camarades droits, bons, généreux, attentifs allégeaient le fardeau de l'épreuve. Ils m'ont permis de retrouver l'amitié. J'ai connu là Clément Macq, condamné aux travaux forcés. Sa délicatesse de sentiments, la finesse de son esprit, sa bonté, tout attirait vers lui. Puis vint Paul Le Grand, rimailleur, à longueur de journée, d'alexandrins. Joseph de Ridder, maître d'armes à Anvers, que le Hauptwachtmeister Rosenberg rendait régulièrement responsable des disparitions de chaussettes. L'abbé Vallée, apôtre généreux, ne rêvant que d'offrir sa vie pour ramener ses camarades à Dieu. Guy Morgan, de Saint-Denis. Nous causions, chaussette à la main. Nous faisions même des parties d'échecs. L'échiquier posé sur le banc demeurait invisible pour le surveillant circulant dans le couloir central. Parfois, un missel échappé aux fouilles des Kalfas, des gardiens, des contremaîtres, des Kapos, passait furtivement de mains en mains. Nous nous réunissions à trois pour en lire quelques pages pendant une demi-heure, après quoi le livre devait passer aux suivants. Nous retrouvions avec joie nos pages préférées et, comme dans un rêve, nous lisions, dans saint Matthieu, l'appel à la confiance : "Ne vous inquiétez pas pour votre vie... Regardez les oiseaux du ciel... Considérez le lys..." Nous relisions les huit béatitudes, l'épitre aux Corinthiens: "La charité est patience, pleine de bonté... Elle n'est point envieuse, ne se vante pas... elle soufre tout..." Et quand, malgré nos efforts, la souffrance s'exaspérait en nous, nous trouvions une consolation dans les psaumes appelant le vengeance divine sur les méchant: "Seigneur! Faites retomber le mal sur mes adversaires, anéantissez-les... Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui me maltraitent injustement... Que leurs jours soient abrégés..." Mais nous avions une trop belle part dans la vie de bagnard : les Allemands annoncèrent, un jour, que l'atelier serait supprime. Ils n'avaient peut-être pas tout à fait tort, car les déchets de laine étaient très recherchés par les prisonniers. Ils les transformaient en jambières, chaussons, gilets, doublures pour leurs vêtements de toile. Notre équipe était devenue une sorte de Providence de la prison. Pour satisfaire les demandes de plus en plus nombreuses de nos camarades perclus de rhumatismes et crevant de froid, nous augmentions constamment le volume des déchets, finissant par déchirer les meilleures chaussettes. Chaque lundi, nous recevions trois mille chaussettes. Le samedi, nous remettions notre travail : à peine un millier de paires remises en état. Et la caisse destinée aux déchets qu'officiellement nous ne pouvions utiliser, demeurait régulièrement vide. Le déficit était tel que les Allemands ne pouvaient tarder à s'en apercevoir. Ils firent des enquêtes, nous traitèrent de saboteurs, etc. Mais, dans un atelier constamment désorganisé par la maladie et la mort, où personne n'avait accepté de responsabilité, les absents eurent bon dos. La section de la « chaussette » n'en fut pas moins dissoute et ses ouvriers passèrent à l'atelier du « mica ». Notre sort devint pire. Cent trente prisonniers divisaient des morceaux de mica de la dimension d une écaille d'huître en feuilles a peine palpables et en paillettes. Notre travail était contrôlé. Le soir, le contremaître ou le Kapo relevait le poids du mica non travaillé, des feuilles clivées et des déchets. Le poids total devrait être égal à celui des micas reçus. Chaque forçat devait, au début, fournir quarante grammes de feuilles ou de paillettes, mais les besoins impérieux de l'industrie de guerre amenèrent les Allemand à exiger toujours davantage. Les quarante grammes devinrent quatre-vingts puis cent. Le travail fut de plus en plus épuisant. Pour augmenter le rendement, la firme A.E.G. (Allgemeine Elektrizität Gesellschaft) promit, d'accord avec la direction de la prison, de fortes primes de tabac aux meilleurs travailleurs. Le tabac était absolument interdit à un N.N. qui devait se contenter de cigarettes nauséabondes faites de pelures de pommes de terre séchées, roulées dans du papier de journal. En promettant des cigarettes, l'A.E.G. s'imaginait vaincre la paresse des « saboteurs » eux-mêmes. Malgré cette prime attirante, les prisonniers s'en tinrent au minimum imposé sauf, cependant, un petit groupe de Belges et Français communistes, qui organisèrent un travail à la chaîne au rendement satisfaisant pour les Allemands. Ils furent les seuls à fumer les cigarettes attribuées aux meilleurs collaborateurs de l'A. E. G. La surveillance générale dans l'atelier était irrégulière. La matinée débutait par un tonnerre d'injures et de gros mots; les coups pleuvaient suivis parfois de sanctions arbitraires et idiotes. A midi, les cervaux allemands paraissaient se calmer. Nous étions alors menés à la promenade au préau dans une atmosphère moins surexcitée et sans trop d'incidents. A une heure, les gardiens disparaissaient. A deux heures, la surveillance reprenait mollement. Une douce somnolence l'emportait sur la crainte de l'arrivée toujours possible de l'inspecteur du travail. Le soir, les gradés allemands passaient dans les ateliers et les gardiens faisaient montre d'un beau zèle en criant, hurlant, vociférant. Le travail du mica exigeait un tour de main, de la précision, une vue excellente. Je m'y épuisais et j'aurais subi les pires avanies des contremaîtres et des Kapos sans le concours de mes camarades qui suppléaient à l'insuffisance de ma production. Beaucoup de nos compagnons ne purent résister aux conditions de notre travail. Dans des locaux trop exigus, l'air vicié, empesté par deux tinettes (pour cent dix hommes), rempli d'une poussière dense de mica, ruinait rapidement les poumons et provoquait la tuberculose. L'armée allemande assumait la garde de l'extérieur de la prison et devait, en cas d'émeute, servir de renfort. Dans le chemin de ronde, des chiens bergers couraient en liberté et devenaient mauvais à l'odeur du bagnard. Plus d'une fois, nous avons vu ramener des camarades, cuisses en sang, molets déchiquetés, pour s'être trouvés sur le passage de chiens rôdants dans la prison. La surveillance des prisonniers, l'organisation intérieure étaient la compétence des gardiens Leur hiérarchie très nuancée, wachtmeister, erstwachtmeister, hauptwachtmeister, oberwachtmeister, oberhauptwachtmeister, était marquée par des galons, des épaulettes, des brandebourgs et les différentes armes : fusil, matraque, revolver ou sabre. Les surveillants inférieurs étaient des invalides ou des réformés. Nous étions surveillés au cours de la promenade par un borgne et, à l'atelier, par un boiteux. Ces hommes remplissaient leurs fonctions sans conviction, s'estimant des victimes du régime nazi qui les retenait loin de chez eux. Ils n'avaient pas d'hostilité préconçue à notre égard; parfois même, ils nous montraient quelque sympathie. Ils pleuraient en regardant les photos de leurs enfants. Mais dès qu'un supérieur apparaissait ou se faisait entendre, devenant brusquement méchants, cruels, injustes, ils hurlaient et frappaient. Les gradés étaient des gens de métier, tapant vite et dur, à tort et à travers. Tous de vrais nazis, ils nous haïssaient. Parmi eux, quelques vicieux se postaient dans l'enfoncement des portes, dans les couloirs, à l'heure de la sortie des ateliers et s'en prenaient aux jeunes. Ces gradés étaient accompagnés par une espèce d'ordonnance appelée « Kalfactor », homme de peine chargé de certaines besognes matérielles. Les Kalfactors étaient recrutés parmi les condamnés allemands qu'une amoralité invétérée ne permettait pas de réintégrer dans la Société. Avec des faces de dégénérés, des têtes d'assassins et de brutes, ils étaient gros et gras, arrogants et voleurs. Ils aimaient a parler d'eux, à raconter les charmes d'un passé qui se terminait toujours, a la veille de leur emprisonnement, par un assassinat, un viol ou quelque autre abomination. Arrivés à la fin du récit de de leurs exploits, ils insistaient pour, qu'à notre tour, nous racontions 'notre histoire". Ils n'avaient aucune autorité officielle mais nous injuraient et nous rossaient qans que jamais un surveillant leur fasse une observation. Ils fouillaient les chambrées, retournent coins et recoins, et nous dénoncaient, à tort ou à raison, à qui mieux mieux. Enfin, pour le contrôle du travail, les contremaîtres désignaient certains prisonniers politiques comme « Kapo ». Ceux-ci, chargés de surveiller leurs camarades, n'en devenaient pas toujours meilleurs : un d'entre nous avait dérobé une pincée de tabac dans la blague du contremaître laissée par mégarde sur son banc. Le Kapo vit le geste, vida la blague entière, fit disparaître le tabac volé puis, sans vergogne, accusa notre camarade. Ce fut un scandale. Le contremaître avait perdu tout son tabac-le Kapo accusait; notre camarade niait. Le gardien intervenant, soutenait l'accusation à coups de gifles. Un courageux camarade, témoin du vol, se présenta : il accusa le Kapo. Celui-ci, aidé du gardien, rossa le témoin à coups de pieds et de poings. Pareille injustice souleva un tollé de protestations. Tout l'atelier fut alors privé, pour plusieurs jours, de supplément de nourriture. Le Kapo, qui jouissait de l'immunité, ne fut même pas fouillé. La vigilance des gardiens s'attachait aux moindres détails : dans l'atelier du mica chacun devait faire la file pour user du « kubel » placé bien en vue, face aux travailleurs. Un matin, ceux qui attendaient depuis longtemps déjà, cédèrent leur tour à un camarade souffrant, plus pressé. Il faut croire que pareil geste n'était pas réglementaire, car le malheureux, à peine installé sur la tinette, en fut délogé à coups de botte par le gardien. Le prisonnier ainsi malmené était un tuberculeux visiblement atteint d'une dangereuse dyssenterie. La scène suivante m'a été rapportée par un ouvrier du commando de Custrin. Dans un atelier, deux ouvriers parlaient tout en travaillant. Le Kapo n'avait pas manqué d'en avertir le gardien. Celui-ci, percevant le bruit de conversation et des rires confus parmi le ronronnement des tours et des moteurs, s'avança à pas feutrés. Quand il fut aux environs des coupables, il leva sa matraque et tapa un coup sec à gauche et à droite sur la tête de deux hommes qui s'effondrèrent, knock-out. Les deux bavards, entendant derrière eux un cri, une chute de corps, se turent instantanément et en furent quittes pour la peur...
Un soir, après le travail, le Kalfa attendit notre retour pour faire une scène spectaculaire : il se dirigea vers nos paillasses, plongea la main dans l'une d'elles et retira le paquet de mes notes. D'un bond, je les lui arrachai. Il se précipita sur moi. Au cours de la bagarre, je cherchais plus à détruire les documents qu'à parer les coups. Le gardien, d'abord impassible, ne tarda pas à prendre parti pour son Kalfa; alors ce ne fut pas long. Quand je revins à moi, ma bouche saignait, des douleurs cuisantes marquaient les coups de botte du gardien. Des camarades compatissants me ranimaient pendant que d'autres, plus pessimistes, avaient déjà tiré au sort mon prochain repas et mon morceau de pain. Le travail commençait à six heures. Cinq minutes avant, nous étions sur deux rangs à l'atelier, tandis que le gardien, un peu à l'écart, attendait, montre en main, l'heure prescrite par le règlement. A six heures précises, il se redressait, faisait
signe au Kapo qui criait:: Pour des Allemands, pareil commandement impliquait une série de réactions énergiques: claquement des talons, raidissement du maintien. Mais les prisonniers opposaient à toutes les tentatives de discipline une forse invincible d'inertie. Ils gardaient imperturbablement leur allure misérable, l'accompagnement volontairement de consortions grotesques. Le gardien, très formaliste, exécutait à la lettre le cérémorial du "Zuchthaus": d'un pas bien marqué, il s'avançait jusqu'au milieu de l'atelier puis, fixe, les talons joint, les doigt sur la couture du pantalon, le regard dans le vide, l'"aur naturel et dégagé", saluait l'assemblée d'un « guten Morgen ». Après quoi, revenant en arrière, il commençait à compter les hommes alignés. Parvenu au bout de la rangée, il constatait toujours une différence entre le nombre des présents et les chiffres du tableau de service Alors, à l'aide d'une liste tirée du tiroir de sa table, il commençait l'appel des noms, mêlant ceux des vivants, des malades, des ouvriers passés dans un autre atelier et des morts. Les prisonniers répondaient « kaput, krank, weg » pour les absents. Enfin, après plusieurs pointages, le gardien criait : — Arbeiten ! (au travail !). Les contremaîtres, eux, n'arrivaient à l'atelier qu'à sept heures et demie. D'un geste automatique de robot, ils commençaient par poser leur serviette de cuir sur leur table. Nos contremaîtres étaient propres, rasés de frais, portant généralement un pantalon bleu ou brun, une veste de fibrane à carreaux. Sur leur chemise bleue ou brune, ils portaient une cravate. Tous avaient un insigne nazi bien en évidence. Ils mangeaient à la prison trois fois par jour : à dix heures à l'atelier, à treize heures au réfectoire des gardiens, à dix-sept heures encore à l'atelier. Ils se vantaient de leurs salaires qui nous paraissaient considérables et se plaignaient du rationnement et du manque de marchandises qui les empêchaient d'en jouir paisiblement; une grande part de leur paie passait au marché noir et aux femmes, principaux sujets de leurs conversations. Ils avaient parfois des gestes de compassion. Une cigarette tombait, comme par hasard, de leurs lèvres au pied d'un forçat passionné de tabac; un bout de tartine était oublié sur la table d'un ouvrier. Des pelures de fruits étaient offertes à l'un ou l'autre quémandeur. Les contremaîtres désignaient à chacun sa place. Comme à l'école, toujours au même banc entre les mêmes compagnons; nous aussi, toujours devant les mêmes tables, soumis à une même surveillance, nous avions retrouvé la mentalité de collégiens trompant le pion. Gardiens, contremaîtres, Kapos, rivalisaient de finesse, s'acharnaient à dépister nos ruses. Leur approche arrêtait les conversations. Certains ne parlaient plus alors que du coin des lèvres. Billets, messages, communiqués circulaient sous les tables. Des boulettes de papier, des petits déchets de mica étaient parfois lancés d'un coin à l'autre. Mais il n'y avait ni rire ni même un sourire sur nos lèvres. Nos camarades nous initiaient à la bonne manière de travailler. Un de nos voisins, un rimailleur invétéré, tenant d'une main son couteau" de l'autre un bout de crayon pour écrire ses sonnets, me répétait: "Aie toujours l'air occupé !... Fais croire que la tâche est au dessus de tes forces - c'était vrai. Ne nuis pas aux copains en faisant plus que ta tâche car tout l'atelier devrait alors faire autant que toi. Au début, je trouvais dans le travail, un dérivatif aux inquiétudes qui m'obsédaient, je m'acharnais à combiner efforts et mouvements pour faire un travail rationnel. En peu de temps, j'avais acquis suffisamment d'habitude pour ne plus devoir faire un effort d'attention. Le travail n'occupait plus que mes mains. Mon esprit libéré se laissait facilement envahir par un innommable dégoût de l'existence à laquelle j'étais condamné; par l'amertume de ma vie de forçat. Avec une insurmontable angoisse, je sentais sombrer mes moindres espérances dans un vide affreux. Pour éviter ces tristesse trop déprimantes, la conversation avec les camarades était un grand secours. Entre une multitude de forçats, de race, de nationalité, de milieu social différents, l'échange d'idées aurait dû être passionnant. Mais pour la plupart, les hommes écrasés par leur malheur, Norvégiens s'exprimant en anglais ou en allemand, Belges, Hollandais, Français, se bornaient à raconter au nouveau venu « leur histoire ». Aucune allusion à la vie familiale, à l'existence passée et moins encore aux activités patriotiques. Le récit du prisonnier entrait sans préliminaire dans le vif du sujet : l'arrestation. Suivaient les interrogatoires avec, le cas échéant, les tortures, puis le jugement, la condamnation. Une longue parenthèse s'ouvrait sur les colis, les visites, la correspondance, le régime comparé des prisons. L'histoire se: terminait par le départ pour l'Allemagne et les changements de prisons. Le passage du contremaître ou la fin du travail obligeaient-ils le narrateur à suspendre son récit? A la première occasion, l'histoire était repris là-même où elle avait été interrompue. Brodé sur un même canevas, le récit détaillé des démêlés avec le Gestapo, finissait vite par manquer d'intérêt. Mais un sort identique nous rapprochait : mêmes péripéties, mêmes tourments, mêmes anxiétés. Parfois, cependant, échappant a la monotonie générale, une aventure banale cachait un drame intime, une blessure plus profonde. Car il y avait parmi nous des condamnés à mort sur dénonciation de leur propre femme ! Pour se débarrasser d'un mari encombrant, une épouse avait dévoilé aux Allemands la cachette d'un revolver, d'un vieux fusil de chasse non déclaré, malgré les ordres des kommandanturs. En prison, dans la solidarité créée par la commune souffrance, les cocus n'étaient plus ridicules. Les victimes de malheurs conjugaux nous inspiraient une réelle commisération, même si leur comportement n'était dû qu'à leur infortune familiale sans relation avec un acte de résistance aux Allemands. De pareilles situations étaient passionnément commentées. Chacun donnait, pendant quelques moments, son avis : - Moi, je l'aurais froidement descendue ! Après quoi, chacun se livrait à des réflexions
personnelles recherchant, un peu tard il est vrai, l'expédient qui eût pu
écarter le drame. Les conversations entre camarades revêtaient toujours un ton sérieux. Les prisonniers ne plaisantaient guère et les drôleries, blagues marseillaises, histoires de curés, anecdotes du genre du « Wagon des fumeurs » ne déridaient plus. Dans l'atelier, je n'ai pas entendu un calembour, une gaudriole. Ils eussent paru incongrus. Le sens du comique, toutefois, ne nous échappait pas. Parfois des scènes véritablement clownesques déclenchaient une telle hilantr qu'il fallait la privation du supplément de nourriture pour ramen. sur le visage des forçats leur air renfrogné. Je me souviens d'une scène de ce genre : Excédé par un jabotage ininterrompu, un contremaître conduit au gardien un lourdeau, incorrigible bavard. Le coupable s'avance d'un air résigné et campe imperturbablement sa masse devant le gardien qui, furieux, l'engueule et lui allonge un soufflet. D'un geste à peine perceptible, notre camarade retire légèrement la tête, esquive le coup qui tombe avec bruit sur le crâne du contremaître. Les prisonniers n'étaient pas devenus indifférents à tout. L'émotion se voyait sur beaucoup de visages. Attendrissement, larmes, troubles, s'augmentaient par la faiblesse, l'épuisement physique et nerveux diminuant nos facultés de résistance. Les poèmes de Lamartine, Musset, Baudelaire, Péguy, transposés dans le désarroi de notre détresse, prenaient tout à coup un sens nouveau, une valeur infiniment plus émouvante, plus réelle que le conformisme d'une vie « sans histoire » ne permet de l'imaginer. J'ai pleuré en voyant mes camarades souffletés, brutalisés, se tordant de souffrance; j'ai pleuré en fermant les yeux de compagnons qui venaient de mourir... Les poumons empoisonnés par l'atmosphère des ateliers, nous avions autant besoin d'air que de nourriture. La promenade était indispensable pour détendre nos membres ankylosés par cinq à six heures d'affilée en position assise et pour reposer nos yeux, après de longs séjours dans des locaux toujours insuffisamment éclairés. La promenade de vingt minutes se passait dans une cour rectangulaire encadrée de bâtiments. Le soleil d'automne n'y apparaissait que tardivement. Jadis destinée à la gymnastique, cette cour avait été remuée de fond en comble. Trois chemins circulaires parallèles, tracés entre des semis de navets, d'épinards, de céleris, étaient reliés entre eux par un sentier. Au centre, du haut d'un tertre, un gradé allemand nous surveillait. Aux quatre coins, des gardiens, jambes écartées fusil en mains, étaient prêts à épauler. Le silence et les distances entre prisonniers étaient strictement observés tant nous craignions la suppression de nourriture. Les forçats accompagnaient leur marche de quelques mouvements de gymnastique respiratoire; ils toussaient comme des renards et, pour épargner leurs mouchoirs de poche (distribués une fois par quinzaine), ils crachaient leurs poumons et leurs bronches sur les les légumes qui devaient servir à faire notre soupe. Pour plusieurs camarades, comme pour moi, cette marche en silence était une occasion de se recueillir, d'élever notre pensée vers Dieu Et je Le remerciais d'avoir permis que je sois entouré de bons compagnons, de vrais amis, de m'avoir, malgré tout, maintenu en vie. Il y avait, en effet, mieux à faire que de se limiter aux poux et punaises, à la faim et au froid, à la crasse, à notre vie de misères ! Pourquoi s'arrêter sur sa propre souffrance, sur l'amertume de son propre sort comme si nous n'étions pas tous dans une même situation ? Le fardeau, déjà lourd, de notre croix, augmentait avec la tristesse, l'inquiétude, le pessimisme. Je les bannissais de mes pensées, des conversations et même de mes prières. J'en étais arrivé à ne plus dire le de profundis, dont le bouleversant réalisme avait suscité chaque fois, en moi, un flot d'anxiété et d'angoisses. A certains jours, malgré tout, révolte, dégoût trop ressassés, provoquaient un tel tumulte dans les pensées, que prier était difficile, les formules habituelles devenaient intolérables. Je revenais alors à ces mots simples et confiants, pareils à ceux que les plus petits de mes enfants disaient encore, sans doute. Peu à peu, la paix revenait en moi et je me bornais à chantonner des fragments du Stabat Mater, du O Fillii et Filiœ, du Gloria, du Te Deum. A midi, la promenade cessait. Pour rentrer à l'atelier, nous passions devant les bureaux d'administration où se trouvait un tableau mentionnant l'effectif journalier de Sonnenburg. La prison était complète avec mille cent cinquante détenus. Le tableau contenait, en outre, deux cases : les « eintretend » (les nouveaux) et les « austretend » (les sortants), c'est-à-dire les morts de la journée. Nous mangions à l'atelier. Après un premier défilé devant les bidons, le gardien annonçait le supplément, communément appelé « rabiot » et le tour recommençait jusqu'à épuisement de la soupe, avec une priorité pour les Kapos et quelques lèches-bottes. Un droit de "eaclage du bidon" était exercé par le dernier servi. Les gardiens supprimaient souvent la promenade et permettaient alors de cesser le travail un quart d'heure avant la distribution de la soupe. Le lendemain de mon arrivée à Sonnenburg, le dégel nous empêcha de sortir au préau. Ce jour-là, en proie au mal du pays ie n'arrivais pas à me mêler à mes nouveaux compagnons de l'atelier de la ficelle. Captif de ma peine, je restais un isole dans la foule. Un grand diable de bagnard vint s'asseoir à côté de moi : - Tu as le cafard ?... Faut pas ! Tu ne peux pas te laisser aller. Autant vaut te suicider ! Je suis prêtre, si tu veux communier, tu trouveras des hosties dans une petit boîte en fer-blanc posée sur la grosse poutre là-bas. Pour pouvoir communier ainsi, il fallait profiter de l'agitation causée par la distribution de la soupe à l'atelier. Dernier arrivé, je devais être servi le dernier. Alors, pendant que toute l'attention des forçats était concentrée sur la soupe qu'on venait d'apporter, qu'une cuillère mal versée, un bol insuffisamment rempli soulevaient des tempêtes, je me faufilai dans la demi-obscurité du grenier. Evitant soigneusement les gardiens, les Kapos, je finis par découvrir la cachette et la petite boîte en fer-blanc. Abrité derrière des caisses et des sacs empilés, je me mis à genoux et communiai. Quelques jours après, hélas ! le prêtre mourut et la boîte resta vide, abandonnée sur la grosse poutrelle. ................................................. A midi cinquante, une cloche annonçait le reprise du travail. Chacun reprenait alors sa place tandis que les contremaîtres mettaient de l'ordre sur leur table, fermaient leurs tiroirs et s'en allaient pour manger. Les gardiens passaient leur capote, bouclaient leur ceinturon et à midi cinquante-cinq, sortaient, après avoir verrouillé la porte de l'atelier. Nous avions devant nous une heure sans surveillance. Dans un branle-bas général, nous quittions nos tables de travail pour nous grouper entre amis. L'atelier se transformait d'un coup. Jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dames apparaissaient. Des stratèges dépliaient les cartes des opérations militaires - plusieurs prissoniers avaient reconstitué, de mémoire, la carte des pays en guerre - et commentaient les prétendues dernières vraies ou fausses nouvelles. Les amateurs de poésie formaient de petits cercles. Poètes, littérateurs avaient reconstitué une sorte de bibliothèque de manuscrits. Nous trouvions des cahiers de vers de Péguy, de Baudelaire, de Lamartine, de Musset. D'autres récitaient des odes, des sonnets' des tirades. Les rimailleurs cherchaient obstinément des rimes m'asculines et féminines pour leurs alexandrins et nous imposaient l'audition de leurs œuvres. Je faisais partie d'une petite équipe dont chaque membre, sans aucun souci d'éloquence, donnait, à tour de rôle, une causerie sur un sujet de son choix : des médecins parlaient des cas difficiles rencontrés au cours de leur carrière, des avocats s'étendaient sur une cause célèbre ou un drame passionnel, des artisans expliquaient les secrets de leur métier. L'abbé Vallée, de Saint-Brieuc, forçat comme nous, commentait admirablement les épîtres de saint Paul, montrant comment, dans notre état, nous pouvions appliquer ces préceptes de charité. Privés de tout autre secours religieux, nous avions soif de paroles de vérité et d'amour divin. De plus en plus nombreux, nous nous groupions autour de lui. Retournés à nos places de travail, nous comprenions mieux que nos souffrances étaient un trait d'union avec Dieu. Aux bouillonnements de révolte, succédaient l'apaisement, la sérénité et parfois même plus d'indulgence pour nos gardiens. Les problèmes économiques et sociaux, objets de causeries contradictoires, étaient animés par des exposés de théories relevant de toute la gamme des nuances philosophiques et religieuses : un jeune ingénieur avait préconisé un système étatiste et communisant pour assurer définitivement au monde le bonheur et la paix. Il m'avait passé ses notes m'invitant à faire la contradiction. Deux thèses s'affrontèrent sans pouvoir se rejoindre. L'auditoire divisé reprit plusieurs jours une discussion sans issue. Peut-être l'abbé Vallée, ancien aumônier des œuvres sociales, aurait-il pu trouver un terrain de conciliation ? Mais ses théories se heurtèrent à toutes celles qui avaient été exprimées. Ses disciples finirent même par former un troisième parti dans notre groupe. Les Norvégiens se réunissaient pour chanter à mi-voix des psaumes. Un quatuor de Hollandais — un avocat et trois officiers — consacrait une partie du temps à méditer et prier. L'un d'eux lisait à haute voix une épître, une page d'évangile. Un autre commentait le texte avec une telle conviction que souvent les trois autres, gagnés par l'émotion, pleuraient silencieusement... Un peu avant deux heures, quelques camarades surveillaient arrivée des gardiens. Comme en Belgique et en France, le cri d'alarme "vingt deux " ramenait l'ordre et le silence dans l'atelier. Les gardiens le savaient bien. Avant d'ouvrir la porte, eux-mêmes, d'une voix rauque, hurlaient « vingt-deux », certains de trouver, ensuite, l'atelier en plein travail. Nous y passions nos nuits, nos dimanches et nos temps de maladie. Maintenant, que j'essaie de me représenter la chambrée de Sonnenburg, tant de souvenirs surgissent à la fois que l'image que je voudrais tracer est de plus en plus confuse. Rompu de fatigue, j'y ai connu de longues nuits blanches. J'y ai dormi profondément. Là, j'ai été douloureusement angoissé par l'obsession de la mort; j'ai vu des camarades mourir. Là, j'ai pleuré, prié, parfois ri... La porte était barrée par un verrou pesant, tiré par le gardien au moment de nous faire entrer. Nous descendions deux marches avant de nous trouver au niveau de la pièce. Au même moment, le gardien remettait violemment le verrou dont le bruit métallique résonnait comme le glas de notre liberté. La pièce était longue et étroite, éclairée par quatre petites fenêtres traversées de barreaux branlants et rouilles. Au plafond bas, pendaient deux lampes, l'une brûlée, l'autre indigente. Le mobilier se composait d'une grande table avec deux bancs, de deux paires de châlits; à terre, des paillasses repliées. Dans un coin, les tinettes derrière un sac tendu sur un cadre, paravent bricolé par un prisonnier. Le long des murs, à hauteur d'homme, des étagères pour nos couverts, nos cuvettes. La chambrée devait contenir quarante prisonniers, chiffre immuable, toute place vacante étant immédiatement occupée par un nouveau venu. Huit prisonniers dormaient sur les châlits, deux autre dépliaient leur paillase sous le table. Le trente autres s'étendaient comme ils le pouvaient sur les vingt paillasses étalées le long du mur. Nous ne disposions pas d'espace suffisant pour nous étendre sur le dos. Nous étions tous en « chien de fusil». Le surveillant de l'atelier ne s'occupait plus de nous après le travail. Un autre gardien nous ramenait en chambrée. Mais préalable, il fallait réglementairement se mettre en rangs pour l'appel, puis sortir de l'atelier pieds nus, sabots à la main, marcher à un mètre les uns des autres, saluer les multiples gardiens échelonnés sur le parcours. Sitôt arrivés, nous devions nous hâter pour préparer les lits et faire, si possible, un brin de toilette. Puis, de nouveau, nous ranger pour sortir de la chambrée et passer devant les Kalfas suivant les prescriptions précises, recevoir notre souper, rentrer en chambrée et nous pouvions, enfin, nous asseoir et manger. Le couvre-feu ne tenait pas compte des retards ni du mauvais vouloir des gardiens qui, parfois, sous des prétextes futiles, nous retenaient longtemps en un garde à vous éreintant après onze heures d'atelier. Nous devions, alors, manger dans l'obscurité. Mais une fois dans la chambrée, quelque malpropre et sordide qu'elle fût, nous pouvions nous détendre : délivrés de l'espionnage odieux des surveillants, nous osions, enfin, dire à haute voix nos pensées, maudire nos gardiens et les Allemands. En étalant ses paillasse et couvertures, chacun racontait les incidents de son atelier, les colères des surveillants, les bribes de nouvelles qu'il avait récoltées. Nous apprenions ainsi quelques détails sur le sort des malades, nous étions avertis des décès, nous connaissions le nom des nouveaux arrivés et, surtout, nous étions tenus au courant des opérations militaires. Nous étions avides d'avoir des nouvelles de la guerre, vraies ou fausses, elles étaient toujours bonnes et soutenaient notre confiance, nous commandaient de garder espoir. Les succès les plus extravagants de nos alliés étaient lances avec assurance ! Leur exactitude était garantie par le témoignage de gens « bien informés » que personne ne connaissait, les confidences a un gardien anonyme, les indiscrétions inouïes provenant toujours d ateliers que nos camarades ne fréquentaient pas ou, enfin, les articles de journaux qu'aucun de nous n'avaient jamais lus. Ah ! ces fameux bobards ! Ils nous ont beaucoup aidés. Incontrôlables, invraisemblables, inacceptables, je les aimais malgré tout. T'entrais en rage contre les incrédules, saboteurs de moral qui se permettaient d'en dire ce que j'en pensais au fond de moi-même. Nous avions besoin, un besoin vital, de ces bonnes nouvelles. Quand les gardiens étalaient ostensiblement la page du journal annonçant, en caractères gras, une victoire allemande, les bobards se terraient. L'atelier, comme la chambre, devenaient plus mornes. Notre existence apparaissait dans une réalité écrasante. Les forçats, atterrés, semblaient atteints d'une blessure de plus. Je fus, ainsi, involontairement, l'occasion, lors de ma première soirée à Sonnenburg, d'un orage. Toute une chambrée, à l'affût des dernières nouvelles, m'avait accueilli comme un messie et me pressait de questions. Mais, au fur et à mesure de mes réponses, je voyais mes auditeurs se décontenancer et leur nombre diminuer. Les uns, furieux, se disputaient déjà; d'autres s'éloignaient ostensiblement en me traitant de défaitiste, de saligaud, de sale Boche. Depuis quelques jours, une série de fausses nouvelles avait fait remonter au beau-fixe le baromètre des prisonniers. On avait commencé par la chute de Minsk, de Smolensk (où les Allemands se cramponnaient encore), en somme, une avance de cent kilomètres ! Puis, de plus en plus excités, les prisonniers avaient signalé les alliés aux portes de Rome (ils piétinaient aux environs de Naples). Par un comble d'audace et de naïveté, j'osai démentir une déclaration attribuée à Churchill promettant la fin de la guerre pour Noël 1943... La chambrée était en ébullition ! Contredit par tout le monde, je montrai deux journaux : Le Soir et Brusseler Zeitung, emportés de Bruxelles et datant de huit jours. Devant pareil argument, les camarades se calmèrent. Un des plus âgés en fit la lecture, les passa a un voisin... Un prisonnier s'avança : — Vous permettez ? Sans même jeter un coup d'oeil sur les titres, il déchira les journaux en petits morceaux qu'il répartit à tous dans la chambrée sans m'oublier. J'avais, ainsi, providentiellement, procuré à tous ration de papier hygiénique. .................................. Nous recevions deux repas dans la chambrée: le matin, une miche de pain, un quart de café; le soir, un quart de litre de soupe légère ou un supplément de pain, avec une rondelle de margarine et un morceau de boudin. Dans la composition du boudin entrait, sans doute, un peu de sang. Le reste était un secret allemand qui n'a heureusement, pas traversé nos frontières; le tout était enveloppé de papier au lieu de boyau. Nous avions faim, une faim douloureuse, causant des défaillances La tête tournait; les jambes flageolantes ne supportaient plus le corps. Une sensation pénible de vide, accompagnée de vertiges déchaînait comme une fureur de manger n'importe quoi. Tant pour le repas en chambrée que pour celui distribué à l'atelier je m'étais imposé comme une règle stricte de ne jamais regarder la part du voisin, de ne pas lécher mon assiette, de peler les pommes de terre de ma ration et de ne pas manger ensuite les pelures. J'avais décidé de ne jamais parler de nourriture. Pareille résolution était tenable pendant le jour avec des compagnons qui suivaient la même règle. Les conversations diverses nous faisaient oublier un peu la faim. Mais la faim venait la nuit, obsédante. Réveillé par un estomac criant famine, mon imagination se passionnait pour des grillades, du beurre, du riz, un camembert, des gâteaux, pour des repas qui, d'un coup, eussent rassasié ma faim. Tout le monde ne résistait pas aux tentations que la faim rendait constantes. Il était imprudent, pendant le repas, de quitter sa place. La gamelle, un instant abandonnée, disparaissait vite : contenu et contenant. Il valait mieux manger tout de suite sa ration de pain. La garder, même en poche, était lui faire courir des risques. Car la nuit, des forçats volaient le pain de leurs compagnons imprudents. Des disputes graves, pénibles, mettaient aux prises même des amis. Et comme le coupable était souvent de ceux dont les protestations s'élevaient les plus violentes, le volé avait bien peu de chance de récupérer son bien. D'autre part, certains exploitaient la générosité des camarades : un prisonnier prétendit, un matin, que son pain, laissé la veille sur son étagère, avait été volé pendant la nuit. Des camarades compatissants organisèrent sur-le-champ une collecte. Nous abandonnâmes à la victime, la valeur d'une mouillette de notre pain et le volé finit par faire un déjeuner copieux. Mais, dans la chambrée, de les limiers établirent, après enquête de plusieurs jours, la supercherie du soi-disant volé : pendant la nuit, il avait pris lui-même, dans sa cassette, ses provisions. La faim et la crainte d'une faim plus grande encore poussaient tains prisonniers à chercher à se constituer des provisions. Un r en rentrant en chambrée, je vois un de mes compagnons gisant v 'e entouré de ses camarades qui le regardent. Est-il mort ? Je e tarde pas à apprendre qu'il vient d'être lynché. Au cours d'une inspection, le Kalfa avait découvert, dans la paillasse de ce prisonnier, douze miches de pain, séchées, moisies, immangeables. Croyant cet approvisionnement destiné à faciliter une évasion, le gardien mit la chambrée, pour plusieurs jours, à la demi-ration. D'où la terrible raclée que le responsable d'un drame pareil avait reçue. La faim était mauvaise conseillère : après avoir résisté aux pires tortures de la Gestapo, des prisonniers cédaient à la faim et consentaient à devenir Kapo, Kalfa, contrôleur, chef de chambrée, remplissant des postes occupés, en général, par des condamnés allemands de droit commun, apportant une aide aux geôliers. ........................................... Dès l'extinction des lumières — vers huit heures — les forçats se groupaient d'après leurs amitiés. Sur la paillasse que je partageais avec Paul Hoornaert, avocat à Liège, et André Thielemans, officier de marine, plusieurs compagnons venaient s'asseoir. Nous commencions par une prière dite par l'un de nous. Chacun avait son tour et la faisait à sa manière. Paul récitait une oraison au Christ en croix, aidé, à certains moments, par André, qui en connaissait mieux le texte. Quand venait mon tour, je disais mon espérance, ma confiance en Dieu. Je répétais parfois une invocation que, jadis, enfants, nous récitions agenouillés pour la prière du soir : «... Bénissez notre famille, notre maison. Mettez en nous la paix et la confiance. Donnez-nous la force d'accomplir notre devoir et de vous aimer de plus en plus. » Dans l'abîme de misères où nous nous trouvions, mes sentiments s'exaspéraient par moment jusqu'à paraître provoquer le Seigneur, chercher à l'obliger à manifester sa puissance, sa bonté, sa justice. Mais ces quelques minutes de recueillement apaisaient nos cœurs inquiets. Nous vivions, durant la journée, comme des chiens sous le bâton, perpétuellement sur le qui-vive, dans la crainte des coups, même en l'absence des gardiens... Nous parlions, ensuite, de mille choses qui nous traversaient l'esprit. André rêvait de mer. Il avait dessiné un yacht qu'il construirait après la guerre et nous décrivait déjà ses voyages sur les Océans. Paul aimait la Meuse. Il en racontait les légendes, et nous menant aux sentiers jusqu'au sommet des coteaux, il nous faisait admirer les méandres du fleuve. Après quelques heures, le froid, la fatigue, désagrégeaient les groupes. Chacun se couchait, enveloppé dans sa couverture. Avec mes voisins de lit je continuais nos bavardages. Dans l'obscurité, il semblait que nous exprimions mieux et plus librement le fond de notre pensée. Même des conversations d'apparence banale avaient, pour moi, du charme. Elles me permettaient d'évoquer des souvenirs que j'aimais et dont j'étais heureux de parler, fût-ce sans que mes camarades puissent les comprendre ou les connaître. Après quelque temps, l'un ou l'autre, désireux de dormir, nous demandait de parler à voix plus basse. Les dernières conversations s'achevaient. Le silence n'était plus troublé que par la respiration des dormeurs, régulière comme le tic-tac d'une horloge. Il me fallait longtemps avant de m'endormir dans la chambrée ! Trop de choses m'étaient odieuses : me mettre en chien de fusil, me résoudre, faute d'oreiller, à poser la tête sur le coude qui s'engourdissait avec des picotements insupportables, me lever cinq fois la nuit sous l'action diurétique de la soupe, me sentir une gêne pour mes voisins : Jean, ton coude ! Tes os pointus ! Ton genou ! Tu remues comme un ver ! Tu me découvres les pieds ! Tu as tiré à toi la couverture, etc., etc. A la longue, le sommeil finissait par vaincre mon énervement. A l'aube, dans une douce somnolence, l'esprit reposé s'abandonnait facilement à des rêveries où se mêlaient l'évasion, le retour, la bonne chère. Mais à l'heure du lever, l'ampoule électrique allumée du dehors par le gardien tournant l'interrupteur dans le couloir, projetait sa lumière sur notre affreuse misère. La chambre qui, dans la pénombre de la veille, avait été « le dernier salon où l'on cause » apparaissait dans son horreur tout à la fois asile de miséreux, W.-C, cloaque avec des tinettes débordant sur le plancher, morgue. Surprises par la lumière, les punaises battaient en retraite. A leurs morsures cuisantes s'ajoutaient, pour nous, les ravages des puces, les démangeaisons atroces des poux. Des malades geignaient, des moribonds soupiraient, râlaient à côté de morts étendus déjà raides. Puis montaient des crus, des jurons d'-êtres exaspérés qui, à certains moments, finissaient par se haïr... Nos maîtres de l'heure, passant dans le couloir, ne se souciaient pas de nos drames. Une journée recommençait, continuant notre vie Courbatus, nous quittions nos paillasses, oubliant le supplice des insomnies du début de la nuit. Il fallait faire diligence : replier matelas et couvertures, balayer, ramasser la poussière, faire un peu de toilette avant l'appel immédiatement suivi du premier repas. Se laver était d'une complication inouïe. Nous nous efforcions d'en rire, mais je ne puis me le rappeler sans dégoût. Nous disposions d'une cuvette pour trois hommes. Le problème de l'eau était tragique. Chaque soir, nous recevions, par groupe de trois prisonniers, un broc de trois litres, ration théorique rarement atteinte. En fait, nous disposions de si peu d'eau que Paul Hoornaert, André Thielemans et moi avions adopté la règle suivante : chacun de nous avait son tour pour être le premier à se laver le visage. Les autres suivaient dans un ordre fixe. Ensuite, nous nous lavions les mains dans le même ordre. Après quoi, l'un ou l'autre se risquait à poser les pieds dans la cuvette. Le lundi, je commençais la séance; le mardi, j'étais le second à me laver la figure; le mercredi, étant le troisième, je me bornais à me nettoyer les mains, remettant au jeudi l'agréable sensation d'être le premier à me laver le visage à l'eau fraîche. Quant au reste ? Quatre semaines après mon arrivée à Sonnenburg, je pus, enfin, passer pour la première fois sous la douche, accessible mensuellement. Nous vivions dans une crasse abominable, accrue par le rationnement d'eau. Le savon était une sorte de terre plastique mêlée d'un produit chimique peu efficace. Le coiffeur nous rasait tous les quinze jours. Au bout de quinze jours aussi, nous changions de linge mais le « linge propre » qui nous était fourni était souvent plus sale que nous portions, entretenions avec soin et épouillions chaque soir. Le "linge propre", soeuillé de traces de suppurations, n'était ni lavé ni réparé. Tous les boutons manquaient. Les poux fourmillaient dans les plis. Les paillases, dont la paille hachée se désagrégeait, répandaient au moindre mouvement une poussière noire qui nous faisait tousser et éternuer. Elles passaient de l'un à l'autre sans attribution fixe. Nous ne gardions que nos voisins, bien portants ou malades, couchés sur n'importe quelle paillasse. Le gardien entrant pour l'appel, rugissait chaque fois: - Es stinkt hier (cela pue ici)... Il avait, certes, raison ! Et d'autant plus qu'avant de descendre dans notre taudis, il avait suivi, entre des murs blancs, un long couloir au linoléum soigneusement encaustiqué, sur lequel il était interdit aux forçats de circuler en sabots. Une odeur de désinfectant donnait l'impression de propreté. Au-dessus de chaque porte aux poignées luisantes, une pancarte indiquait le nombre maximum d'habitants que la pièce pouvait contenir. Au-dessus de la nôtre, les quarante hommes de la chambrée pouvaient lire : « Nur fur zwanzig Mann» (pour vingt hommes seulement). Mais, en pénétrant dans notre dortoir tout le monde aurait, comme le gardien, marqué son dégoût par un « es stinkt hier »... Poussières, infection, malpropreté étaient des foyers actifs de propagation de scarlatine, typhus, érésypèle, diphtérie, pneumonie, à l'état endémique et contre lesquels nous étions sans défense. L'intervention du médecin se limitait à une dispense de travail. Les médicaments étaient pour ainsi dire inconnus. Même l'aspirine qui tant de fois eût pu couper le mal naissant, n'était donnée que parcimonieusement et même parfois venait à manquer. Etaient toutefois d'usage, soit un « abfùhrmittel » foudroyant, soit un inefficace « ver-stopfmittel » (une purge ou le contraire) distribués aux plaignants par le gardien ou le chef d'atelier, au gré de sa fantaisie personnelle. Un simple malade restait en chambrée. Morts ou mourants, seuls, étaient emportés par les aides-infirmiers. Les places ainsi devenues libres étaient occupées le jour même par un nouveau prisonnier qai, souvent, ne tardait pas à contracter la maladie de son prédécesseur sur la paillasse. L'infirmerie, bâtiment séparé, n'acceptait que les moribonds. Ils étaient allongés sur des paillasses posées sur le sol dans des pièces non chauffées. Le nombre des malheureux était tel que les paillasses étaient rangées jusque dans les corridors, exposées à tous les courants d'air. . . L'infirmier était connu pour ses brutalités et tous les prisonniers répétaient entre eux qu'il abrégeait volontairement la vie des malades en leur faisant prendre du poison. Dans une pareille situation, personne ne s'arrêtait sur des bobos qui, jadis, eussent fait appeler le médecin, courir chez le pharmacien et justifié une absence du travail. Plaie purulente, angine, fièvre, bronchite, dyssenterie étaient supportées telles quelles, chacun luttant jusqu'au bout de ses forces. Alors, sachant cependant que la démarche était inutile, nous demandions tout de même la visite du médecin par un reste d'habitudes d'autrefois. Au moment du rassemblement pour le travail, le malade, épuisé, s'inscrivait pour la visite médicale. Il restait en chambrée jusqu'à ce qu'un gardien vînt le chercher le jour réglementaire des examens médicaux. Les mardis et jeudis étaient consacrés aux malades de l'aile nord; le reste de la semaine aux autres bâtiments. Le dimanche, médecin et infirmiers respectaient le repos dominical. Les cas urgents n'avaient qu'à attendre comme les autres. Les malades, quel que fût leur état, devaient se présenter sans aucune aide du personnel sanitaire allemand. Sous la conduite de gardiens, toujours sacrant, hurlant, tapant, se formait un cortège de misérables traînant ou portant les moribonds à l'infirmerie. Nous étions rassemblés dès dix heures du matin et stationnions en plein air, dans une bise glaciale, devant la porte de l'infirmerie. Parfois il gelait quinze ou dix-huit degrés sous zéro. Le médecin arrivait à une heure. Aussitôt, l'infirmier-chef nous faisait pénétrer dans le corridor jamais chauffé de l'infirmerie. Quel que fut le mal dont nous venions nous plaindre : panaris, furoncle, œdème, etc., l'infirmier-chef commandait à tous de se déshabiller : le torse nu; les malades attendaient leur tour dans une file toujours nombreuse. Lors de mon premier passage à la visite médicale, j'entrai dans le cabinet du docteur en même temps que deux autres malades. Le médecin signait des états, des statistiques, des actes de décès; à peine jeta-t-il un coup d'oeil sur nous. Le chef-infirmier nous planta à chacun un thermomètre en bouche, puis le retira en signalent la la température. Le médecin, sans lever la tête, prononça « quatre jours de repos » et retrempant sa plume dans l'encre continua sa besogne Je demandai alors une aspirine. Docteur et sanitaire en demeurèrent stupéfaits. Mais un remarquable événement se produisit : l'infirmier prit alors un comprimé, le fourra dans ma bouche qu'il tint fermée d'une main tandis que de l'autre il me tendait un verre d'eau Après avoir bu une gorgée, je dus montrer mon gosier pour faire constater l'absorption du médicament. La visite médicale terminée, les prisonniers se groupaient autour de leur gardien. Les uns avaient à retourner à l'atelier. Ceux qui avaient obtenu du repos étaient reconduits dans leur chambrée. Et là, entourés de couvertures, le corps allongé sur une paillasse, ils n'avaient plus qu'à laisser agir la nature et le temps. Pendant la journée, les Allemands ne donnaient pas d'éclairage électrique aux chambrées. La nôtre, avec des fenêtres minuscules au nord, sans jamais un rayon de soleil, était particulièrement lugubre. Dans la pénombre continuelle, accablés par une pesante solitude, les malades tombaient dans une torpeur douloureuse. Plus d'une fois, j'ai surpris mes compagnons essuyant leurs larmes. Le chef-infirmier ne passait jamais dans les chambrées. Le Kalfa ouvrait la porte, jetait un regard de connaisseur et faisait rapport au hauptwachtmeister sur l'état des mourants. L'abandon était total. Il ne restait qu'à prier, à espérer contre toute espérance, croire quand même en un Dieu qui semblait nous avoir abandonnés. En février 1944, une épidémie particulièrement violente de grippe infectieuse, de scarlatine, de dyphtérie, sans compter d'autres maladies, ravageait la prison. Devenu brusquement fiévreux et accablé, j'était allé de nouveau au cabinet de consultation médicale, demander une dispense de travail au docteur qui, cette fois, m'avait donne huit jours de repos. Après la visite, j'étais retourné dans ma chambrée où onze malades, la plupart mourants, se débattaient affreusement. Je n'entendais qu'appels désespérés, plaintes, gémissements : «J'étourre... Assez !... Assez !... J'ai mal !... A boire !... Au secours !... » J'allais de l'un à l'autre, les aidant à se relever, à atteindre la tinette, à se retourner sur leur paillasse. Mais quelle détresse ! Je n'avais rien pour les soulager, pour arrêter les hoquets, pour atténuer les crampes intestinales, pour calmer leur respiration haletante...Il n'y avait pas une goutte d'eau à donner aux malheureux qui vomissaient, ni un chiffon pour laver ceux qui étaient pris de dysenterie. C'était à devenir fou ! Passant d'une paillasse à l'autre, écœuré, révolté par cette épreuve surhumaine, maugréant contre Dieu même, je maudissais notre abominable sort. Tout à coup, j'entendis glisser le verrou de la porte. Croyant à l'arrivée du Kalfa, je me préciptai un broc à la main pour demander de l'eau. Dans l'entrebâillement de la porte, j'aperçus un visiteur étonnant ! Un peu joufflu, teint rosé, de grande taille, vêtu d'une redingote, une étole violette à la main, un jeune prêtre descendait dans notre chambrée. A quels risques ? Comment avait-il osé venir jusqu'à nous ? Nous ne l'avons jamais su ! Monté clandestinement à l'étage des N. N. à l'aide d'un passe-partout, il allait dans les chambrées offrant son ministère. Courageusement, il alla chercher de l'eau, fit la toilette des malades. Puis il se pencha sur chacun, l'encourageant, le consolant. Après une absolution générale, il nous donna à tous l'extrême-onction. Les malades encore conscients purent communier. Au départ du prêtre, la chambrée était plus calme, même apaisée. Le soir, sept morts furent emportés. * * * Ce matin-là, trois paillasses de la chambrée n'avaient pas été repliées. Trois moribonds restaient étendus, la tête sous leurs couvertures, somnolant sans plus avoir notion du temps. Aucun d'eux ne prononçait une parole; ils n'avaient même pas remarqué le surveillant qui avait fait remplir leur bol à l'heure du repas. Le soir, après onze heures d'atelier, les forçats, affamés, se précipitaient dans la chambrée, impatients de leur pitance. Trois bols d'une soupe froide écœurante excitaient une convoitise inouïe. Un coup d'oeil sur les malades permettait aux "crève-la-faim" d'espérer l'aubaine d'un partage imminent. L'heure de la distribution de la soupe était là. Si les trois bols n étaient pas instantanément vidés, ils ne pourraient être remplis ae la soupe chaude du soir ! Les plus affamés répétaient, angoissés : - Tout cela va être perdu... Alors, n'y tenant plus, se penchant sur les malades, découvrant leur tête, les forçats se mirent à les secouer, à les appeler. Les moribonds durent désigner ceux qui pouvaient vider leur bol. Mais la curée n'était pas finie car, sur les étagères, il restait un peu de pain du matin auquel s'ajouteraient les miches du soir, les bols de soupe fraîche que les camarades iraient chercher pour les moribonds et peut-être une cuillerée de confiture, un morceau de boudin. Une bouchée supplémentaire pouvait être espérée, car dès que l'un ou l'autre aurait cessé de vivre, la nourriture abandonnée était partagée entre les vivants... André, resté à l'écart des compétitions de nourriture, travaillait à rendre une forme à sa paillasse. -
André ! André ! appelait faiblement Jean,
l'un des malades. - André ! Jean t'appelle, cria un forçat. André se retourna et comprit. Le pauvre Jean, oppressé à l'extrême, ne vivrait plus longtemps. Prenant un minuscule crayon caché dans la doublure de sa veste et un morceau de papier, André s'assit auprès du moribond : - André, écoute... N'écris pas, c'est inutile... Tu diras à Claire que je l'ai toujours aimée et qu'elle est encore tout au monde pour moi. Je t'ai donné son adresse, tu iras la voir et tu lui diras que si parfois mon caractère l'a fait souffrir, je le regrette beaucoup. Je l'ai peut-être mal aimée, mais je l'ai aimée de tout mon cœur... Tu me comprends, n'est-ce pas ? Nous autres, hommes, nous sommes parfois si injustes envers notre femme et cependant nous l'aimons ! Tu lui diras aussi qu'elle veille sur les enfants. Les aînés sont en âge de se tirer d'affaire. Mais le petit de dix ans que nous ne voulions pas... Insiste pour qu'elle lui montre le chemin de Dieu... Il n'y a que cela qui compte. Il faut qu'elle soit ferme avec le petit, qu'elle ne lui passe pas ses caprices, qu'elle en fasse un homme... Excuse mon émotion... Inutile de lui parler de notre saleté, de nos figures jamais rasées, de nos poux, des coups... Tout cela est la part du Bon Dieu... Mais répète à ma femme que tous les jours ma pensée était près délie et que de mes souffrances, de mes privations, je faisais une prière pour qu'elle reste la joie de la maison... Dis-lui qu'elle m'a rendu heureux. Elle n'a pas assez d'argent pour vivre sans travailler. Nous n avions as de dettes... Les aînés devront l'aider. Il y a encore ma vieille maman ! Je l'ai vue pour la dernière fois dans le parloir à la prison de la Citadelle, à Liège, le lendemain de ma condamnation à mort... Elle pleurait... Il faut que Claire soit bonne pour maman. Dans la souffrance, les femmes se comprennent; c'est moins dur alors pour elles... . Jean, épuisé, se tait. Ses yeux tristes, tournent, chavirent. Il voudrait peut-être encore dire quelque chose mais une toux affreuse le secoue. A côté du moribond, la vie continue. Les prisonniers mangent, les uns attablés, d'autres assis sur leur paillasse. Le gardien a permis à trois hommes de se présenter à la soupe pour les malades. Trois bols sont maintenant déposés sur la table devant eux. Jean appelle encore, mais plus faiblement : -
André ! Mais les gardiens, ce soir, sont pressés : un déclic et la chambrée est dans l'obscurité. Jean répète, en pressant la main d'André : - Tu diras à Claire que je l'aimais... A Antoine et Pierre qu'ils sont ma fierté... Tu embrasseras mon petit Paul... La nuit avance. Peu à peu, les forçats s'endorment. André, qui travaille dur à l'atelier, finit par s'assoupir. Il n'entend plus Jean qui, le tenant encore par la main, parle de plus en plus faiblement : - Tu n'oublieras pas de dire à Claire... Au réveil, quand la lumière s'allume, Jean paraît dormir. Ses yeux sont fermés pour toujours. Au bord des paupières, quelque chose brille : une dernière larme. Sur la table, le bol de Jean est vide. Sur son étagère, il n'y a plus de pain. Quelqu'un n'a pu résister à l'obsession de la nourriture et, dans l'obscurité... * * * En arrivant à Sonnenburg, en octobre 1943, je me trouvais parrmi de vieux "rats" de prison, totalisant, chacun, de vingt-quatre à trente mois de captivité. Une hiérarchie, d'apres l'anciennité, s'établissait spontanément. Mais en l'espace de quelques mois, la mort l'avait bouleversée. Le nombre de prisonniers restait toujours pareil, mais ils étaient renouvelés continuellement. Ainsi, les ravages de la mort ne se voyaient pas au premier abord; mais quand à la chambrée, à l'atelier ou au cours de la promenade, nous cherchions à retrouver les amis du début, nous n'apercevions plus guère que de nouveaux visages. La mort était partout. Le matin, un dormeur que nous tentions de réveiller à l'approche du gardien, avait cessé de vivre. Le soir, des camarades agonisaient dans les chambrées. Un forçat s'affaissait en plein travail, avec un bruit sourd. Cent cinquante hommes mouraient chaque mois. Ils mouraient pendant la promenade, dans les escaliers, sur les tinettes. En janvier-février 1944, lors d'épidémies plus violentes, huit cercueils étaient alignés chaque matin devant l'infirmerie. Les Allemands avaient peur des morts. Ils mettaient un masque et des gants de caoutchouc pour transporter les cadavres. Mais s'ils avaient un mépris total du prisonnier vivant, le forçat mort devenait, pour eux, un objet tombant sous l'application des ordonnances de récupération. Les dentiers, les dents en or, tout le linge étaient enlevés. Le cadavre, dépouillé de tout, était déposé sans linceul dans une caisse remplie de sciure de bois... Tant de misères, dont j'ai été témoin, soulèvent encore en moi d'épouvantables rancœurs et j'ai, plusieurs fois, voulu déchirer ces notes, me trouvant incapable d'exprimer tant d'horreurs. Les mots ne peuvent faire comprendre ce que furent nos peines, notre écœurement, notre désespoir... Une voix amie qui, brusquement, se taisait, des yeux naguère brillants qui se ternissaient et se fermaient, nous laissaient chaque fois anéantis, sanglotants, haletants d'une souffrance atroce qui eût fait rire nos gardiens haineux, menaçants, témoins réjouis de nos peines et de notre déchéance. Avec un morceau de miroir placé sous le nez ou devant la bouche du malheureux, nous cherchions à savoir s'il respirait encore. Quand aucune buée n'apparaissait, nous alertions le gardien en tirant une sonnette réservée aux cas graves : décès, incendies, batailles... Les gardiens ne se pressaient guère et sonner une seconde rois eut risqué de déchaîner des violences. Nous attendions alors et partois longuement. Le gardien de l'étage prévenait le service sanitaire : deux infirmiers emportaient ns morts en riant, balançants le brancard, sifflotant, chantonnant, esquissant des pas de danse, faisant des plaisanteries répugnantes. Les Allemands partis avec leur charge, les prisonniers hurla.ent de fureur Puis le calme, un peu revenu, un camarade demandait un moment de recueillement pour celui qui venait de mourir. L un des plus âgés d'entre nous se signait et commençait : « Notre Père qui êtes aux cieux... » En prononçant avec lui les paroles de la prière, nous cherchions peu à peu à nous ressaisir et à calmer notre rage éperdue. Et la gorge serrée mais le cœur apaisé, nous pouvions achever : « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons... » Nous ne pouvions oublier nos morts, camarades auxquels nous avions serré la main, amis dont nous avions écouté les dernières volontés. Leurs adieux ou leurs dernières volontés prononcés d'une voix de plus en plus faible, témoignaient de pensées de tendresse que les longues séparations et les souffrances n'avaient pu détruire. En mourant, ils balbutiaient encore le nom d'une épouse, d'un enfant auxquels ils n'avaient jamais cessé de penser; ils appelaient, avec angoisse, leur mère ou leur père ! Malgré l'ignominie de nos chambrées, la mort d'un compagnon avait une grandeur imposant le respect et le recueillement. Les pauvres corps, les uns presque desséchés, les autres déjà à demi-couverts de plaie et de pourriture, avaient, cependant, une sérénité émouvante. La paix, qui n'est pas de ce monde, « la Paix du Seigneur » les couvrait d'une étrange majesté. La mort de mes amis me bouleversait. Dans la solitude de la nuit, pendant le sommeil de mes voisins, je pouvais donner libre cours à ma peine et je pleurais amèrement. A ce moment, je n'avais plus à me contenir, à chercher à aider mes camarades par un exemple, un encouragement. Seul, tout seul dans l'obscurité, j'éprouvais une peine torturante dont, demain déjà, la plupart de mes compagnons n'auraient aucun souci : les camarades de la chambrée n'étaient pas ceux de l'atelier; nos peines n'étaient pas les mêmes. * * * Je fis la connaissance de Paul Hoornaert le premier soir de mon arrivée à Sonnenburg. Nous couchions sur la même paillase et nous nous lavions dans la même eau. Pendant quelques jours, il fut mon compagnon de travail à l'atelier de la ficelle et, peu à peu, je m'attachai à lui. Les forçats se liaient ainsi au hasard d'une conversation, rapprochés par une éducation analogue, des principes pareils, une estime et une sympathie réciproques et le sentiment si réconfortant de pouvoir parler en confiance. Il était entouré chaque soir d'un petit cercle d'amis qui causaient longuement dans l'obscurité. Paul Hoornaert parlait souvent de son foyer, centre de ses préoccupations. Il commençait toujours par la même phrase : - Mes amis, il est entre sept et huit heures... En ce moment, ma femme est à table... Puis, comme pour s'arracher à un rêve, il me disait : - Et toi ? Que se passe-t-il chez toi maintenant ? Il savait que je pensais toujours aux miens. Je revoyais ma maison, je franchissais la grille, j'entrais et surprenais ma femme et mes enfants au milieu de leur repas... Passant dans mon bureau, je jetais un regard sur la bibliothèque, sur mes livres préférés que je comptais relire après ma libération, sur mes porcelaines et mes gravures. Mes souvenirs étaient clairs et joyeux. Je ne savais pas les inquiétudes et les souffrances des miens : la disette, le manque de charbon, les déportations des jeunes, la Gestapo... Hoornaert se rendait vite compte de l'état du moral de ses amis. Quand il nous voyait trop attristés, il faisait aussitôt diversion par des anecdotes ou des chansonnettes dont nous reprenions en chœur le refrain. Il finissait toujours par faire renaître le sourire sur les lèvres et le courage dans les cœurs. Intelligent, aimant discuter, il s'acharnait à ramener à Dieu ceux qui s'en étaient éloignés. En février 1944, depuis quelques jours, il toussait sans arrêt. Plutôt que de stationner dans le froid devant l'infirmerie et faire la queue durant des heures, il prenait son mal en patience et continuait son travail à l'atelier. Ses joues en feu, ses yeux brillants nous inquiétaient et noi insistâmes pour qu'il allât chez le médecin. A la longue, Hoornaert accepta. Mais le médecin, sans même l'examiner, l'engueula copieusement et, pour comble, lui infligea trois jours de cachot pour s'en présenté indûment à la visite. Au soir de cette même journée, il rentra en chambrée profondement abattu, brûlant de fièvre, secoué de frissons. N'ayant aucun médicament, nous ne pouvions que l'aider à boire sa soupe très chaude. D'heure en heure, le mal empirait. Hoornaert passa une nuit affreuse avec des étouffements, des angoisses abominables. Le matin, j'alertai l'infirmier qui, cette fois, consentit à le soigner à l'infirmerie. Péniblement, à pas traînants, je l'ai mené à l'infirmerie. Là, je l'ai installé sur une paillasse restée libre, à terre, parmi d'autres malades. Nos adieux furent brefs : une poignée de main, un regard et le détournement brusque du visage pour ne pas laisser voir nos larmes. Le lendemain, au préau — situé entre notre bâtiment et l'infirmerie — je m'efforçai d'interroger les malades postés aux fenêtres. L'un d'eux m'entendit, gesticula, cria quelques mots. Je compris que notre ami Paul Hoornaert était dans un des cercueils rangés sur le sol devant lesquels nous passions et repassions... * * * Au début d'octobre 1943, le surveillant de l'étage, pour un motif dont j'ai perdu le souvenir, m'avait privé de promenade et infligé la corvée de tenir sous le tuyau de la pompe plus de deux cents brocs destinés aux chambrées et aux cellules. Celui qui pompait sans discontinuer était aussi puni. C'était un homme grisonnant, paraissant peiner et s'épuiser à ce travail. Je lui proposai de changer de place et de le relayer. - Vous êtes Français ? C'est ainsi que je fis connaissance de M. Le Bas, ministre du Cabinet Reynaud qui, avec son fils, était parmi les prisonniers de Sonnenburg. M. Le Bas exerçait un ministère de charité et de bonnes courageuses. Il assistait et soutenait tous ceux qui l'approchaient. Avec une sévérité inflexible, les Allemands l'avaient séparé de son fils qui travaillait dans un autre atelier et dormait dans une autre chambrée. Ne s'attardant pas sur les avanies que lui infligeaient les Allemands, il restait stoïque, d'humeur égale malgré la faim, le froid, la fatigue, la misère. Avec l'autorité de sa situation d'autrefois, il pourchassait les pessimistes, les semeurs de mauvaises nouvelles, annonçait victoires, succès, prédisait la fin prochaine de nos maux et trouvait, dans le moindre événement, des raisons de nous obstiner dans notre confiance. Le Bas, N.N. comme nous, restait, bien entendu, pour tous « Monsieur le Ministre », car à Sonnenburg les valeurs individuelles existaient encore en dépit de la rage niveleuse des Allemands. Lorsqu'un gardien surprenait l'un de nous s'effaçant et disant : « Passez, je vous prie, Monsieur le Ministre » ou bien « A vous d'abord », une volée de coups ne manquait pas de suivre... Depuis quelques temps, je remarquais que M. Le Bas était malade et s'affaiblissait visiblement, bien qu'il conservât tout son tempérament de lutteur et sans jamais se plaindre. En février 1944, il dut s'avouer exténué et demanda la visite du médecin. Il en revint avec l'autorisation de quelques jours de repos. Un gardien le ramena en chambrée. Là, M. Le Bas s'assit à la table et s'endormit. Il ne se réveilla plus. Ses camarades revenant des ateliers le trouvèrent mort. Ils coururent dans la chambrée voisine avertir son fils qui ne put revoir son père : les Allemands, impitoyables, lui barrèrent le passage. Mais le lendemain, au préau, le malheureux fils, en suivant le cercle de la promenade, côtoyait à chaque tour quatre caisses noires aux planches mal clouées. Quatre N.N. y gisaient. L'un était probablement son père. * * * J'avais rencontré, dans le taudis de l'atelier de la ficelle, le colonel de la Rochère, âgé de soixante-douze ans, sympathique et parfaitement distingué. Il prêchait la patience et montrait l'exemple. Ses compatriotes bretons chuchotaient entre eux : « C'est un vrai comte". Les Parisiens disaient de lui, avec une certaine admiration du faubourg faubourg Saint-Germain ». Un jour, les Allemands déclarèrent une guerre acharnée aux poux dont nous étions couverts et qui les avaient sans doute attaqués eux-mêmes. Quiconque se grattait, passait séance tenante à la désinfection. Etre livrés aux infirmiers, à leur brutalités, à leur cruauté, n'était pas peu de chose. Après quoi, propres, désinfectés, bien savonnés, les épouillés rentraient dans leur linge et leurs uniformes non désinfectés et retrouvaient les poux, heureux de se repaître d'une peau rafraîchie. Nos gardiens, en état d'alerte continuelle, remarquèrent que le Colonel de la Rochère se grattait la tête, les bras, les jambes, et l'expédièrent sur-le-champ aux infirmiers. Ce fut d'une cruauté atroce ! Sans égard à l'âge avance du colonel, il fut déshabillé en plein air — il gelait dix à quinze degrés sous zéro. Le vieillard fut badigeonné de corrosif puis, sous prétexte de rinçage, les infirmiers jetèrent sur lui des seaux d'eau froide. Après quoi, ils le plongèrent dans une baignoire d'eau glacée. Le colonel de la Rochère mourut le surlendemain. Malgré les souvenirs obsédants des malades, de leur agonie et de leur mort, je garde cependant un souvenir de joie, une sorte de trêve au cours de notre bagne. Noël, que l'administration de la prison avait rayé du calendrier, fut célébré ardemment, en 1943, par les quarante forçats de la chambrée encore au complet. Nous avions préparé la fête avec des moyens de fortune. Murs ornés de branches de sapins et de bandes de papier sur lesquelles nous avions inscrit, en français, néerlandais, norvégien, des souhaits de joyeux Noël et d'une prompte libération. Nous avions fait une crèche avec personnages et animaux. Quelques camarades avaient fabriqué des bougies et rapporté des allumettes. La première partie de la nuit fut très morose. Des bobards fantastiques avaient annoncé un menu spécial pour la veillée. On parlait d'une double ration et d'un tas de bonnes choses qui avaient fait venir l'eau à la bouche. Le soir, chacun ressentit un même désappointement devant un souper aussi maigre que les autres. Mais, vers m>nuit, les forçats se relevèrent pour s'unir dans une prière commune. L'un d'eux fit la lecture de la messe. Beaucoup, à ce moment, en découvrirent avec émotion le véritable sens. Les Norvégiens psalmodièrent très harmonieusement, puis entonnèrent un Noël sur la mélodie de Stille Nacht. Le plus militant de nos communistes, d'une voix basse et vibrante, chanta le Minuit Chrétiens et nous reprîmes, en chœur, comme un cri d'espérance, Peuple à genoux, attends ta délivrance... D'autres chantèrent encore l'Adeste fidèles, Puer nobis nascitur, des noëls, des chansons de Botrel. Quand nous fûmes à bout de ressources, Hoornaert organisa une séance du Chat Noir, lançant des chansonnettes dont les refrains étaient joyeusement repris par la chambrée. Il y mit tant d'ardeur qu'il entraîna tout le monde. Chacun voulait, à son tour, dire un monologue ou « pousser » sa chanson. Notre ami Vermeulen, d'Amsterdam, récita, en néerlandais, quelque chose qui devait être du plus haut comique, car il s'amusait énormément. Clément Macq, sur l'air de La Petite Tonkinoise, de Mayol, ranima une vieille rangaine de 1914 : La Mitrailleuse. Les Norvégiens récitèrent, en leur langue, des poèmes. Nous eûmes aussi un réveillon. Des prisonniers avaient rapporté, des cuisines, quelques carottes crues. Elles furent découpées en rondelles et partagées. J'en reçus deux pour ma part. Elles me parurent aussi délicieuses que la dinde de jadis. La fête nous tint jusqu'au matin. Au loin, les nôtres pensaient à la tristesse d'un Noël dans les bagnes alors que la Paix du Seigneur était venue réchauffer nos cœurs et soulager pendant quelques heures la dureté de notre existence. Dans les ateliers et chambrées que j'ai connus, la note dominante était la charité. Elle s'exerçait sans distinction. Le service gratuit était à l'honneur. Les forçats partageaient leurs couvertures de laine avec ceux qui n'en avaient qu'en coton. Ils aidaient les malades comme ils pouvaient. Si l'un d'eux tombait, pris de syncope, ils se précipitaient pour le secourir. Ils aidaient un éclopé à monter un escalier, entouraient les moribonds et fermaient pieusement les yeux des morts. Même une peine lourde s'allégeait souvent par la sympathie d'amis. A Sonnenburg, les prisonniers n'étaient pas indifférents l'un à l'autre. Arrivé depuis quelques jours, mon voisin de lit, André Thielemans, que je ne connaissais pas précédemment, me vit grelotter et me donna spontanément son tricot. Dans la détresse vestimentaire de la prison, son geste était réellement héroïque. Quand au milieu de compagnons de chambrée atteints de grippe infectueuse et de pleurésie, je luttais contre la mort, mes amis André Thielemans, Clément Macq, Paul le Grand se portèrent malades our obtenir, de l'infirmerie, de l'aspirine. Ils faisaient des stations de deux et trois heures pour se plaindre d'un mal imaginaire. Il leur fallait une réelle habileté pour retirer de la bouche le comprimé q^ue le chef infirmier cherchait à leur faire avaler sur place. Et le soir, après le travail, ils rentraient, heureux de pouvoir m'apporter quelques comprimés, brisés, imbibés de salive, mais infiniment précieux. C'est à leur charité que je dois d'être sorti vivant de Sonnenburg, le tombeau de tant de camarades. Les privations avaient tant affaibli les jeunes gens de l'âge de mes enfants que la moindre maladie les tuait. Les travailleurs du mica s'unirent pour les aider : une fois par jour, ceux de plus de vingt-cinq ans donnaient à leurs camarades moins âgés une cuillerée de soupe ou une pomme de terre, suivant les possibilités. Dans l'atelier, un prisonnier passait parmi ses camarades et récoltait, dans un bol, ce que chacun abandonnait de sa propre ration. Sur les cent dix travailleurs, plus de vingt-cinq jeunes gens bénéficiaient ainsi chaque jour d'un demi-litre de nourriture supplémentaire. Pour soutenir un convalescent reprenant son travail et hâter sa guérison, nous lui donnions chacun un peu de margarine. Des camarades revenaient ainsi à la vie; leurs visages perdaient peu à peu le masque de la mort qui les marquait. J'ai signalé la visite inattendue d'un aumônier allemand aux agonisants de ma chambrée. Ce fut un cas unique, car pour nous, pnsonniers politiques, tous les exercices du culte, les livres et objets de piété étaient proscrits. Les gardiens y veillaient farouchement. Les bibles et missels étaient confisqués; un chapelet, une croix trouvée sur l'un de nous au cours d'une fouille, étaient brisés, piétinés. Le personnel infirmier, recruté parmi les prisonniers de droit commun, s'acharnait à découvrir les médailles suspendues au cou des malades et à leur arracher. Les Allemands ne cédaient pas et rien, pas même les dernières heures de la vie d'un N. N., ne faisait fléchir leur abominable haine. Un moribond était laissé à lui-même dans un abandon total, sans secours religieux. A l'époque du Ramadan, un camarade Algérien avait fait des invocations à haute voix; il fut rossé par les gardiens. Mais, en dépit de la guerre à toutes les religions, une vie spirituelle clandestine mais intense, rayonnait dans beaucoup de coeurs : foi, idéal patriotique, charité, apostolat. Et si nos corps amenuisés par une misère continue, s'acheminaient vers la mort, nos âmes, du moins, montaient jusqu'à des cîmes jamais atteintes auparavant. Cette vie spirituelle se manifestait dans les ateliers de récupération, moins surveillés que les autres : les forçats se groupaient discrètement dans quelque coin pour prier. Parfois, paraissant céder à la fatigue, le prisonnier se cachait le visage entre les mains : il priait et parlait à Dieu pendant quelques instants. Au cours de la promenade, l'approche des fêtes de Noël, du Carême, était annoncée par des antiennes fredonnées ou sifflotées, d'un cercle de promeneurs à l'autre. Témoignaient aussi de cet esprit religieux les pauvres et innombrables bricolages de chapelets, de petites croix fabriquées sous cape avec des moyens de fortune et que tant de prisonniers avaient acquis de leurs camarades au prix de leur ration. Là où contremaîtres, gardiens, Kapos, conjuguaient leurs efforts pour intensifier le travail, les moments de recueillement ne pouvaient plus guère s'intercaler dans la journée. Nos prières n'étaient plus que patience, attente confiante, soumission. Mais le soir enfin venu, nous pouvions prier sur notre paillasse avec des amis; le dimanche, nous faisions même parfois la lecture de la messe, car j'avais un missel et vespéral que je rapportais chaque soir dans la chambrée. Ce livre avait toute une histoire : un des voleurs les plus notoires de Sonnenburg me le céda en échange de pain. Il prétendait l'avoir pris à des infirmiers qui l'avaient confisqué à des malades. Un camarade d'atelier, frère de la Doctrine Chrétienne, le frère Paul, en revendiqua la propriété, assurant que le livre lui avait été vol par un Kalfa. Le frère lui-même l'avait acquit d'un autre voleur en échange d'un morceau de pain. Après discussion, nous décidâmes d'en faire profiter tout le monde. Le matin, j'étais le premier à m'en servir, puis je le passais de banc en banc. L'après-midi, le livre rejoignait le frère Paul et ses camarades, pour me revenir, enfin. Cet arrangement fut de peu de durée : un certain jour, pendant que nous étions au préau, les gradés inspectèrent les bancs de travail. Dans leur butin se trouvait le missel dont la privation me parut une catastrophe... Je pus quand même me souvenir et transcrire sur des feuillets de papier pour les camarades, les prières de l'Offertoire et du Canon, que je récitais chaque jour en union avec la messe célébrée dans l'église où, jadis, j'allais chaque matin avec mes enfants qui devaient, à ce moment, s'y trouver. Parfois, parmi les N. N. nouvellement arrivés et prisonniers comme nous, nous découvrions — événement rare et bien émouvant — un prêtre ! Sa présence était partout signalée, son passage guetté. Il subissait l'assaut incessant de ses camarades, avides d'entendre des paroles de paix, d'espérance, d'apaisement. Lorsque l'abbé Voordeckers fut envoyé à l'atelier de la chaussette, les travailleurs occupés à la récupération des ficelles et installés dans le même local, quittaient leur travail pour se rapprocher de lui. Pour ne pas attirer l'attention des gardiens, ils ravaudaient. De même dans l'atelier de l'A.E.G. où nous clivions le mica, communistes, mécréants, athées se disputaient le voisinage de l'abbé Vallé. En échange de ses bonnes paroles, ils se chargeaient de faire sa besogne. Que de confessions, que d'apaisements, que d'actions de grâce^ que de joie dans nos cœurs par l'action des prêtres, envoyés providentiels du Seigneur. * * * J'ai quitté Sonnenburg assez brusquement. Une nouvelle bizarre avait circulé parmi les prisonniers. Un gardien, assurait-on, aurait dit que l'administration de la prison envisageait de réduire le nombre des bagnards dans la prison surpeuplée. Cette possibilité, pareille à tant de bobards déjà entendus, ne m'émut pas. Quelques jours après, le directeur de la prison, accompagné d'un état-major de scribes, vint à l'improviste à l'atelier. Il sépara le condamnés à mort des autres et fit pointer leur nom. Le lendemain, au moment du rassemblement pour le travail un gardien m'appela. J'étais désigné pour un « transport ». Je me trouvais séparé de mes compagnons et de mes amis partis au travail, sans avoir pu leur dire un mot d'adieu. Avec soixante-dix autres partants, pour la plupart des condamnés à mort, nous fûmes dirigés vers la gare après avoir endossé nos vêtements civils. Je ne devais plus revoir mes camarades de Sonnenburg qui, un à un, furent tous assassinés par les S. S. au moment même où les Russes, en avril 1945, forcèrent les portes de la prison pour les libérer.
La prison des exécutions à la guillotine Le 15 mars 1944, nous étions alignés le long d'une voie dans la gare de Sonnenburg. Sur le quai, en face, des voyageurs virent, au déploiement de schupos et de gardiens, que nous sortions de la prison. Notre air misérable, cadavérique, nos visages dépenaillés provoquèrent l'indignation. Des femmes s'attroupèrent, invectivant contre les gardiens, leur montrant le poing, criant : « A bas la guerre » ! Quelques-unes, ne pouvant contenir leur émotion, pleuraient; d'autres nous jetaient du pain et des fruits. Les hommes, prudemment, s'étaient écartés et s'abstenaient de toute manifestation. Nous fûmes poussés dans un wagon aux fenêtres grillagées. Nous étions six par banquette. La portière du couloir devait rester ouverte; il nous était interdit de quitter notre compartiment. Le train se mit en marche. Le wagon était surchauffé. Par les vitres couvertes de buée, nous devinions une tempête de neige. Le convoi reprenait longuement haleine à toutes les gares : Custrin, Francfort s/Oder, Kottbus, Halle, Magdebourg, Brunswick. Dans l'état de faiblesse où nous nous trouvions, l'immobilité, les cahots pendant d'interminables heures, finissaient par causer une réelle souffrance. Nous n'avions aucun souci du parcours ni de notre destination et nous avions été ravitaillés. Rompus, brisés par une immobilité forcée de quarante-huit heures consécutives, en nage par l'excès de chauffage, notre souffrance était devenue trop forte pour nous permettre de dormir. Je rêvais de somnifère, d'anesthésique, de chloroforme. A la fin de la deuxième journée, vers dix heures du soir, le train s'arrêta. Deux camarades s'étaient allongés dans le filet, un autre à terre. Quatre sur une banquette, cinq sur l'autre... L'arrêt fut interminable. Finalement, nous entendîmes des pas sur du gravier, un attroupement, des voix. Les gardiens, qui avaient dormi, bondirent aussitôt, commencèrent à crier et nous firent descendre sur un quai. Dans le brouillard, j'aperçus des soldats; la lumière rouge d'un sémaphore. Un peu de neige subsistait. En avançant, je distinguai au delà des voies, une route et des arbres. Nous arrivâmes devant la gare, semblable à nos petites stations de banlieue. Sur l'auvent était inscrit Wolfenbüttel. Des lampes voilées laissaient filtrer un peu de lumière; une horloge marquait cinq heures. Le convoi de prisonniers regroupés, mis en rang, attendit... L'attente parut plus longue qu'elle ne l'était. Dans mon costume civil je ne devais guère paraître élégant. Une matinée entière dans mon atelier des tailleurs n'eût pas suffi à rajuster le gilet et le veston devenus trop larges. Après la chaleur suffocante du voyage, en plein air, sans manteau ni tricot, je grelottais. Enfin, l'ordre de marche : — Vorwàrtz ! Marsch !... Links um... Rechts um... (en avant ! Marche ! gauche... droite...). * * * Dans la lumière pâle du jour naissant, une troupe de civils encadrés de soldats, passe dans des rues bordées de maisons de bois aux sculptures curieuses et fouillées, aux pignons peints. Un vieux château, couleur de rouille, une église du XVe siècle, paraissent, dans la froide majesté de leurs pierres, hautaines et méprisantes envers le cortège des boiteux, des éclopés, des rebuts d'humanité défilant à leur pied. Costumes d'été, combinaisons de mécaniciens, pantalons de velours de terrassiers, agents de police coiffés de casques, officiers de gendarmerie, marins, bourgeois en chapeau melon ou feutre déformé, donnent un aspect burlesque à la caravane. Le pas cadencé commandé par les Allemands n'est observé par personne. Les uns, traînant la jambe, se laissent distancer; d'autres tombent évanouis, provoquant arrêts et perturbation dans les rangs. Une auto prend les éclopés et les malades. Les gardiens rugissent, courent, se démènent, cherchent en vain à rétablir l'ordre dans le groupe des prisonniers épuisés... Dans une rue étroite, une grande porte est ouverte. Nous y entrons, passant devant un édifice sombre. Les fenêtres sont grillagées. Des nommes, en uniformes verts et casquettes plates, montent la garde : c'est la prison. Nous sommes arrivés à destination. En pénétrant dans le bâtiment central, j'y retrouve tout de suite un décor familier : portes numérotées percées d'un judas, lanterneau éclairant des galeries en étage. Des Kalfas s'affairent avec seaux et brosses. Tout en nettoyant, ils nous observent. Le cortège monte directement au premier étage où l'ordre est donné de nous arrêter deux par deux devant les cellules. J'entends le bruit familier d'un trousseau de clés. Un gardien s'avance, ouvre les portes, pousse les prisonniers dans les cellules qu'il referme. L'ambiance de Saint-Gilles revit... Ma première impression de la cellule ne fut pas trop mauvaise. Etroite, faite pour une personne, elle était propre, les murs blanchis et, chose inattendue, elle était munie d'un robinet d'eau courante et d'un W.C. Une grande fenêtre aux carreaux bien nettoyés l'éclairait largement. Un lit de fer avec matelas en « galette » pouvait se rabattre contre le mur durant la journée. Une paillasse, pour le second occupant, était étendue à même le plancher. Deux tabourets permettaient de s'asseoir. Près de la fenêtre, suspendue au mur, une petite armoire à deux compartiments. A l'intérieur, un dessin indiquait la place réglementaire de tout le fourbi du prisonnier : vaisselle, couverts, objets de toilette, peigne, brosse à dents, pantoufles, etc. Les Allemands avaient simplifié les choses en nous remettant en tout et pour tout un bol et une cuillère. Bientôt la porte s'ouvrit. Des Kalfas surveillés par
des gardiens nous apportaient un repas. La direction de la prison semblait
- chose étonnante - nous réconforter dès notre arrivée. Préparée avec
soin, la soupe sentait bon le céleri. Elle n'avait pas cet éternel gôut de
cumin, comme celle de Sonnenburg. Mon appétit en était aiguisé; en
rincant mon bol, je pensais avec envie à une seconde ration... —
Für Leute wie sie, Scheisse ist noch genug... (pour des gens de votre
espèce, la m... est encore de trop).
Sans me soucier de ces interventions successives et
contradictoires, je passai cette première journée à dormir presque tout le
temps. Je
ne tardai pas a découvrir qu'en Allemagne, comme en Belgique, les
prisonniers en cellules parvenaient a communiquer entre eux. J'entendis
quelqu'un frapper de petits coups sur un gros tuyau tra-versant la cellule
du haut en bas. Le son venait de l'étage sous le nôtre. —
Qui êtes-vous ? … Les pas d'un gardien résonnaient sur les dalles du rez-de-chaussée. Après le repas, l'appel fut de nouveau lancé. Sterckmans, couché a terre, frappait des « brèves » et des « longues » sur le tuyau pendant que moi, debout, la tête contre le judas, j'empêchais tout regard indiscret de l'extérieur.
— Etes-vous grâciés ? * * *
La prison de Wolfenbüttel était une ancienne abbaye.
Les murs, d'époque médiévale, avaient plus d'un mètre d'épaisseur. Les
fenêtres à croisillons étaient traversées par de gros barreaux rouillés.
Jadis pénitencier, maison de redressement d'une extreme rigueur, destinée
aux condamnés de droit commun, récidivistes ou asociaux, la prison avait
reçu en outre, depuis ll'avènement d'Hitler, des antinazis. * * * Le lendemain de notre arrivée, les Allemands répartirent dans des ateliers. Le contingent venu de Sonnenburg, a l'exception des prisonniers dont les fiches mentionnaient une condamnation a mort : ceux-ci furent maintenus en cellule. Les gardiens ne comprenaient pas pourquoi Sonnenburg avait envoyé des condamnés à mort alors que Wolfenbüttel avait demandé de la main-d'oeuvre pour ses ateliers et non pour autre chose. Car, à Wolfenbüttel, le condamné a mort restait en cellule au secret et à la chaîne jusqu'au jour de sa grâce ou de sa mort. Directeurs et gardiens marquaient leur étonnement de notre venue. lls nous deman-daient fréquemment avec une réelle curiosité : —
Pourquoi ne vous a-t-on pas exécutés ?... Qu'attend-on pour le faire ?
Avez-vous introduit un recours en grâce ? —
Si tu tiens le coup, tu rentreras chez toi.
Entre-temps, mon camarade et moi, complètement abandonnés
en cellule, nous nous retrouvions désoeuvrés, totalement inactifs, aux
prises avec l'ennui pendant d'interminables journées. Notre situation
était si pénible que nous fûmes heureux, une dizaine de jours plus tard,
d'apprendre que des instructions de Berlin nous mettaient au régime
des travailleurs. Nos vêtements civils furent remplacés par un uniforme.
Ce changement me fit de la peine; je m'étais de nouveau attaché a mes
objets personnels restitués à Sonnenburg au moment de notre départ : un
missel, un chapelet, une croix, une montre, souvenirs de ma femme.
J'essayai, mais en vain, d'en garder au moins une partie. Malgré mes
tentatives de dissimulation, tout, absolument tout, me fut enlevé par les
Kalfas — des Belges et des Francais — plus fins limiers que les gardiens.
Condamnation.....Z. T. (Zum Tode)
De
l'ancienne abbaye, il subsistait encore deux des locaux jadis réserves au
culte. Une
crypte au rez-de-chaussée et, au-dessus, une chapelle aux voussures
ogivales élevées, éclairée par de larges vitraux. Nous y accédions par le
palier du premier étage de la prison. Mais les deux locaux avaient été
aménagés en ateliers pour les N. N. Deux cents forcats y travaillaient a
des appareils d'optique pour la Société Voigtlander. Les pièces usinées dans la crypte étaient ensuite ajustées et assemblées dans la chapelle. Une doublé rangée de dix bancs de travail y remplacait les bancs d'église. A droite se fabriquaient des instru-ments de marine et d'artillerie; à gauche, les jumelles de l'armée. L'autel avait été enlevé du choeur, surélevé de quatre marches, ou contremaïtres et gardiens installés devant les tables nous surveillaient facilement. Une cloison séparait le choeur d'une chapelle laterale transformée en deux W.-C, l'un pour nos « maïtres », l'autre pour nous. Le jubé était encombré de caisses et de matériel dont émergeaient des tuyaux d'orgue. Les instruments fabriqués étaient controlés dans la prison par une commission de l'armée aidée de quelques prisonniers. En dehors de ces deux ateliers, cinquante N. N. étaient employés en équipe pour des travaux de maconnerie et de terrassement dans l'enceinte de la prison. LE TRAVAIL
Pendant les treize mois passés a Wolfenbüttel, j’ai
travaillé dans l’ atelier des jumelles. Nous étions cinquante, cinq par
banc.
Les premiers préparaient le travail, triant, nettoyant les
pièces. Le montage des jumelles se faisait sur les sept bancs suivants. Au
dernier, le plus proche du choeur, se faisaient le demontage des jumelles
défectueuses ou détériorées et les réparations. * * *
Les heures
de travail étaient réglées par les ordonnances sur la mobilisation
générale de la main-d'oeuvre; la nourriture, l'hygiène, le repos, par les
réglements nazis.
Nous souhaitions tous être inscrits sur la liste des
contremaîtres car la matinee du dimanche dans les ateliers était une
réelle diversion.
Pas de nettoyage de légumes d'abord.
Ensuite, pas de gardiens et donc guère de travail.
Quelques prisonniers,
figaros d'occasion, rasaient leurs camarades ou leur coupaient les cheveux,
tandis que les contremaîtres lisaient leurs journaux au son de la radio. A dater de cette époque, notre situation empira tragiquement. Mos dernières forces déclinèrent, nos corps de déshydratèrent et maigrirent à vue d’oeil. Le nombre des malades se multiplia et la mortalité devint inquiétante.
Les gardiens, à Sonnenburg, avaient le type
asiatique.
Ceux de Wolfenbüttel étaient de la quintessence d'Allemand. lls
étaient serrés dans leur uniforme, l'arrière-train rebondissant. Leurs
bottes, cein-turons, baudriers étaient bien astiqués.
Leur
casquette s'enfoncait dans un cou a bourrelets; leurs cheveux étaient
rasés au demi-milli-mètre, à la prussienne. Vers la fin de l'année 1944, les contremaîtres, non contents de faire réparer des bijoux et des réveils-matin, organisèrent le dépannage d'appareils de radio. Deux ingénieurs belges, parmi lesquels Philippe le Grand, furent mis a cette nouvelle besogne. Le nombre d'heures employées pour effectuer cette réparation dépendait curieusement de la qualité des appareils. Quand un contremaître apportait une vieille radio démodée, la remise en état se faisait sur l'heure. Mais quand nos amis devaient manipuler un appareil a lampes multiples, doté des derniers perfectionnements, la réparation prenait plusieurs jours. Sous prétexte de mise au point, les deux ingénieurs, coiffés de leur casque d'écoute, captaient les communiqués de la B.B.C. et, en dépit de risques graves, nous les répétaient. Nous leur en étions infiniment reconnaissants car, a cette époque, notre résistance physique était usée, la mort entrait dans toutes les cellules et les Allemands, grisés par l'offensive de von Rundstedt, criaient victoire. Ces communiqués, captés a la barbe des Allemands et diffusés dans les ateliers des N. N., ranimaient notre courage; ils faisaient vivre, jour par jour, notre volonté, pendant l'hiver le plus pénible de notre captivité.
Quelques minutes avant midi, les forçats quittaient les ateliers pour la «< promenade ». Nous traversions le potager entre deux batiments de la prison pour atteindre un vaste terrain de football limité par un chemin circulaire bordé de pommiers et de poiriers. La promenade consistait à suivre ce chemin qui côtoyait un mur de gros moellons haut de neuf mètres, l'enceinte de la prison. Par-dessus, nous pouvions voir les têtes d'arbres d'essences variées d'un jardin public et les feuillages aux nuances diverses qui nous donnaient l'illusion d'une orée de forêt. Nous marchions deux à deux, groupés selon le hasard de la sortie des ateliers. Le silence, obligatoire, n'était respecté par personne. Dans cet espace large, aéré, ensoleillé, j'ai vu se succéder les saisons. L'épanouissement du printemps : de grands poiriers en fleurs servaient de rendez-vous aux fauvettes, mésanges et pinsons dont nous suivions les ébats de nos fenêtres. La chaleur suffocante de l'été accablait la nature de lourds silences. A l'arrière-saison, la course des nuages lourds et sombres mettait tout en déroute : les feuilles couleur de sang ou bronzées tombaient une à une, lentement; les oiseaux disparaissaient. Puis, dès les premiers jours d'hiver, les corneilles mantelées volèrent de nouveau de toit à toit, comme au jour de mon arrivée en mars 1944... A l'extrémité du mur, nous pouvions voir émerger les toits d'une école gardienne. Le bruit des rondes enfantines et des jeux, les éclats de rire insouciants, les cris de joie arrivaient jusqu'à nous et nous en goûtions le charme. Mais, parfois, cette animation heureuse, mettait à vif, dans nos cœurs, la peine si difficile à contenir de notre longue séparation d'avec nos propres enfants. Le grand mur cachait les N. N. courbés de misères, passant, repassant et parfois sanglotant d'avoir entendu rire et jouer des gosses. Dans cet endroit paisible, nous eussions pu nous détendre, jouir d'un peu de paix. Mais le hauptwachtmeister que nous surnommions « Mikado », voulait nous traiter à la prussienne : marches au pas, distance réglementaire et en rangs parfaits. Il avait pour excuse une longue déformation professionnelle. Sous-officier instructeur de carrière, il avait reçu, pour ses vieux jours, comme honorable retrait une place de gardien de prison. Il devait souffrir au plus vif de se être devant la piètre allure de son détachement ! Nous n'entendions pas nous soumettre à une pareille discipline et parmi nous, nombre de malades étaient incapables d'un tel effort. Le « Mikado », irrité de notre mauvaise volonté et de notre mollesse apparente, ordonnait des pas de course compliqués de demi-tours innombrables : — Lauf schritt !... Rechts-um !... Links-um !..., criait-il. Ses commandements, hurlés à distance, ne pouvaient être entendus par tous. Il en résultait un désordre inouï : les uns faisaient demi-tour pendant que les autres continuaient leur marche. Même les plus solides, finissaient, époumonnés, par abandonner la course. La promenade se terminait, pour nous, lamentablement. Des graviers, des cendrées dans nos sabots rendaient la marche impossible. Nous toussions, crachions; certains prisonniers, tombés sur le sol, ne parvenaient plus à se relever. Le « Mikado », prêt à éclater, préparait les punitions. Dès notre rentrée en cellule, un Kalfa annonçait les mesures prises : suppression des livres, du supplément de nourriture et même de la promenade du lendemain.
L'atelier et la promenade occupaient de dix à onze heures de la journée; le reste du temps se passait en cellule. Quelques jours après notre arrivée à Wolfenbüttel, les gardiens avaient regroupé les condamnés à mort, dispersés jusque-là parmi les autres prisonniers. Dès lors et jusqu'à la fin de mon séjour à Wolfenbüttel, j'ai eu le bonheur d'avoir comme compagnon le docteur René Dubois, de Verviers. Arrêté en 1943, condamné à mort en même temps que sa femme, tous deux avaient été dirigés vers les zuchthaus de l'Allemagne. La peine de Mme Dubois avait été commuée en travaux forcés à perpétuité, tandis que l'exécution de mon compagnon avait été différée. Une parfaite entente régnait entre nous : dans notre étroite cellule, nous maintenions l'ordre et la propreté. Pour contrebalancer l'immobilité ankylosante de l'atelier, nous nous étions imposés de faire chaque matin un peu de gymnastique et, entre les heures de travail, de marcher dans la cellule. Plus tard, Robert Pottier, de Spa, un étudiant en droit également condamné à mort, nous fut adjoint. Chacun de nous s'efforçait d'alimenter la conversation sant autant que possible les banalités inutiles. Dans l'obsession sistante des nôtres, un échange d'idées et d'impressions était le seul moyen de résister à l'effroyable ennui et à l'angoisse que nous refoulions bien difficilement. Nous évoquions notre jeunesse, nos études, notre vie universitaireet nos existences. Nous faisions revivre notre foyer, nos occupations Nous discuttions de littérature, d'histoire, de politique; nous parlions de tous les sujets possibles luttant constamment pour maintenir notre esprit et notre pensée au-dessus de la déchéance qui rongeait nos corps. Il fallait un réel effort pour y parvenir car notre régime alimentaire, fatalement insuffisant, ne permettait pas de reconstituer nos forces épuisées par un travail excessif. La fatigue et la faiblesse extrêmes provoquaient une sorte de léthargie mentale. De nombreux camarades ne pouvaient plus résister et s'enfermaient dans un mutisme désespéré. * * * A l'atelier, il était difficile de se rendre compte des sentiments religieux de nos compagnons. En cellule, deux ou trois prisonniers vivaient totalement séparés des autres sans pouvoir se douter de ce qui se passait au dehors. Avec le docteur Dubois et Pottier, nous étions à l'unisson des mêmes croyances. Nous avons toujours prié ensemble, matin et soir. Chaque matin était salué par Y Angélus, récité dans la hâte des quelques minutes accordées pour notre débarbouillage et le rangement de la cellule. Le soir, ensemble de nouveau, nous confiions à Dieu le sort des nôtres. Le docteur Dubois terminait par la prière à la Vierge, de l'abbé Perreyve, dont les invocations avaient une profonde réalité pour nous : « Ayez pitié de ceux qui s'aiment et sont séparés, ayez pitié de l'isolement du cœur, de la faiblesse de notre foi... » Nous finissions parfois par quelques dizaines d'avé comptes sur les doigts car nos chapelets avaient été enlevés dans la rafle de nos objets personnels. Seuls quelques « bricoleurs » avaient réussi à fabriquer des « dizainiers scouts », creusant dans une bague d'aluminium, dix dents pour les ave et une onzième surmontée d'une minuscul croix de Lorraine pour le Pater. De temps à autre, le docteur Dubois nous parlait de ses méditations sur le Chemin de la Croix. Son langage simple nous apportait parfois une lumière nouvelle éclairant des aspects, des détails du drame de la Passion auxquels nous n'avions pas encore pensé, des heures de recueillement personnel étaient bien matinales. Les kommandos étaient rassemblés pour le départ, chaque matin, à quatre heures trente, dans le chemin, le long de notre bâtiment. Le bruit des sabots, les ordres, les commandements des gardiens me réveillaient. Je récitais à ce moment un chapelet et les prières de la messe dont je me souvenais : le Confiteor, le Gloria, le Credo, une partie de l'Offertoire et du Canon. Je terminais par une pensée d'union avec ma femme et mes enfants qui avaient le bonheur d'assister chaque matin à la messe et de s'approcher de la Sainte Table. Nous ne possédions ni missel, ni livre de prières. Un jour, cependant, nous trouvâmes, dans nos cellules, un manuel de prières à l'usage des prisonniers. Il s'agissait d'un petit livre édité à Paris, portant l'approbation de l'autorité d'occupation. Ce fait seul, suffisait pour faire mal accueillir l'ouvrage. Les Allemands nous avaient profondément blessés en piétinant nos chapelets, en brisant nos crucifix, en volant nos livres de piété. Ils n'avaient cessé de montrer leur haine et leur hostilité à l'égard de nos croyances. Un livre religieux, à leur convenance et remis par eux, nous devenait définitivement suspect. Nous trouvâmes, d'ailleurs, bien vite que les textes avaient été sérieusement remaniés : dans l' « Introït » Dum affligit me inimicus, le mot « ennemi », estimé trop « délicat » dans les circonstances du moment, avait été remplacé par « ennui » (pendant que je suis accablé d'ennuis). De pareilles libertés dans la traduction devenaient de sinistres plaisanteries. Les épîtres et les évangiles, dont le texte est si clair et impressionnant, avaient été traduits en un langage rude, heurtant, presque en argot. Une singulière mentalité s'y manifestait, car à la quatorzième station du Chemin de la Croix, le Christ paraissait faire une réelle concession, presque contraire à ses principes « en daignant se laisser ensevelir dans la tombe d'un riche ». Mais abandonné, sans prêtre pour m'aider et me soutenir, j'ai malgré tout, pu reconstituer les textes originaux et y puiser un réconfort spirituel. * * * Nous étions depuis quatre mois à Wolfenbüttel quand fut levée, pour les N. N., l'interdiction de toute lecture. La direction de la prison annonça des livres, rédigea un catalogue, afficha un règlement organisa un roulement. Mais en pratique. La' Croix Rouge française avait envoyé un choix d'intéressants ouvrages. Le Kalfa chargé de la distribution était illettré et, sans soucier de nos demandes, indéchiffrables pour lui, déposait dans se les cellules des volumes pris au hasard. En neuf mois, j'ai pu lire quatre ouvrages : Les Mémoires de la Duchesse d'Abraniès, Le Siècle de Louis XIV de Voltaire, La Philosophie de l'Art de Taine et Notre Ami Fsichari... La qualité était bonne, mais la quantité bien réduite. Je fus bien heureux aussi de trouver, pour la première fois depuis mon arrivée en Allemagne, une diversion, une possibilité d'évasion intellectuelle me faisant oublier mes tourments pendant quelques heures. Mais ces heureux moments furent bien rares. Pour une bagatelle, le « Mikado » enlevait nos livres, les supprimant pendant des semaines ou des mois. En hiver, la soupe du soir à peine distribuée, les gardiens coupaient la lumière. Et quand certains dimanches nous restions toute la journée en cellule, le froid était si intense que nous étions obligés de nous envelopper entièrement, tête comprise, dans nos couvertures. D'autre part, la difficulté de maintenir notre attention, nous montrait l'usure de notre organisme. L'effort constant que je devais faire pour comprendre le texte et suivre la pensée d'un auteur, dépassait souvent mes forces et me faisait tomber de sommeil. * * * Nos cellules étaient fréquemment inspectées par les gardiens à la recherche de ce que nous aurions pu dérober dans les ateliers. Ils culbutaient tout pêle-mêle, vidant la paille hachée de nos paillasses, secouant les couvertures. Le Mikado » nous persécutait, surtout pour l'ordre et la propreté. Je ne puis lui donner entièrement tort. Certains de nos compagnons, usés physiquement à l'extrême, n'avaient plus le courage de se laver... Mais il était bien Allemand ! Sous prétexte de rectifier l'alignement des paillasses, le repliement à l' « ordonnance » des couvertures, lui aussi mettait notre fourbi sens dessus dessous. Parfois, nos rares moments de tranquillité en cellule étaient troublés par l'arrivée d'un gardien à la recherche du coupable d'une infraction aux règlements : le docteur Dubois, enragé fumeur, faisait la chasse aux mégots concurrements avec les Kapos de l'atelier. Ceux-ci, pour se débarrasser d'un rival trop adroit dans l'art de découles'bouts de cigarettes, le dénoncèrent. Le soir, deux gardiens, véritables butors, se ruèrent dans notre cellule. L'un me fit sortir, en me croyant complice du docteur, m'arracha mon costume, le retourna en tous sens, mais sans résultat. Pendant ce temps, l'autre Indien avait traité le docteur de même, sans plus de résultat. Alors, pour arracher des aveux à la mode de la Gestapo, il se mit à frapper ignoblement Dubois en pleine figure. Et quand il s'en alla, il laissa mon pauvre ami, père de famille, dépassant la cinquantaine, durement meurtri par sa rage furieuse. Te ne veux pas insister sur les horreurs des prisons allemandes que j'ai connues. Les Allemands nous ont humiliés, bafoués, battus, piétines. Leur mépris de notre dignité la plus élémentaire était une des croix les plus lourdes à porter. Les scènes de bestiale brutalité nous laissaient, même quand nous n'étions pas les victimes directes, véritablement rompus. Notre indignation devait être refoulée même si elle dépassait toutes les bornes. Nos larmes de rage, seules, pouvaient la faire deviner. Nous arrivions à oublier nos souffrances personnelles mais nous ne pouvions pardonner aux brutes allemandes les souffrances qu'elles faisaient endurer à nos compagnons.
Quelques jours après notre arrivée, nous avons passé devant le médecin de la prison. Un infirmier mesura mon tour de poitrine, me toisa, me pesa. Je fus même admis à me plaindre et mes dires furent consignés sur une fiche. Après un travail administratif aussi complet, le lazaret ne pouvait, évidemment, plus être d'aucune utilité. Pour le reste, nous étions abandonnés aux soins d'un ancien forçat qui, ayant pris goût à la vie du pénitencier, y était demeuré après sa peine. Avec son expérience de trente années d'infirmier de prison, il était devenu « chef sanitaire » et portait les galons de oberwacht-meister. Peu importaient les avis des médecins prisonniers N. N. qui le secondaient, il imposait ses décisions. Son diagnostic était basé sur sa conviction que les plaignants étaient avant tout des carottiers. Sa clientèle, parfois très nombreuse, souffrait surtout d'une multitude de plaies. La moindre égratignure, même une simple morsure de puce, dégénérait vite en furoncle, en ulcère dont il était difficile de se débarrasser. Deux fois par semaine, les malades étaient admis au pansement, mais l'infirmerie était démunie de coton, de bandages, de sparadrap et de désinfectants. Je venais à peine d'être nommé magasinier de l'atelier que le docteur de Meersman, N. N. venu en même temps que moi à Sonnenburg, employé à Wolfenbüttel comme assistant du « sanitaire », me demanda de lui procurer de l'éther et de l'alcool. Le réseau de surveillance à la sortie des ateliers était trop serré pour que je pusse courir le risque d'emporter même une petite quantité de ces produits. Je résolus d'en demander au contremaître. Je lui exposai les besoins urgents des malades. Il se montra compréhensif : Soit, dit-il, mais qu'on ne le voie pas... A l'éther, à l'alcool ainsi autorisé à sortir clandestinement de l'atelier, j'ajoutai des chiffons de toile, de l'ersatz de coton, puis une sorte de graisse végétale transparente utilisée pour assurer l'étanchéité des instruments d'optique. Dans un local où les prisonniers atteints de plaies allaient se faire panser, le docteur de Meersman découvrit un petit bocal contenant des comprimés de « brontozil » employés contre l'érésipèle qui régnait à l'état endémique. Ce sulfamide fut mélangé à la graisse végétale. La mixture était cicatrisante et fit grand bien. Quel que fût le danger de contagion ou l'état extrême d'un malade, il ne quittait pas sa cellule ni les deux compagnons imposés depuis son entrée en prison. Parfois, un docteur, N. N. comme lui, appelé par le sanitaire en désespoir de cause, venait le réconforter mais, la plupart du temps, il ne pouvait que constater la gravité du mal. Entre-temps, le malheureux s'éteignait à petit feu. Son affaiblissement s'accentuait de semaine en semaine, de jour en jour. Puis, après une phase de somnolence, commençait une lente, très lente agonie. Avec un dévoûment complet, les camarades se dépensaient pour le malade, lui prodiguaient les soins les plus pénibles, s'imposant des veilles, des privations, couchant sur la dure pour lui passer leur matelas et leurs couvertures. Ils s'efforçaient de consoler, mendiant le sourire du malade comme s'ils eussent eu la mission de remplacer près de lui les absents : épouse, enfants, mère, prêtre. Malgré tout d'efforts, le malade s'éteignait comme une lampe sans huile. Et ses compagnons ne pouvaient plus que lui fermer les yeux. A peine refroidi, le mort était porté à la fosse commune. Dans la cellule, ses deux camarades, navrés, parlaient de lui et le pleuraient. Au dehors, dans la prison même, presque personne ne s'y intéressait.
—
Tu sais, René... Parfois, cependant, un prisonnier d'une personnalité marquante avait conquis une sympathie plus large. Quand il était malade, ses camarades d'ateliers ressentaient son absence et sa mort mettait toute la prison en profonde détresse. La disparition du major Tibo fut cause d'une grande peine. Tibo faisait partie d'un groupe de quatre Hollandais, tous condamnés à la peine capitale dans l'affaire « de Liedekerke-Schoenmackers ». lis avaient été envoyés à Sonnenburg un mois après moi. J'eus l'occasion de les voir le jour de leur arrivée a l'atelier, où leur entrée avait été sensationnelle. Le magasin d'habillement leur avait fourni des uniformes propres, presque ajustés a leur taille. Ils étaient rasés de près, leur tête passée à la tondeuse. Le plus petit, trapu, au visage un peu congestionné, était Kolf, bourgmestre de Leide. Stutte, fonctionnaire de banque, était beaucoup plus grand. Le colonel Velu, distingué et de taille encore plus haute, était dominé par le major Tibo, bel homme, bien proportionné, large de carrure, mesurant près de deux mètres et d'allure martiale. Comme s'ils entraient dans un mess, ils s'étaient présentés a notre groupe, avec aisance et amabilité, de manière militaire, en se nommant. Au milieu du laisser-aller général, leurs bonnes manières avaient fait impression. Le major avait regarde, du haut de sa grandeur, les Kalfas faisant main-basse sur ses objets personnels. Il avait exigé que fussent inscrits à l'inventaire, pour lui et ses compagnons, les cigarettes et le tabac dont les Allemands le dépossédaient. Il avait réussi a conserver un sac contenant un morceau de vrai savon, sa brosse a dents une bible ec un gros carré de fromage de Hollande, que nous mangeâmes ensemble. Dans le groupe, Stutte ouvrit la première brèche. Il avait recu le soir de son arrivée dans notre chambrée, la paillasse d'un forcat mort de la scarlatine. La même maladie l'emporta... Le bourgmestre Kolf, généreux et saint, se privait d'une trop grande part de ses rations par pitié pour ceux qui avaient faim. Il mourut en quelques jours d'une bronchite. Lors de mon départ de Sonnenburg pour Wolfenbüttel, le colonel Velu était à l'infirmerie. Plusieurs mois après, j'appris son décès. Le major Tibo, le seul des quatre qui avait résisté à Sonnenburg, mourut de faim à Wolfenbüttel. Il aurait fallu doublé et triplé ration pour une pareille constitution. Mais, hélas ! au point de vue allemand, le major n'était qu'un numero anonyme. Tout régime et suralimentation étaient exclus. Tibo n'eut bientôt plus que la peau sur les os. Sa faiblesse était telle qu'il tombait constamment en syncope. Tibo était protestant. A Sonnenburg, sa bible, les épitres de saint Paul nous avaient tant de fois rapprochés dans une méditation commune ! Avec cette bible, il m'apprit le néerlandais, tandis qu'a titre de réciprocité, je lui servais de professeur de français. Depuis son arrivée a Wolfenbüttel, il avait perdu son livre précieux... Il travaillait avec moi au banc du démontage. Un jour, a brûle-pourpoint, il me demanda : —
Radiguès ! Croyez-vous en la Providence ? Il ne vint plus a l'atelier. Il dut demeurer couché dans sa cellule. Mathieu Smets, son compatriote, l'aidait et le soignait avec dévoûment, matin et soir, avant et après le travail. A la sortie de l'atelier, malgré l'interdiction, j'entrais un instant dans sa cellule ouverte pour le retour de son compagnon. Je lui disais : - Bonjour, major ! Il sortait alors d'une espèce de torpeur, ouvrait les yeux, me serrait la main et je regagnais ma cellule. Il s'éteignit un dimanche, vers quatre heures, entre chien et loup, à l'heure où, dans la prison, la tristesse rôdait partout. Je pus le voir une dernière fois. Etendu, immobile, allongé sur son grabat, le major paraissait étonnamment grand. Son visage détendu n'était plus triste; ses traits avaient le calme, la sérénité de l'enfance. Il était entré dans la paix du Seigneur.
Dès qu'un avion allié franchissait la frontière allemande, les sirènes, de localité en localité, signalaient son avance. Quand, à l'atelier, nous entendions sonner l'alarme dans le lointain, nous savions que dix minutes après, les sirènes de Wolfenbüttel commenceraient toutes à hurler. Les règlements d'atelier contenaient des instructions spéciales en cas d'alerte. Nous pouvions y lire notamment que la cellule était un abri naturel et le plus sûr de la prison. Il était ajouté qu'à toute alerte, les contremaîtres devaient, d'initiative, y reconduire les prisonniers. Mais, immédiatement après, les Allemands, pour ne prendre aucun risque personnel, se réfugiaient dans les abris bétonnés sous la cave, abandonnant la prison sans surveillance. Les gardiens bien terrés, nous en profitions pour regarder aux fenêtres. Emerveillés, nous assistions à l'invasion du ciel, aux combats, aux descentes en parachutes. Le plus souvent, les avions arrivaient de l'ouest, volaient dans la direction de Berlin, puis revenaient au-dessus de nous. Parfois, la haute cheminée d'usine de la prison paraissait une cible tentante pour les aviateurs. Un sifflement, un grondement de plus en plus violent, descendaient du ciel. Un coup sourd ébranlait le sol. Puis l'assourdissante explosion. Les alertes interrompaient le travail pendant des heures et se répétaient parfois plusieurs fois par jour. Quand le dernier avion allié avait bien disparu et que nous ne pouvions plus entendre le me moindre ronronnement des escadrilles, une batterie de D. C. A. dissimulée dans le jardin de la prison, se mettait alors, à notre grande joie, à cracher du feu, à tirer des salves héroïques et sans danger, même pour les artilleurs. Les alertes de nuit étaient plus impressionnantes. Sous un ciel embrasé, le paysage apparaissait en rouge sombre. Avec un bruit assourdissant, les avions semblaient raser les toits tandis qu'autour de nous se déchaînaient les éclatements d'obus, les crépitements de mitrailleuses, le tonnerre des bombes. Au bruit de la sirène annonciateur de ruines et de morts, le visage des surveillants et des contremaîtres se contractaient. Ils ne pouvaient dissimuler leur angoisse. « Das haben wir nicht gewollt... » Dans l'atelier, la vengence était devenue une mystique, un rêve d'avenir. A la reprise du travail, nous étions vite au courant des « mauvaises nouvelles » : une maison de gardien rasée, autant d'Allemands tués, autant d'ennemis blessés, etc. Alors, les visages des prisonniers s'éclairaient. Les pauvres diables, insultés, battus, chuchotaient de banc à banc leur espérance de libération et leur joie de voir, enfin, leurs bourreaux subir des malheurs mille fois mérités...
Quelques cellules du deuxième étage avaient été spécialement aménagées pour les « Arrest »; fenêtres bouchées aux trois quarts, un lit en planches, un robinet, un W.C. Paillasses et oreillers étaient interdits. Mis aux « Arrest » ordinaires, après deux jours de pain et d'eau, le condamné recevait le troisième jour un aliment chaud, puis recommençait pendant deux nouveaux jours au pain et à l'eau et ainsi de suite. Le tarif ordinaire était de quatorze jours. Mais condamné aux « streng Arrest », le prisonnier restait uniquement au pain et à l'eau. Dans l'état physique des prisonniers, pareil régime était épuisant. L'homme ainsi puni sortait du cachot exténué, incapable d'être remis au travail. La plupart de ceux qui ont subi les “streng arrest” en moururent. Il fallait échapper à cette punition car elle était infligée sans motif sérieux, sur un simple soupçon. A la suite d'une dénonciation, même non fondée pour une maladresse dans le travail qualifiée arbitrairement de « sabotage ». Nous tâchions de venir en aide aux camarades revenus parmi nous en préparant, à leur intention, une provision de nourriture.; Cet acte d’entraide fut rapporté aux Allemands qui menacèrent de cachot quiconque secourait un prisonnier après les « arrest ». Parmi les N.N., il y avait quatre jeunes gens qui, depuis vingt ils se trouvaient à Wolfenbüttel, sans interrogatoire, ni procès, ni jugement. Ils avaient réclamé leur mise en liberté; la direction de la prison prétendait avoir transmis leur demande, mais le Reich ne s'occupait pas de leur affaire. Ils rêvaient de liberté... Un soir, n'y tenant plus, ils coupèrent barreaux et grilles de leur fenêtre avec les scies et les limes de l'atelier, puis, résolument, attendirent le moment opportun. Nous ne tardâmes pas à apprendre leur évasion qui eut lieu un samedi, dans la soirée, à l'heure où les Allemands chopinaient ensemble et dépensaient leur paie de la semaine. Leur tentative, combien angoissante pour nous, était un « test » de nos possibilités d'évasion. Ceux qui avaient aidé en procurant des outils, traçant des itinéraires, donnant de leur propre nourriture pour constituer un viatique, attendaient fébrilement. Les jours passèrent et, après, les semaines. Nous étions tous certains du succès de l'équipée malgré les affirmations des Allemands, toujours sûrs d'eux-mêmes, prétendant qu'infailliblement les quatre jeunes gens seraient repris. Hélas ! nos compagnons finirent par être capturés l'un après l'autre, dans un état lamentable. Se reposant et se cachant le jour, toujours en alerte, ils marchaient la nuit dans la direction de l'ouest, contournant villes et villages. Ils étaient arrivés à faire une centaine de kilomètres, mais la faim et la soif les avaient vaincus. Exténués, ils s'étaient rendus l'un après l'autre et avaient été ramenés à Wolfenbüttel. Ils furent d'abord livrés au directeur de la prison qui leur infligea trois semaines de « streng arrest ». Il fallut attendre plusieurs semaines avant que leur état de santé ne fût jugé apte à supporter la punition. Malheureusement, au cours d'un « cuisinage » serré deux des fuyards, Lagnon et Lagrand, reconnurent avoir mangé, cours de leur fuite, des betteraves d'un silo. Un arrêté de guerre prévoyait la peine capitale pour tout détenu qui, au cours d'un évasion, se rendrait coupable de vol. Traduits devant le Volksgericht, ces deux N. N. furent guillotinés pour ce vol.
Wolfenbüttel était une prison d'Etat où s'exécutaient les peines capitales infligées par les tribunaux de l'Allemagne de l'ouest. Les criminels de droit commun, les condamnés politiques allemands ou étrangers y étaient envoyés pour leur exécution. Le matériel nécessaire s'y trouvait à demeure : bourreau, potence, guillotine. Pour décongestionner les Conseils de guerre en pays occupés, la Gestapo livrait une partie de ses victimes au Volksgericht — Tribunal du Peuple — créé en Allemagne par Hitler. Les crimes contre l'Etat, les délits contre certaines ordonnances de guerre étaient de sa compétence. Les arrêts étaient rendus par un magistrat encadré de gens triés dans le parti. Les jugements devaient être approuvés par le Ministère de la Justice à Berlin. En pays occupés, un acte de clémence pouvait avoir une justification politique vis-à-vis de la population. Dans le Reich, au contraire, les Allemands n'avaient pas à tenir compte d'une opinion publique étrangère. Un prisonnier politique était un coupable ne méritant aucun intérêt. La suppression des ennemis du Reich était prévue normalement par le régime. Si nos compatriotes envoyés en Allemagne pour jugement étaient condamnés à mort, plus rien au monde ne pouvait les sauver. Bien entendu, le juge permettait d'introduire un recours en grâce. Cette autorisation, encourageant les espoirs, n'était que duplicité et hypocrisie. Berlin réformait parfois un jugement pour une erreur juridique ou de procédure, mais se contentait, au plus, de modifier une condamnation à mort en celle de travaux forcés. De grâce, il n'était pas question. Au rez-de-chaussée de notre bâtiment, en dessous de nous, soixante cellules étaient constamment occupées par les condamnés à être guillotinés, les « Zum Tode Kandidaten ». Ils y restaient un temps variable de trois semaines à trois mois, délai administratif nécessaire à l'examen du dossier et à la confirmation ou la modification du jugement. Pendant cette période d'attente, les gardiens appliquaient aux condamnés un régime disciplinaire injustifiable. L'attente d'une mort quaisi certaine n'était pas suffisante, il fallait encore, aux Allemands, une satisfaction supplémentaire : les condamnés à mort demeuraient au secret, des menottes aux poignets, dans l'inaction totale. Leur cellule n’était ni chauffée ni meublée. Le soir, ils recevaient une paillasse, la lumière demeurait allumée, la porte entr'ouverte. Ils étaient obligés de se dévêtir pour la nuit et dormaient avec une seule couverture. Chaque fois que nous rentrions, soit pour le repas de midi, soit à la fin de la journée, nous les entendions arpenter sans cesse leur cellule. Leur marche se prolongeait tard dans la soirée et parfois la nuit entière. Nous les apercevions aux heures des repas, quand un gardien ouvrait les portes pour leur permettre de ramasser leur gamelle posée à terre. A genoux, poignets garrottés, ils faisaient des efforts pénibles pour ramasser leur pitance. Les Kalfas, toujours accompagnés de gardiens, jetaient pêle-mêle dans la gamelle, comme s'il s'agissait de remplir l'auge d'une porcherie, pain, margarine, rondelle de boudin et versaient par-dessus la tisane allouée aux prisonniers deux fois par semaine. Nous pouvions encore les voir pendant leur promenade journalière de quelque vingt minutes, marchant l'un derrière l'autre, menottes aux poings. Effroyablement amaigris, visages d'une pâleur cadavérique, les traits tirés, ils n'étaient plus que de lamentables guenilles humaines. De ces cellules où étaient enfermés des hommes, des femmes, de très jeunes gens, montaient parfois des bruits affreux : coups frappés sur les portes, cris affolés. Dans le silence de la nuit, des appels éperdus de femme, des voix presque enfantines faisaient bondir nos cœurs et nous torturaient atrocement. Comme pour les exécutions en Belgique, le condamné devait être en bonne santé et, de plus, un médecin devait être témoin de l'exécution « à toutes fins utiles ». Néanmoins, depuis fin 1944, il n'y avait plus de médecin à Wolfenbüttel et le bourreau n'en a pas moins continué sa besogne. Une femme condamnée à la pendaison fut menée au gibet. Le bourreau, habitué à manier la guillotine, ne fut pas très expert. La malheureuse fut pendue et dépendue deux fois parce que le nœud coulant serrant le menton et la nuque ne pouvait se fermer. Il faut une troisième pendaison pour tuer la victime. Les gardiens n'y attachèrent aucune importance. Il ne s'agissait, pour eux, que d'une méprisable « polacke ». Une fois par semaine, souvent le mardi, en rentrant de la promenade, nous trouvions l'aspect de la prison modifié. Aumôniers et pasteurs allaient de cellule en cellule. Dans la cour, des personnages en toges rouges ou noires faisaient les cent pas auprès de grosses « conduites intérieures ». Enfermés dans nos cellules, anxieusement à l'écoute, nous savions que l'heure des condamnés du rez-de-chaussée était proche. A travers le judas de la porte nous pouvions observer, à l'étage inférieur, le gardien-chef accompagné de deux Wachtmeister. L'un de ceux-ci s'arrêtait devant une porte. Bruit de trousseau, grincement de serrure. La porte, largement ouverte, le gardien-chef, d'un geste, faisait sortir le condamné. Celui-ci apparaissait sur le seuil, vêtu d'un pantalon, sans chemise, la veste jetée sur les épaules, les mains liées derrière le dos. Il avançait dans la galerie. Le silence de mort n'était troublé que par le clic-clac des sabots. Les pas s'éloignaient. Leur écho, à peine perceptible, indiquait que le condamné quittait la galerie pour arriver dans la cour. De nouveau, mais cette fois du jardin, le clic-clac devenait plus reconnaissable..., passait sous notre fenêtre, puis diminuait. Nous entendions une porte se fermer et tout bruit cessait. Réactions diverses : le lendemain de Noël 1943, une vingtaine de condamnés français et belges marchant à la guillotine, avaient chanté des hymnes nationaux et le Magnificat. Mais la plupart de ceux que j'ai vus se rendaient au supplice en silence, d'un pas régulier, paraissant ferme... et, comme nous savions qu'il n'y avait pas de médecin pour les « droguer », leur assurance héroïque, leur calme nous stupéfiaient. Quand, vers deux heures, nous risquions un regard vers les bâtiments de la guillotine, les Allemands chargeaient de courts cercueils sur une camionnette. Nous savions par les médecins-prisonniers que les décapités étaient étendus, la tête sous le bras. Nous entendions claquer la portière de l'auto, mettre en marche le moteur. Nos camarades morts étaient menés vers les hôpitaux pour la dissection, deux cents prisonniers étaient passés à la guillotine. Sonnenburg m'avait laissé un souvenir demoribonds et de cercueils. Wolfenbüttel restera, pour moi, un lieu de tueries organisées, d'assassinats.
Vers la fin de mars 1945, un étourdissement m'avait valu quinze jours de dispense de travail. Je restai couché dans la solitude reposante de ma cellule, à l'écart de l'agitation fiévreuse des ateliers. A cette époque, des raids d'aviation se multipliaient. Les sirènes jetaient la panique parmi les Allemands; le travail était interrompu trois et quatre fois par jour et les ateliers évacués avec précipitation. Parmi les prisonniers, de fantastiques victoires alliées étaient annoncées tous les jours. Les plus sceptiques étaient devenus optimistes. Le 7 avril, les deux camarades réparant des appareils de radio, parvenaient à capter un communiqué sensationnel qui se répandit aussitôt dans toute la prison : « Poussée des alliés vers Brème et Hanovre. Chute de Cassel. » Un immense espoir : notre libération est imminente ! Les plus agités des prisonniers la fixaient à quarante-huit heures plus tard. Les Allemands le savaient bien. Ces nouvelles, électrisantes pour nous, paralysèrent gardiens et contremaîtres. Le travail fut abandonné, les ateliers fermés et les forçats maintenus en cellule. Le lendemain — dimanche 8 avril — après le repas du matin, nous nous étions recouchés, cherchant dans le sommeil un dérivatif a notre impatience. Tout à coup, vers la fin de la matinée, un grand remue-ménage se fit entendre. Nos cellules furent ouvertes. Nous avions à nous lever immédiatement pour le rassemblement général. Les N. N., les condamnés qui devaient être prochainement guillotines, même les malades, devaient être évacués le jour même. Dans la galerie du rez-de-chaussée, nous trouvâmes les vêtements que nous portions le jour de notre deportation: souliers, linge, costume… Nous nous regardions tous avec étonnement comme si nous nous étions costumés pour un déguisement. Les chapeaux melon provoquaient une hilarité générale, la jacquette de fonctionnaire « faissait » vaudeville et les agents de police, les pompiers, semblaient du guignol. Jusque là inexistante parmi les prisonniers, une certaine hiérarchie sociale renaissait instinctivement. Des hommes, l'aspect grave, en veston noir et pantalon de fantaisie, guêtres sur les souliers, en imposaient. Des chauffeurs de bonne maison en livrée à larges boutons de cuivre couverts de vert-de-gris, devenaient tout à coup déférents, s'effaçaient devant certains de leurs camarades. La pitance à peine achevée, nous fûmes menés à la gare par quelques détours. Les gardiens avaient disparu. Des S. S. étaient chargés du convoi. Nous étions deux cent quatre-vingt-dix. Nous fûmes rangés par cinq, comptés plusieurs fois, puis séparés en quatre groupes qui, chacun, s'entassa dans un fourgon rattaché à un train de munitions. Chaque wagon, surmonté d'une pancarte avec la lettre P — Patronen, cartouches — tenait à distance les fumeurs mais constituait une cible bien visible pour les aviateurs alliés qui parcouraient le ciel. Nous étions dans l'obscurité, debouts, serrés, dans l'impossibilité de nous étendre. Le train partit. Pour nous donner du « cœur », nous chantions, nous sifflions. Ma lassitude était grande. Peut-être étais-je débarrassé de mes poux — ils fuient les malades — mais j'étais secoué de frissons, d'abominables quintes de toux me déchiraient, je crachais du sang... Le convoi s'arrêtait plus souvent qu'il ne roulait. Pendant la première nuit, des prisonniers dans le fourgon à côté du nôtre brisèrent le plancher et se laissèrent tomber sur le ballast. Dix-sept s'échappèrent. Le
voyage dura quarante-huit heures. Quand les portières s’ouvrirent nous
étions dans la banlieue de Magdebourg, à quelques pas d'une prison. |