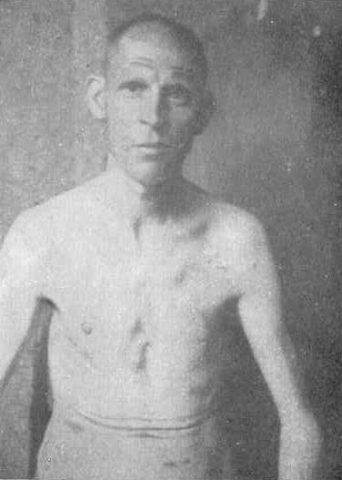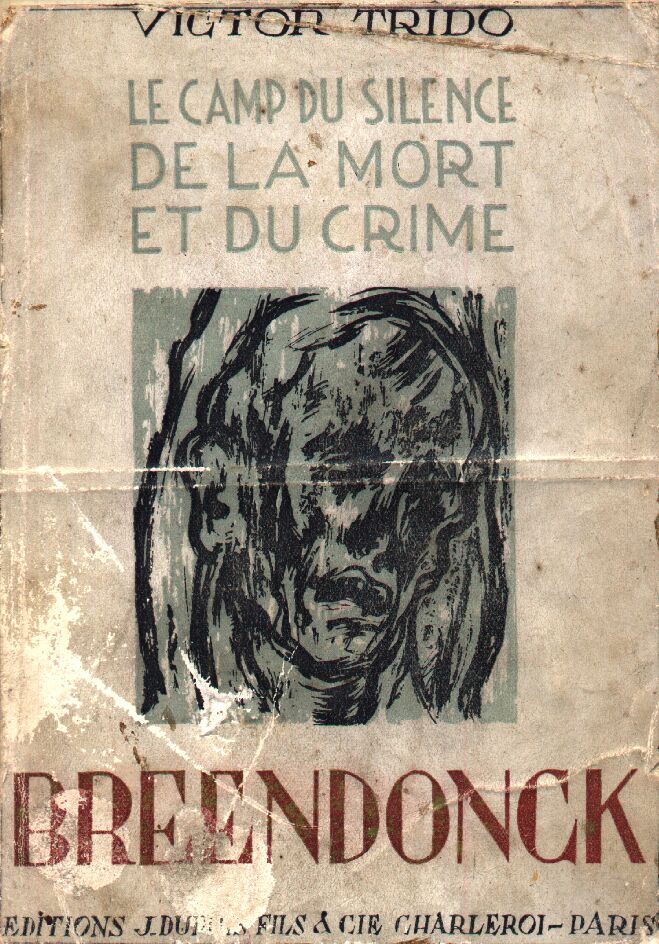 |
Nederlands | ||||||||||||||||
|
Victor Trudo, BREENDONCK,
Le camp du silence, de la mort et du crime |
|||||||||||||||||
| Contenu | |||||||||||||||||
| En manière d'avant-propos | |||||||||||||||||
| Premiere Partie | |||||||||||||||||
|
Chapitre 1 A Breendonck Chapitre 2 Breendonck et son camp Chapitre 3 Les exécutions du 6 janvier 1943 Un drame Chapitre 4 Premiers effets de l'isolement Chapitre 5 Lesxécutions du 13 janvier 1943 Chapitre 6. Premier décès Chapitre 7. Heil pour l'Oberleutnant ! Désirée Mouffe Tortures au détail et assassins en gros Alexis Chapitre 8. Raissonnons ! Chapitre 9. Jean-Pierre Dhée Chapitre 10. Les poux Chapitre 11. Histoire de lettres Chapitre 12. Cruautés encore... Chapitre 13. La faim Chapitre 14. Une visite médicale Chapitre 15. Scènes d'épouvante et autres Chapitre 16. Aux familles de tous ceux que Breendonck a tués Chapitre 17. Ceux des cellules Chapitre 18. Le sanglant fausceau des décemvirs Chapitre 19. Comment les faire revenir? Punir ! |
|||||||||||||||||
| Deuxieme Partie | |||||||||||||||||
|
Chapitre 1. Libération Chapitre 2. Arrestations en masse Chapitre 3. Ancienne connaissance Chapitre 4. 27 juillet 1944 Charleroi libéré ! Daumeries ! Chapitre 5. Breendonck Discours prononcé par Pierre Lansvreugt Chapitre 6. Au Tir National Discours prononcé par Victor Trudo sur la tombe d'Emile MAUFORT |
|||||||||||||||||
| Epilogue: L'affaire Daumeries devant le Conceil de Guerre de Charleroi. | |||||||||||||||||
|
En manière d'avant-propos |
|||||||||||||||||
|
Mon cher Martial, En ce jour de ma libération, 24 avril 1943, je fais à ta mémoire l'hommage de ces souvenirs, en témoignage d'une amitié, d'une fraternité qui ne s'est jamais démentie un instant. Nous avons passé des mois à Breendonck, jusqu'au jour où les Boches, accompagnés de S.S. belges, sont entrés dans notre chambre pour te menotter et, avec neuf autres compagnons : STORCK
Jacques, de Bruxelles ; Avant ton supplice, déjà, tu avais bien souffert... Chaque jour, dans la salle des tortures ou au travail, tu recelais, sans te plaindre, les coups de poing, de pied, qu'un Weiss, qu'un De Bodt, des Belges, te portaient. Je ne sais où se trouvent, à l'heure où je t'écris, nos «oiseaux de tempête » (comme nous les appelions). Poursuivent-ils à Breendonck leur besogne d'assassins ? Les retrouvera-t-on les ailes broyées, un matin, à l'aube, non loin d'un mauvais lieu ? Je les souhaite morts à chacune des minutes qui s'écoulent ! Parviendront-ils à aller pourrir dans un cimetière de Bochie ? Je l'ignore. Mais je ne puis les voir passer dans la clarté de mes souvenirs sans songer à toi, mon vieux Martial, qui les détestais comme je les détestais moi-même et tels qu'ils vinrent à nous, monstrueux et criminels, en marge de l'ordre humain. Dans un traité de botanique générale, publié en 1784 par Quercize de Listrac, je lis ces lignes qui sont tout un portrait: « L'aroïdée, fleur qui a donné son nom à toute une famille du type « arum », se trouve surtout dans les marécages, au long des fleuves ou sur les bords des lacs de l'Extrême-Orient. En Chine, dans l'Inde et en Perse, elle prend des proportions énormes. Du calice profond et sombre où pourrissent des papillons, des insectes et des oiseaux-mouches, s'exhale une odeur caractéristique de charnier. Aussi, cette fleur ne peut croître que dans les endroits malsains et ne répand autour d'elle qu'un parfum de mort... » A Breendonck, les Weiss et De Bodt, d'autres traîtres qui seront cités par la suite, nous tenaient lieu d'aroïdée... Mon cher Martial, nous sommes toujours en période de guerre, je suis rentré auprès des miens, à Charleroi, et je prends sous ma seule responsabilité d'écrire le grand drame de Breendonck. N'en avais-je pas pris l'engagement, là-bas, dans la salle infecte qu'ils appelaient chambre, ou « lag », où nous nous promettions, avec la chance d'en sortir, de décrire toutes les atrocités que nous avions cités que nous avions vues ou subies, les fusillades qui nous avaient été données en spectacle, les crimes auxquels il nous avait fallu assister. |
|||||||||||||||||
|
< Victor
TRIDO, sortie de Breendonck. |
Martial VAN
SCHELLE, > fusillé le 15 mars 1943, à 7 h. 10 du matin. |
||||||||||||||||
|
Emile
RENARD, |
Fernand
HUET, de Jumet |
Georges VANNESTE de Binche |
|||||||||||||||
|
Des milliers de Belges sont passés à Breendonck. D'autres, plus autorisés peut-être, en raconteront aussi l'histoire ; suppléons à leurs efforts et fortifions-nous en pensant qu'il est juste de faire connaître que le soldat allemand n'est pas changé. Il était « boche » en 14-18, il l'est resté ! Neuf mai mil neuf cent quarante-trois. J'ai dû interrompre jusqu'à ce jour la lettre commencée. A l'époque de mon arrestation, je pesais 72 kilos. A ma rentrée, avec un organisme détraqué, un corps marqué par les coups, il me restait 41 kilos 1 Aujourd'hui, je suis mieux et vais reprendre ce que j'aurais voulu te dire si tu avais pu être près de moi. Londres a annoncé ce matin la prise de Tunis et de Bizerte. Te souviens-tu comme nous en parlions déjà au temps de notre détention... Là, en Tunisie, les fridolins se sont enlisés dans un marais qu'ils avaient pris pour un lac où nageaient des sirènes. Pauvre cher ami, le peloton allemand t'a eu ; à six mètres, quatre fusils visaient ta poitrine, et c'est le S.S. belge De Bodt (il est venu après le déclarer dans la chambre), qui t'a donné le coup de grâce. Les Belges de Breendonck, les vrais, te vengeront ! Tu fus abattu le 1" mars 1943, un lundi. Tu as pu me dire adieu ; ton mouchoir de poche, chère relique, m'est resté ! Nous étions quarante-sept à te voir partir... Au pied du lit, nous te faisions une haie d'honneur ! Neuf autres condamnés, parmi lesquels tes amis Hertoghe et Falise, t'attendaient dans le couloir du bagne... Nous les voyions aussi. Comme tu étais beau, Martial ! Comme vous étiez beaux ce jour-là ! La veille et une partie de la nuit, avec André Wittezaele, d'Ostende, que tu connaissais depuis longtemps, nous nous étions entretenus de la situation. Nous écoutions tes recommandations, serrés contre toi sur ta paillasse... Tu nous as parlé de l'Angleterre où tu étais connu, où tu comptais tant d'amis ; de l'Amérique, où ta maman était née. Bien tard, tu as voulu nous laisser croire que tu dormais, mais nous n'étions pas dupes. Tu voulais simplement nous voir nous reposer, car tu savais que le travail de chaque jour nous minait d'un épuisement excessif. Witte-zaele m'a dit que, de toute la nuit, tu n'avais cessé de lui tenir la main... Mais l'heure du supplice allait sonner ! Tu es mort pour l'honneur de notre race, elle est forte en de pareilles circonstances. Ce jour-là, il faut bien le dire, je n'ai pas souffert de ta mort. Tu es mort dans l'honneur, et l'honneur rend le trépas plus beau que la vie. Tu n'aurais pas voulu être pleuré. Je ne puis que t'envier. Ta fermeté, ta noblesse naturelle, Martial, dans laquelle transpirait toute la ferveur de notre race, continue à m'émouvoir autant que le souvenir de ton beau courage. Cet aveu aussi, je ne puis que le formuler. Certains, mon cher Martial, me reprocheront d'avoir mis à nu la vie de Breendonck, de l'avoir fait revivre. Je m'empresse, devançant tant d'amertume, de leur dire que c'est précisément parce que cet ouvrage revêt un caractère infernal que je te l'ai offert. Je suis sûr que tu m'aurais apporté ta collaboration s'ils ne t'avaient pas fait mourir... Ceci est peut-être un livre condamnable, mais ce n'est ni un livre méchant, ni une mauvaise action. II possède même une qualité que peuvent lui envier beaucoup de romans : il est vrai. Ce n'est pas l'analyse d'un cas particulier que je veux faire. La vérité sur Breendonck m'appartient à moi aussi. Les Boches et leurs acolytes les S. S. en font là-bas l'usage qu'il leur plaît pour nous voler, nous affamer, nous torturer ! Combien, sous nos yeux, n'ont-ils pas été enterrés vifs ? De la vérité, je ferai aussi l'usage qu'il me plaît, mais les milliers de camarades qui, comme nous, furent à Breendonck, ne pourront que dire : La vérité de l'auteur est la seule que nous connaissions. Je manque peut-être de culture, de tradition, de passé, pour avoir la prétention de venir aux lettres. C'est la promesse, notre promesse, Martial, qui me fait un devoir d'essayer, non pas d'écrire un livre, mais de faire un reportage sur le camp du silence, de la mort et du crime ! Comme tu le
savais, je suis un commissaire de police démis de ses fonctions par les
autorités administratives du moment, par des traîtres que notre
justice réclamera un jour. Que d'autres trouvent drôle que je me réclame
du commissariat et du journalisme, c'est le moindre de mes soucis ; je
n'ai qu'un but : faire punir ! Au nom de
L'après-guerre modifiera peut-être ce jugement, souhaitons-le pour notre petite Belgique aujourd'hui envahie par les Boches qui y grouillent comme des têtards dans une mare verte. Aujourd'hui, ami Martial, notre petite Belgique les voit, ces têtards et les traîtres que nous connaissons, se multiplier tels les champignons parasites sur les banquettes du vélodrome de Charleroi. Cette vermine, nous la chasserons bientôt. Nous ne distribuerons pas de prix. C'est un jeu très imprudent. Mais nous pouvons dire nos sympathies personnelles. Elles vont à ceux, quelles que soient leurs convictions religieuses, leurs opinions politiques, qui n'ont jamais cessé d'être Belges ! Pour eux, pas de réclame indécente, pas d'inélégances tapageuses. Le seul souci de coopérer au salut du pays les pousse à agir. C'est pour cela qu'il faut les estimer... Je suis sorti quelques heures, hier, 9 mai 1943, un dimanche. J'ai vu, à Charleroi, que l'on dansait en certains établissements. N'est-ce pas notre ami André Wittezaele qui nous rappelait à Breendonck qu'on dansait toujours aux heures graves ? On dansa pendant les massacres de Nîmes et les procès de Ney et de Labédoyère, comme on avait dansé après le supplice de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Le bal de Calypso fut remplacé par celui des victimes. « Saura-t-on jamais par quel sentiment de folie la jeunesse fit passer tant de plaisir sur tant de douleurs ? » nous dit Mme Hamelin. Je me remets lentement des souffrances que j'ai subies. Je pense chaque jour aux camarades restés à Breendonck — cinq cent quatre-vingts le jour où j'en suis sorti. Je revois le fort dans ses plus mauvais jours... quand la pluie ne cesse de tomber, quand les brouillards, chassés par le vent, mènent autour du bagne leur triste ronde... Je revois les coupoles se dresser, presque noires sous leur carapace d'acier, au bord de l'horizon chargé de nuages ; elles semblent renfermer une menace obscure. Je ne puis, sans haine, écrire toutes ces choses dans toute leur démence et leur horreur. Si, plus tard, les ruines étant réparées, les souvenirs étant lassés, on venait me dire que j'aurais pu regarder de plus haut, mieux comprendre, à ceux-là je répondrais qu'ils n'ont pas vu ce que nous avons vu. Il ne faut pas qu'à l'heure du règlement des comptes une pitié coupable vienne troubler notre lucidité. C'est aujourd'hui que la sentence doit être fixée et nous la voulons impitoyable, car c'est en ces moments que nous apparaissent le mieux les preuves des crimes que nous rappelons. Il faut que les décisions soient prises dès à présent et que. sans crainte de se tromper, on affirme que tout ce qu'on pourra dire plus tard est faux. Dans l'affaire des S. S. de Breendonck, comme dans celle des détenus qui ont favorisé, aidé leurs horribles desseins, il ne peut y avoir de degrés, ils sont tous du même sac. Unis dans l'infamie, ils doivent être étouffés dans la même boue et noyés dans le même sang. Le speaker de Londres a fait, ce soir, la déclaration suivante : « L'heure du jugement implacable des patriotes sonnera. Nos bourreaux sont irémédiablement condamnés ; je ne sais quand l'orage éclatera, mais il éclatera ! » Plus tard, j'espère revoir notre ami André Wittezaele pour parler encore de toi, et, ensemble, veiller à l'exécution de tes dernières et suprêmes volontés ! |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
1 |
|||||||||||||||||
|
Le 31 décembre 1942, à 8 heures du matin, les personnes passent à Charleroi devant la caserne Trésignies, transformée en prison, purent en voir sortir quatre camionnettes dans lesquelles, mitraillettes ou carabines braquées, des soldats allemands de la feldgendarmerie tenaient des civils en respect. Dans chacun des véhicules, une vingtaine de prisonniers avaient dû prendre place. Par la rue du Ravin, le boulevard Audent et l'avenue des Alliés, le convoi arrive à la chaussée de Bruxelles. Ce jour-là, la température
est rigoureuse ; une tempête de neige vient de s'abattre sur la région,
et mal protégés par les bâches, debout, nous subissons toutes les
rigueurs du temps. Comme nous emportons avec nous des colis de vivres
que Ce fort de béton, avec ses coupoles et ses fenêtres à barreaux, est entouré d'un fossé large et profond autour duquel des soldats, postés tous les cinquante mètres, montent la garde. Au centre, et dressé dans une tourelle faisant saillie comme une échauguette, un autre poste avec mitrailleuse pouvant balayer les quatre côtés du carré. A l'extérieur, des barbelés. Un bref coup d'œil nous permet de juger la situation, et intérieurement déjà nous noua disons : il fera bien difficile de s'évader... A coups de crosse, on nous fait descendre, tandis que les S.S., nerf de bœuf à la main, se lancent sur nous en criant : « Schnell ! Schnell !» (1) Comme un véritable
troupeau, nous sommes immédiatement entourés et frappés. Sur le
pont, une haie de cravaches nous attend. Nous nous lançons à la
course pour traverser, les coups redoublent, et, la figure ensanglantée,
nous passons sous la voûte du fort. Une porte de fer se referme sur
nous avec un bruit sinistre, une angoisse indescriptible s'empare de
notre cœur. Des gardiens, armés d'un revolver, sont placés dans les
couloirs. On crie : « Halte ! » Tous s'immobilisent, pour laisser
passer des S.S. accompagnant, en les frappant d'une chicote sur la tête,
des policiers belges dont la tête est encapuchonnée dans une cagoule,
mais qui continuent à porter leur tenue. Le sang gicle, tandis que le
S.S. crie en français : Nous restons des heures dans cette lugubre galerie, pendant que dans le bureau des S.S. on vole tout ce que nous avons apporté avec nous. Du bureau nous parviennent des cris de souffrance, premier écho des brutalités exercées sur tous ceux qui sont appelés. Lorsque ce fut mon tour, un S.S. s'écria en fouillant mes poches : « Ah ! ah ! vous arrivez à Breendonck avec un bistouri ! » (Je n'avais pu m'en débarrasser). En disant ces mots, il me donna un coup de poing dans les côtes, tandis qu'un violent coup de pied au bas de la jambe gauche m'atteignait jusqu'à l'os. Je considérai le soudard un moment. Il avait le visage mauvais, blême. Traînant ma jambe qui saignait, je sortis du bureau en pensant : « Ici, il faudra renoncer à tout et probablement mourir. » C'était ma première impression en arrivant à Breendonck. On allait faire sentir aux ennemis du Reich allemand tout le poids de leur châtiment en leur infligeant le séjour de cet enfer. Après nous avoir fait enlever nos vêtements, on nous donna à revêtir une tenue de soldat belge. Sur la veste, un numéro de matricule bien apparent, une bande blanche, de toile, qui veut dire « aryen », et sur cette bande, un petit carré rouge qui nous classe dans la catégorie des communistes ou marxistes. Les terroristes, ou
considérés comme tels, portent sur la veste une croix ; les saboteurs
et détenteurs d'armes, la lettre A ; les affiliés du Front de l'Indépendance,
un T ; ceux de Enfin, on nous installe à quarante-huit dans une chambre prévue pour une vingtaine d'hommes. L'espace nous est mesuré, le logis manque d'air, mais la garde est partie... Nous nous réconfortons mutuellement, et chacun se prépare à occuper un lit. Ceux-ci sont faits de « lattes » de bois, ce sont plutôt des caisses, on dirait des cercueils ! Personne encore n'a mangé de la journée, nos victuailles nous ont été volées ; nous apprenons qu'aucune nourriture ne nous sera distribuée avant le lendemain à midi ! Néanmoins, personne ne se plaint, on aspire à pouvoir se coucher pour se remettre des émotions de la journée. Vers huit heures du soir, la porte s'ouvre, et nous voyons entrer un officier en état d'ivresse, cravache à la main (il s'agit de l'oberleutnant du camp). Il est accompagné de deux S.S. Sous prétexte que nous ne sommes pas au garde à vous, les coups pleuvent au hasard. L'oberleutnant s'acharne plus spécialement sur Désiré Mouffe, de Courcelles, mort plus tard à Breendonck dans les circonstances atroces que je rappellerai. Tard dans la nuit, j'entends un camarade pleurer, se tournant et se retournant sur sa paillasse comme un enfant qui souffre. Il pense que c'est le jour de l'An, il pense à ses enfants, à sa femme, à ses parents ! Dehors le vent mugit, et dans le calme de la chambre un des prisonniers demande avec émotion : « Quel est le sort que l'on nous réserve ? » Mais aucune réponse ne vient apaiser l'inquiétude de son cœur. |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
2 |
|||||||||||||||||
|
Breendonck
est situé dans la province
d'Anvers, à vingt-trois kilomètres au Sud de cette ville et à
quatorze kilomètres côté Ouest de Malines. C'est un petit village
agricole, traversé par le canal de Willebroeck. Il relève de
l'arrondissement administratif et judiciaire de Malines et du canton de
justice de paix de Puurs. Son sol est argilo-sablonneux, sa population
de 2.500 habitants ; son industrie est l'agriculture. Ses dépendances
sont : Breendonckstraat, Hoogedreef, Hoogheide, Pullaar, Reij-weg,
Veurt, Wolf.
De Breendonck, aucune communication avec l'extérieur. Les corps de ceux qui y meurent, de ceux que l'on fusille, de ceux que l'on tue, sont transportés hors du camp sans que personne puisse dire où ils vont... On les suppose enterrés à Beverloo. Dans le camp de Breendonck, les détenus ont le cœur rongé par l'attente. Ils se sentent effacés de la vie, plongés dans une sorte de léthargie d'où ils ne se réveillent par intervalles de conscience, que pour retomber dans un sommeil plus lourd et plus profond, sans rêves, sans même le souvenir d'une existence antérieure. Ils passent par des moments de désespoir, aggravés de doute et de haine. Cette haine, ils ne la ressentent pas seulement pour les autorités policières du bagne, pour les S. S., traîtres à leur patrie, mais encore pour certains détenus qui, par lâcheté, sont devenus des « moutons ». Nous les nommerons comme nous étalerons publiquement leur ignominie. Par crainte de ces « moutons », aucune allusion n'est faite à la marche supposée des opérations de guerre. Breendonck est un tombeau, c'est le camp du Silence ! Breendonck, c'est le bagne sous les coups de chicote, parmi les Boches et leurs acolytes belges, les S.S. Comme couvés par l'aile brûlante de la mort, plus de cinq cents détenus ! Derrière chaque butte de sable, une prunelle aux aguets ; derrière chaque coupole, une cravache dressée ; derrière chaque pierre, un pistolet armé. De loin en loin, un commandement bref : « Schnell ! » L'air est glacial, les corps sont transis, les ventres sont affamés, et, justement à cause de la faim, le cerveau est comme vrillé d'une tempe à l'autre. Des hommes tombent sous les coups. D'autres ont des vertiges, des hallucinations, hantés par l'envie de se coucher sur le sol, de mourir ! Breendonck ? C'est ça !Les S.S. du camp sont
des Belges... des individus qui, après la capitulation de 40, ont
demandé à être incorporés dans les sections d'assaut du nazisme. Ils
portent la tenue « feldgrau » avec, comme signe distinctif placé sur
la casquette, une tête de mort. Ce sont des êtres malfaisants, des
monstres... Ils tuent chaque jour. Jamais ils n'ont eu pitié. C'est à
eux que Breendonck doit sa sinistre appellation de camp de
Les S.S. sont des tueurs professionnels ; ils exécutent leur tâche monstrueuse, apportant un raffinement de cruauté dans l'exécution des assassinats qu'ils commettent quasi journellement ! Comment tuent-ils le plus souvent ? Ils arrivent sur les lieux de travail, puis, d'un commandement brutal, appellent les détenus. « Ici... creuser... vite ! » Sous la menace du revolver, des hommes se précipitent ; la terre molle commence à voler. Sur le sol, un détenu désigné au hasard... regarde, terrifié, les préparatifs de sa mort. Le S.S. vient à lui. Les souvenirs gardés forment un fond clair sur la toile de ma mémoire. L'atroce variété des tortures continuelles me fait revoir, comme alors, des figures curieuses, des événements violents, des âmes douloureuses. Mon reportage est fait de tout ce qui est arrivé sous mes yeux, de tout ce que j'ai observé et ressenti. Le même fil tragique relie tous ces événements, sombre drame illuminé parfois d'étranges lueurs. |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
3 |
|||||||||||||||||
|
Nous passons les premiers jours de notre détention à Breendonck sans aller au travail. On nous a coupé les cheveux ras et, à coups de cravache, on nous enseigne à longueur de journée la théorie du camp et ses commandements. Ceux-ci se font en allemand et c'est dans cette langue que nos demandes doivent être formulées La nourriture est insuffisante, elle est infecte. Nous avons faim et froid. Le 5 janvier, dans la matinée, le S. S. De Bodt entre dans la chambre et désigne vingt hommes pour l'accompagner. Ceux-ci ne rentreront que plusieurs heures après pour nous apprendre que dix poteaux d'exécution sont installés dans le camp. Sous les ordres du S. S. De Bodt, nos camarades ont dû renouveler la couche de sable qui entoure les poteaux et recouvrir les caillots de sang des exécutions précédentes. Pendant tout le temps qu'a duré cette sinistre besogne, De Bodt n'a cessé de les terroriser, leur disant qu'ils auraient leur tour et ajoutant qu'on fusillerait le lendemain. Durant toute la soirée et la nuit, nous ne faisions qu'en parler. Nous n'avions encore pu prendre contact avec les détenus des autres chambres et nous nous révoltions contre l'idée d'être fusillés sans jugement. « C'est pour demain matin », nous disions-nous. Le fort était calme ; on relevait la garde avec bruit dans les couloirs ; de la cour montaient les interpellations et les bruits de pas des sentinelles. Je ne sentais plus la douleur des coups reçus le jour de mon arrivée. Je n'avais plus ni faim, ni soif. Je restais l'oreille tendue, j'écoutais les bruits de la prison. La matinée qui suivit cette longue nuit ne fut guère moins cruelle à mes pauvres nerfs surexcités. Vers 7 heures du matin, l'oberleutnant et De Bodt entrèrent dans la chambre pour une distribution générale de coups de chicote. Ils crièrent de nous mettre au pied des lits, le S.S. ajoutant : « Vous allez connaître Breendonck ! » Tous pensaient que leur dernière heure allait sonner ! Après leur départ, tous les yeux restaient fixés sur la porte, s'attendant toujours à la voir s'ouvrir devant celui qui apporterait l'ordre fatal. Ce ne fut qu'à neuf heures trente que nous eûmes conscience qu'aucun de nous ne serait fusillé. A ce moment-là, des
officiers allemands et des S.S. arrivent dans le couloir, poussant
devant eux dix détenus. Ceux-ci doivent enlever leur veste et sont
introduits dans la chambre n° 1. Pour nous qui sommes à Breendonck
depuis quelques jours seulement, ces allées et venues n'ont encore
aucune signification quand soudain nous voyons deux camions de
Un voile se déchire : les camarades qui viennent d'être introduits dans la chambre n° 1 vont être exécutés. Nous sommes au pied des lits, dans la position du garde à vous. L'émotion que nous ressentons est intense, quelques-uns de nos camarades prient, d'autres pleurent. On entend des échanges de propos angoissés qui tous se rapportent à la tragédie qui va s'accomplir. Trente minutes se sont écoulées depuis que les prisonniers ont traversé le couloir et les voici déjà, s'alignant à la file indienne, devant les fenêtres de notre chambre. Ils ont une capote de soldat belge jetée sur leurs épaules, leurs mains sont liées, ils n'ont rien sur la tête, et tels que nous les regardons, ils nous apparaissent auréolés de la gloire des martyrs. Tous se tiennent droits. Leurs regards ne trahissent aucune faiblesse, aucune crainte. Je revois comme alors la figure de l'un d'eux, narguant un officier allemand, suprême défi qu'il lui portait, ainsi qu'à sa clique, avant de tomber. Les autres, par leur attitude courageuse, les frappaient de leur mépris. Chaque condamné était escorté d'un soldat allemand. Suivie des S.S. qui riaient, la file des suppliciés s'achemina vers les poteaux. Dans notre chambre, un détenu, Fernand Daumeries, de Jumet, fait appel aux croyants, leur demandant de prier avec lui à haute voix pour le repas des camarades qui, à ce moment, arrivent dans la cour du fort. Plus loin, je reviendrai sur le rôle abject que le même Daumeries devait jouer par la suite. Chez cet individu, tout était hypocrisie et calcul. Cependant, nombreux furent en cette triste journée ceux qui manifestèrent sincèrement leurs sentiments religieux. Il y avait à peine cinq minutes que les condamnés étaient soustraits à nos regards lorsque nous entendîmes un bruit de salve, suivi, peu après, de coups isolés. Le peloton venait d'obéir au commandement suivant : « Telle est la volonté du Führer ! Heil Hitler ! Feu ! » Dix Belges gisaient sanglants au pied des poteaux de Breendonck. Peu après, au travers les fenêtres grillagées de notre prison, nous vîmes les officiers revenir précipitamment et pousser à nouveau dix autres détenus dans la chambre n° 1. Trente minutes après, la scène douloureuse que nous venons de narrer se répétait, et à 11 heures, ce jour-là, vingt hommes avaient payé de leur vie leurs sentiments patriotiques.A 11 h. 30, les camions de Croix-Rouge quittaient le fort, emportant les corps des fusillés. Ce mercredi 6 janvier 1943, personne ne dut aller au travail. A midi, une gamelle de soupe noirâtre faite d'eau tiède, de choux mal lavés et à moitié cuits nous fut servie. De notre chambre, nous pouvions voir déambuler les officiers allemands et les S.S. du camp dans la cour avec un air de victoire. Plus tard, à la soirée, nous apprîmes qu'ils se soûlaient à la cantine. Vers 11 heures du soir, des hurlements nous parvinrent. Le bruit d'une cravache tombant avec force se faisait entendre. Bientôt ces bruits devinrent tellement épouvantables qu'aucun de nous ne pouvait plus dormir. Assis sur notre paillasse, nous écoutions, laissant à notre imagination le soin de trouver une explication au véritable sabbat qui nous parvenait. Il faut ajouter que les longs couloirs du fort répercutaient les bruits avec force. L'obscurité dans laquelle la chambre était plongée ajoutait une note sinistre à ce qui se déroulait et les hurlements qui se faisaient entendre étaient des hurlements de mort. Après un temps qui nous parut bien long, le calme revint. Tous allaient essayer de retrouver le sommeil, quand des pas précipités se rapprochèrent de la porte de notre chambre. La barre de fermeture fut tirée de l'extérieur, en même temps que la lumière se faisait. L'oberleutnant entra, accompagné du S.S. De Bodt. Tous deux étaient dans un état d'ivresse très prononcé. Ils titubaient, l'œil mauvais, la bave à la bouche. Leur attitude ne pouvait nous laisser aucun doute sur ce qui allait se passer. Dès leur entrée, le chef de chambrée, un certain Calomnie, de Marchiennes, cria : Achtung ! terme allemand rendu obligatoire à Breendonck, et qui, dans les us et coutumes du camp, signifiait que nous devions nous mettre au pied du lit dans la position du garde à vous. Aucun de nous n'avait eu le temps de passer son pantalon, et c'est dans une tenue plus que sommaire que nous dûmes subir les coups que nos deux tortionnaires se mirent à nous asséner. Ainsi s'est terminée la journée du 6 janvier 1943, marquée de vingt exécutions, d'un assassinat commis dans une cellule sur la personne d'un détenu et de scènes d'une brutalité inouïe commises par un officier supérieur de l'armée allemande et un Belge traître à sa patrie, le S.S. De Bodt. |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
4 |
|||||||||||||||||
| La caserne Trésignies de Charleroi eût semblé un paradis en comparaison de la prison politique de Breendonck. Les chambres étaient petites, sordides, mal aérées, un eau sale coulait sur les murs. Tous nos effets, tous nos objets personnels nous avaient été enlevés. Il nous était défendu de lire, d'écrire, de rien recevoir de l'extérieur. Fumer une cigarette ou être en possession de tabac ou d'allumettes pouvait amener la mort. | |||||||||||||||||
 |
 |
 |
 |
||||||||||||||
|
Le major SCHMIDT, |
Deux traîtres notoires - un chef gestapo d'Anvers et un leader NVN d'Anvers - sont mis en sécurité. | Mur de cellule avec ses graffiti. | Les cellules de Breendonck. | ||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||
|
Bourreaux et gestapos méditent devant les lieux d'exécution. |
Une salle de torture à Breendonck. | ||||||||||||||||
|
Durant les quinze premiers jours de ma détention, je perdis toute envie de dormir. Je ne puis guère parler d'insomnie dans mon cas, l'insomnie étant un état maladif dans lequel, malgré la fatigue, on désire dormir sans pouvoir y réussir. Mentalement je me sentais tout à fait normal, mais déjà j'avais maigri et je m'étais affaibli physiquement au point d'éprouver la nécessité de réduire au minimum tous mes mouvements. Le coup de pied reçu à la jambe le jour de mon arrivée formait une large plaie qui ne cessait de suppurer. Cette blessure m'inquiétait, car je savais que je n'aurais, à Breendonck, aucun médicament, aucune pommade antiseptique susceptible de me soulager. Le 12 janvier au matin, alors que les colonnes étaient formées pour partir au travail, un prisonnier de plus de 60 ans s'affaissa dans les rangs. Ses jambes étaient couvertes d'ulcères. Le lieutenant allemand du camp lui fit retrousser ses pantalons et, en l'injuriant, se mit à lui cracher sur les jambes. En même temps, il lui portait des coups de cravache, obligeant ce malheureux à se relever et à aller travailler. Tel était le régime médical du bagne, et, pas plus que mes compagnons, je ne l'ignorais. Il était curieux d'observer le changement de caractère des prisonniers ainsi obligés de vivre constamment ensemble entre quatre murs. Des hommes cultivés et sérieux se querellaient pour des bagatelles parce que l'un d'eux, par exemple, avait pris un plus gros morceau de pain ; devenus ennemis, ces réprouvés refusaient de se serrer la main. Les conditions péniblement anormales de l'existence en prison, la nécessité déprimante de se trouver en contact permanent pendant de longs mois avec des compagnons imposés par les circonstances, créaient d'étranges situations. Je n'ai, moi-même, pu échapper à cette sorte de « psychose de détention ». J'ai, dans de pareilles conditions de vie, connu cette influence profondément démoralisante. J'ai aussi connu tantôt la torpeur maladive qui rend indifférent à tout, ce silence morbide qui étouffe les facultés mentales, tantôt l'irritation exaspérée qui éclate soudain avec violence. J'ai parfois été incapable de maîtriser ma colère, oubliant alors jusqu'à ma dignité d'homme. De notre lieu de travail, nous pouvions apercevoir les maisons du village. A ces moments, le sentiment de la liberté perdue devenait plus vif et tout l'organisme réagissait aussitôt violemment. La liberté n'est-elle pas en effet la condition essentielle de la vie humaine consciente ? Les jours, les semaines passèrent. La vie au camp était loin d'être calme. De temps en temps, comme une bouffée de vent, nous arrivaient des nouvelles de l'extérieur. Le bagne était plus rempli que jamais. De nouveaux détenus arrivaient constamment de partout. Un jour, on amena un nouveau groupe parmi lequel se trouvait le vicaire de Courcelles, le docteur Camille Jeuniaux, de Montigny-sur-Sambre, et Franz Falony, instituteur, qui avait été mon compagnon de jeux lorsque, enfant, je fréquentais l'école primaire. Je crois qu'ils venaient de la prison de Charleroi. Tels étaient les événements qui venaient rompre la monotonie de notre existence en y apportant un surcroît de tristesse. |
|||||||||||||||||
|
Chapitre 5 |
|||||||||||||||||
|
A quatre heures quarante-cinq, le 13 de ce mois de janvier, les barres de fermeture des portes furent tirées ; il fallait quitter sa paillasse. Dix minutes à peine s'étaient écoulées qu'un appel retentit. Nous commencions à nous faire aux répétitions journalières des commandements allemands et ce fut en nous bousculant les uns aux autres que nous nous plaçâmes par rangs de trois dans la partie de couloir faisant face à notre chambre. A droite et à gauche s'alignaient les prisonniers des autres chambrées. Le feldwebel de service s'arrêtait devant chaque « zug führer », qui, en langue allemande, lui présentait les prisonniers. Pendant ce temps, nous étions tenus de rester au garde à vous et de suivre des yeux le feldwebel dans tous ses mouvements. Habituellement, le Boche nous comptait et nous intimait l'ordre de rentrer. Ce jour-là, il nous fut signifié d'avoir à rester où nous étions. L'appel était à peine terminé, et déjà, malgré l'heure matinale, nous parvenaient les vociférations des S.S. et des officiers du camp. Bientôt des hurlements, des plaintes, les hommes tombaient sous les coups de cravache, de chicote, mais nous ne nous étonnions plus de ces procédés de la plus pure sauvagerie, il fallait subir et se taire. Sans encore pouvoir nous l'expliquer, nous sentions qu'un événement allait se produire, mais quoi ? Aucun n'aurait pu le dire. Les figures de nos bourreaux grimaçaient sous leur masque de cruelle méchanceté, ce qui faisait dire à la plupart des nôtres, car les espoirs les plus fous ne nous quittaient jamais : « Ça va bien mal pour eux, et pour les voir dans un pareil état, il faut que des revers d'importance leur soient arrivés ! » Que nous étions loin de la vérité, et cependant nous pouvons affirmer que ce sont ces mêmes espoirs qui, au cours des mois qui suivirent, allaient nous soutenir au milieu des privations inhumaines qui nous étaient imposées, et des traitements barbares qu'on nous infligeait. Le découragement moral à Breendonck, c'était la mort en peu de semaines, le relâchement physique entraînait une mort immédiate et affreuse dont nos lecteurs auront un avant-goût dans les prochains chapitres. Sous les commandements, nous fûmes dirigés vers la cour intérieure du fort, où, une chambre à la fois, il nous fut permis de nous rendre aux urinoirs et aux W.-C. A l'entrée de ceux-ci, se tenait un S. S. qui nous laissait à peine le temps de satisfaire nos besoins, et ses cris : « Schnell ! Schnell ! » s'élevaient dans la nuit. Notre sortie n'avait pas duré dix minutes que déjà la voûte du couloir résonnait longuement sous le bruit de nos pas. Malgré le peu de temps durant lequel nous avions été dehors, il nous avait été possible de remarquer que les sentinelles placées dans la cour et à hauteur des fenêtres des chambres étaient doublées, et qu'en plus de leur carabine d'ordonnance, chacune était munie de deux grenades passées au ceinturon. Durant les heures qui allaient suivre et jusqu'à ce qu'un jour blafard nous permette de distinguer les contours du fort, le « zug-führer » nous fit rester au pied du lit. Que se passait-il, et pourquoi ces coups, cette précipitation ? Vers 9 heures (l'un de nous était parvenu à garder sa montre), des bruits de moteur se firent entendre, et au travers des carreaux de la fenêtre nous vîmes arriver deux camions de Croix-Rouge chargés de cercueils. Etait-ce possible ? Cependant, nous ne pouvions nous tromper, les sinistres boîtes dépassaient le gabarit des véhicules, et comme pour nous fixer sur ce qui se préparait, un bruit de bottes nous parvint, amplifié par la résonance de la voûte de la galerie dans laquelle ils étaient engagés. Tout de suite après, nous les vîmes tels qu'il nous avait été donné de les voir le mercredi précédent. L'arme à la bretelle, ils se rendaient là où vers le ciel dix poteaux dressaient leurs cônes, sur une même ligne, distancés entre eux par un intervalle d'un mètre. Derrière les poteaux, dans la direction des balles, une haute butte de sable. Devant les condamnés, le mur épais d'une redoute. A six mètres, et face aux suppliciés, le peloton d'exécution. Quarante fusils, quatre pour chaque condamné ! A gauche du sable encore. A droite la plaine, la rivière, les sentinelles, les barbelés, et loin à l'horizon le clocher de l'église de Breendonck. Les minutes s'écoulaient, nous écoutions les allées et venues des officiers et des S. S. De temps en temps, ils venaient coller leur visage aux vitres des fenêtres afin de s'assurer qu'aucun de nous n'avait quitté l'alignement. Le silence nous pesait, et l'immobilité dans laquelle nous nous trouvions depuis des heures nous laissait sans force. Soudain, des condamnés s'arrêtèrent devant nos fenêtres. Accompagnant leurs ordres de coups, les S.S. leur firent enlever leur veste, ainsi que leur chemise, et, chose à peine croyable si nous ne l'avions vue, on frappait des hommes qui allaient mourir ! Mais le voile destructeur des années n'enlèvera jamais à nos souvenirs l'évocation de ce qui va suivre : Sous les yeux cruels des officiers du bagne, les condamnés enlevaient leur veste, leur chemise, et pendant cette préparation à la mort, le S.S. De Bodt leur portait des coups. Chez les suppliciés, pas un cri, pas une plainte, et j'en appelle au témoignage des centaines de mes camarades du « lag ». On les poussa dans la chambre 1, où ils furent suivis par la clique policière, sans en excepter la femme du major, qui riait en passant devant nos fenêtres. Toute notre attention se reporta vers la cour. Assis sur un brancard et porté au lieu du supplice par deux soldats allemands, un condamné paraissant âgé d'une trentaine d'années faisait aller sa tête de droite à gauche, ses yeux fixés sur les nuages, fixés vers le ciel. Il avait le cou tendu, on devinait ses membres raidis par la volonté, car malgré le cahotement provoqué par la marche de ses porteurs, son buste n'avait aucune oscillation. Nous devions apprendre par la suite qu'en vue de lui arracher des aveux, on avait, quelques jours avant, traîné cet homme à la chambre des tortures. On lui avait brisé les membres inférieurs et telle était la raison pour laquelle on le portait ! Le courage de ce camarade était simplement magnifique. Nous le suivions des yeux, les mâchoires serrées, sans perdre aucune des expressions de sa physionomie. Non, cet homme n'avait pas peur, et qu'il m'est pénible de ne pouvoir citer son nom aujourd'hui. Plus tard, n'en doutons pas, l'hommage posthume qu'on lui doit lui sera rendu. Trois, quatre minutes passèrent encore, un feu de salve, l'exécution avait eu lieu. Vingt minutes après, la porte de la chambre 1 fut ouverte. Dix condamnés en sortirent ; dix soldats les attendaient dans le couloir et leur lièrent les poignets. Une capote belge couvrait chaque prisonnier. Leur marche était sûre, aucun ne baissait la tête et il n'était nullement besoin de la main du Boche qui les tenait pour les diriger. L'un derrière l'autre ils arrivaient dans la cour au moment où, chassés par le vent, les nuages disparaissaient. Que l'on n'aille surtout pas s'imaginer que nous nous efforçons d'apporter à cette vision d'enfer un lyrisme qui serait, en ces douloureuses circonstances, du plus mauvais goût. Mais dans tout ce qui se passait devant nous, rien n'aurait pu nous échapper, le moindre détail se marquait en nous pour ne plus pouvoir s'effacer. C'est vrai que le ciel était bleu et qu'un pâle rayon de soleil éclairait cette scène dantesque. Nos camarades avançaient toujours, et sans doute qu'aux dernières minutes de leur vie ils revoyaient en une suite de tableaux précipités tout le film de leur courte existence. Ils revoyaient l'école où, enfant, on leur avait appris à aimer la patrie. Ils revoyaient l' image d'une maman câline, celle d'un père aimé, d'une sœur, d'un frère qu'ils affectionnaient, d'une femme chérie, d'enfants adorés. La présence invisible des êtres chers les accompagnait dans cette suprême étape, dérobant à leurs yeux toute la mise en scène de cette matinée sanglante. Ils ne devaient voir ni les soldats, ni les poteaux, ni même les cercueils. Jusqu'au moment de la fusillade, ils furent soutenus par la force aimante de tous ceux qu'ils voulaient revoir et qui, fidèles, se trouvaient à ce dernier rendez-vous. Derrière le peloton d'exécution, un aumônier militaire élevait devant eux l'image de Jésus sur sa croix ! Telle était l'idée que nous nous faisions de l'état d'esprit qui avait dû animer nos malheureux compagnons dans les dernières minutes de leur vie. Trente minutes s'écoulèrent, dix autres condamnés apparurent. Chez nous, c'était l'horreur, l'angoisse. Il faut se rappeler que nous n'étions à Breendonck que depuis treize jours et déjà nous avions vu quarante et un hommes marcher au poteau. Le processus qui avait présidé aux exécutions précédentes se renouvela pour les dix prisonniers qui foulaient à présent le sol de la cour. L'un d'eux était chaussé de sabots et traînait un pied, le gauche, dont le sabot était dépourvu de bride. Pour qu'il puisse régler son pas sur celui des suppliciés qui le précédaient, le soldat qui le suivait lui fit abandonner son sabot, mais que pouvait, après tant d'autres, lui inspirer cette dernière cruauté, puisqu'il allait mourir, puisque déjà il se trouvait en la compagnie mystique des aimés ? Le 13 janvier 1943, le sang de vingt et un martyrs pénétrait le sable maudit de Breendonck. A dix heures cinquante minutes, vingt et un cercueils quittaient le fort et les portes de fer se refermaient sur des centaines de prisonniers |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
6. |
|||||||||||||||||
|
Lorsque je dis premier décès, il faut comprendre que c'était le premier dans notre chambre depuis notre arrivée, car chaque jour des hommes mouraient à Breendonck. Décès n'est pas juste non plus, puisqu'il faut entendre par là mort survenue par l'âge, l'accident ou la maladie. Ici, rien de pareil. Qu'on en juge par le récit qui va suivre. A la caserne de Charleroi déjà, pendant la promenade, j'étais entré en conversation avec Octave Burgeon, de Leval, petite localité industrielle située près de Binche, dans la province du Hainaut. Burgeon avait atteint la cinquantaine. Son air méditatif et un peu triste s'accordait bien avec la pâleur de son visage. En différentes occasions, nous avions pu entrer en conversation. Dans son patois du Centre, il m'avait parlé de sa femme qu'il aimait, de son fils dont il ne pouvait prononcer le nom sans que les larmes ne lui coulent des yeux, car son enfant était dans un stalag, et depuis des années il attendait le jour où, enfin, il pourrait l'embrasser. Le reverrait-il jamais ? C'était déjà, à Charleroi, l'idée dominante de toutes ses pensées ! A Breendonck, Octave Burgeon restait le même. Calme en apparence, mais toujours, une fois rentré dans la chambre, accroupi dans un coin, cherchant la solitude : le front penché sur les genoux, en proie au plus sombre désespoir. En ces moments, nous en étions certains, Octave Burgeon prisonnier s'oubliait pour ne plus penser qu'à un autre prisonnier : son fils! L'atmosphère de terreur du camp, les traitements ignobles dont chacun était l'objet, avait produit chez cet homme paisible et doux un effondrement physique tel que chaque jour nous en constations les effets. Ses joues se creusaient davantage, les pommettes faisaient, de façon impressionnante, saillie sur chaque côté de la figure, la faim le rongeait aussi et pourtant à aucun de nous il ne se plaignait. Sous une apparence chétive, Octave gardait une volonté inébranlable, celle de souffrir seul, car nul mieux que lui n'avait compris ce qu'était l'isolement des geôles de Breendonck. En outre, les traîtrises, les tueries avaient produit en son âme sensible un renversement complet sur l'idée qu'il se faisait des sentiments de bonté et de charité humaines. |
|||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||
| Jean-Marie SCHWANEN, de Gilly, martyrisé à Breendonck. |
Willy
COLASSIN, de Jumet, à sa sortie de Breendonck. |
Auguste LELEU, de Châtelet, un enfant que les S.S. ont tué. | Désiré MOUFFE, de Courcelles | ||||||||||||||
 |
 |
 |
|||||||||||||||
|
Les policiers de Jumet photografiés lorsque leur état de santé put leur permettre de sortir: De gauche à droite, en commençant par le bas: Jean GOISSE, Emile RENARD, Ursmar CAMBIER, Fernand HUET, Louis DEHOUX. |
M. BURFEON, de Leval-Trahegnies. |
Léon BEELDENS, mort à Breendonck le 3 mai 1943. |
|||||||||||||||
|
Le jour vint bientôt où notre camarade fut vidé complètement. Un travail opiniâtre, la faim, le froid, la fatigue, les coups ajoutés à son chagrin l'avaient rendu méconnaissable. Seuls les yeux vivaient encore, de grands yeux noirs brûlés de fièvre. Le reste n'était plus qu'un squelette, un pauvre corps aux extrémités déjà glacées, car la mort allait le ravir à tous ceux qu'il affectionnait. Octave Burgeon est mort sur une misérable paillasse. Ses yeux pleins de leurs dernières larmes, il eut, avant de mourir, ces paroles poignantes : « D'jarre tant v'lû rébrassi m'femme ayès m'n'infant avant d'mourî !» (2) Que sa famille trouve en ces lignes le témoignage de la douleur sincère de tous ceux qui, à Breendonck, vécurent avec Octave. Burgeon et les autres qui connurent la fin dans ce bagne ont été tués ! Selon les principes du camp, la place de tous ceux qui ne pouvaient plus travailler était à la morgue. Après la libération, le Gouvernement aura aussi pour tâche de veiller au bien-être des familles de ces hommes du devoir et du sacrifice. |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
7 |
|||||||||||||||||
|
Le 27 janvier 1943, nous avions commencé notre travail aux bennes vers 9 heures. Il restait des milliers de mètres cubes de sable à charger, et malgré le froid d'une bise glaciale, les S.S. Weiss et De Bodt nous avaient ordonné d'enlever vestes et pull-over. Les membres transis : pieds à demi gelés, mains bleuies et gonflées par le froid, visages pâlis aux orbites enfoncées, figures creusées par la souffrance, les privations ; le ventre affamé, nous commencions, sous les commandements et les coups de chicote, à charger. Certains indices nous
avaient permis d'augurer que cette journée serait émaillée de scènes
d'atrocités. Déjà, durant la dernière nuit, nous avions été réveillés
par les cris de souffrance de détenus soumis à la torture. Des
cris ? Non, des hurlements qui n'avaient plus rien d'humain et qui glaçaient
les plus braves. Le bruit mat des chicotes nous parvenait avec celui des
injures proférées par les instructeurs. Il ne se passait pas de semaine
que On pouvait dire de ceux qui revenaient de ces interrogatoires de nuit qu'ils avaient avoué, car les autres étaient frappés jusqu'au dernier souffle de vie. J'ai vu revenir de ces interrogatoires un jeune homme de moins de vingt ans dont je n'ai pu retenir le nom, mais originaire de Walcourt (Namur). Il dut, en partie, reconnaître les faits qu'on lui imputait. Les tortures qu'il venait de subir l'avaient rendu sourd ! Bref, pour en revenir au 27 janvier 1943, disons qu'à 8 h. 45 du matin, l'appel : « Austritt von arbeit » (3) sa fait entendre. Sitôt après, la garde allemande passe de chambre en chambre et libère chaque porte de son système de fermeture. Au même instant, vociférés par les S.S., les cria de « Schnell ! Schnell ! » retentissent. Nous nous précipitons vers la sortie pour prendre notre alignement. Celui-ci se fait, sous les coups de chicote, dans un long et étroit couloir. Les détenus se bousculent, chacun tentant d'échapper aux coups des brutes qui nous terrorisent. Des camarades ont la figure ensanglantée : d'autres, les reins meurtris, sont tombés. Le désordre règne dans les rangs, une surprise douloureuse se remarque sur bien des figures, on se demande quel est le motif de ces actes de sauvagerie mais il faut refaire l'alignement et, de nouveau, te nerf de bœuf trace ses sillons sanglants ! Weiss et De Bodt, ces criminels-nés, paraissent ne pas devoir s'arrêter. Ils assènent leurs coups en poussant des « han ! » formidables, les yeux leur sortent de la tête, une expression diabolique est peinte sur leurs traits, la bouche est tordue par un rictus affreux ; ils frappent, frappent. Quand donc s'arrêteront-ils ? Un commandement retentit, la colonne se met en marche, ce qui décide nos assommeura professionnels à cesser leurs dangereux exercices... Mais le travail était à peine commencé que les S.S. se mirent à courir d'une benne à l'autre et à frapper avec une telle sauvagerie que nous nous demandions s'ils n'étaient pas devenus fous. Hélas ! ils allaient le devenir, une folie criminelle allait s'emparer d'eux. Outre les S.S., il y
avait pour nous surveiller, tant dans les chambres qu'au travail, les
détenus que leur mouchardise avait fait nommer « zug führer ». Je
citerai pour commencer le nommé Fernand Daumeries, de Jumet (Hainaut),
boucher dans la rue de
Vers dix heures, l'oberleutnant s'amena, lui aussi, accompagné d'un gros chien berger allemand. Poussées chacune par quatre détenus, les bennes s'acheminaient vers la rivière qui entoure le camp. A ce moment, l'officier allemand commanda au chien d'attaquer, et, excitée par son maître, la bête se mit à mordre jambes et cuisses lui tombant sous la dent. Tenter quoi que ce soit pour éloigner l'animal, c'était aller au-devant d'une mort certaine, et tous le savaient ! J'ai vu des camarades pleurer de souffrance, pleurer de se sentir sans défense contre leurs innommables tortionnaires. Ils riaient, nos bourreaux, et leurs plats valets, les « zug-führer », en faisaient autant. Du côté de la rivière avait lieu le déchargement. Une quarantaine d'hommes se livraient au remblaiement avec le sable que nous apportions. Les S. S. transportèrent en ce secteur le théâtre de leurs tristes exploits. Trois hommes furent appelés par Weiss et De Bodt. Pendant trois quarts d'heure, ils furent frappés à coups de poing, de pied, de chicote. Couchés sur le sable glacé, ils ne formaient plus qu'une masse informe et sanguinolente. A 11 h. 30, le signal de rentrée fut donné, et, portés par les camarades, ils purent regagner leur chambre. A 13 h. 30, tous les détenus étaient à nouveau rassemblés dans la cour pour partir au travail. Au commandement, les colonnes prirent la cadence. Elles étaient précédées par l'équipe de la rivière qui, comme deux heures plus tôt, portait ses trois malheureux compagnons. Leur figure était tuméfiée et une bave de sang leur sortait de la bouche. Leurs bras pendaient si lamentablement et c'est au lieu de leur supplice qu'on les ramenait... Dans l'état où ils se trouvaient, il leur était impossible de pouvoir même se tenir assis et c'est au travail qu'on les envoyait ! Le pire allait commencer. Suivie des S.S., l'équipe de la rivière dut déposer les suppliciés sur le talus de sable. Weiss et De Bodt firent rouler, l'un après l'autre, les trois hommes dans l'eau glacée. Ils en furent retirés ensuite et enterrés jusqu'au cou dans le sable maudit. Les souffrances et la frayeur agrandissaient leurs yeux noyés de larmes. Rien n'était plus sinistre à regarder que ces trois têtes sortant de terre et, cependant, les S.S. riaient ! Weiss et De Bodt se mirent à jeter des pelletées de sable à la figure de leurs victimes. C'était à celui qui viserait le mieux et ils s'y exerçaient du haut du talus. J'ai souvent pensé depuis à la force de vie qu'il pouvait y avoir chez un homme, car à 15 h. 30 ils vivaient toujours ! A ce moment, nous venions de ramener les bennes, lorsque l'oberleutnant s'avança vers Fernand Daumeries en lui disant : « Annoncez aux hommes qu'une cigarette sera donnée à chacun des quatre détenus de la benne qui sera chargée la première. » II restait une demi-heure à travailler. Sous les coups de chicote. les bennes s'emplissaient. Quatre hommes se détachèrent et vinrent s'aligner devant l'oberleutnant, qui leur remit à chacun une cigarette qu'ils devaient allumer et fumer immédiatement, face, cette fois, aux autres prisonniers.Dans l'entre-temps, les trois enterrés de la rivière avaient été dégagés et ramenés dans une benne, que l'on venait de culbuter aux pieds de l'officier allemand. Weiss et De Bodt déculottèrent les suppliciés et se mirent à les enduire de boue. Aucune des parties du corps ne fut préservée, mais comme la vie défiait encore ce supplice, les deux traîtres se saisirent d'une cigarette qu'ils portèrent à la bouche des malheureux. En écrivant ces horreurs, je les revois et suis toujours à me demander comment ils ont pu ouvrir leurs lèvres, car ils les ont ouvertes, je l'ai vu. Que pouvaient-ils espérer ? Mais ce que j'ai vu aussi, c'est Weiss et De Bodt en profiter pour leur remplir la bouche de boue ! Puis, ce furent les oreilles, les yeux, plusieurs coups de pelle qui amenèrent en ces corps quelques soubresauts et — la mort... enfin ! Ils étaient étendus côte à côte, nus et méconnaissables, tués après une succession de scènes de la plus ignoble barbarie. Mais ce qui me parut au moins aussi monstrueux, ce fut d'entendre au même moment la voix de Fernand Daumeries s'élever et crier : — Monsieur l'oberleutnant vient d'avoir un geste magnifique en offrant une cigarette à quatre détenus. Vous allez tous crier avec moi : Heil pour l'oberleutnant ! Il gueula, seul, son vivat pour l'assassin ! Le 27 janvier 1943, vers 16 h. 15, une colonne de près de 300 détenus regagnait le fort. En queue, une charrette à bras tirée par cinq prisonniers, et, sur cette charrette, trois cadavres que le crépuscule naissant tentait bien en vain de cacher à nos yeux terrifiés. Si nous fûmes des centaines à assister, impuissants, à ces mises à mort d'une férocité inouïe, il ne faut pas oublier que les S.S. agissaient sous le couvert d'un cordon de sentinelles, qui nous tenaient en respect avec leurs mitraillettes et qu'une mitrailleuse montée sur pivot pouvait à tout moment balayer le carré. Dans ces conditions, une révolte était vouée au plus sanglant échec. En cette journée du 27 janvier 1943, Fernand Daumeries fut le plus certain des lâches et bientôt nous allions connaître le Daumeries criminel ! Tortures au détail et assassins en gros Roger
Poquette,
originaire de Marcinelle, province de Hainaut, était un ouvrier mineur
que ses idées avaient signalé à l'attention de
Malgré ce qui précède, Roger conservait un moral excellent et savait, à l'occasion, trouver le mot pour rire. Ses vantardises, même, étaient admises, car on savait que Poquette n'aurait pu se laisser aller à trahir l'un ou l'autre de ses compagnons de chaîne. Incapable de taire ce qu'il pensait, il lui était arrivé de dire à Daumeries : « Grand fènêyant, èl djoû qui dji vud'ré d'idci, t'arras à pwènne èl' timp d'mètte tes pîds su l'pavêe qui dji t'cass'rai t'gueule. » (4) Dans ces occasions, nous ne laissions jamais Poquette à ses seuls reproches et étions toujours cinq ou six à démontrer à Daumeries l'odieux de sa conduite. Ce fut à l'occasion de l'une de ces scènes que le précité s'écria avec force : « Nous sommes ici quarante-huit, mais même s'il faut en faire crever quarante-sept pour sauver ma peau, je le ferai ! » Dès ce moment, nous comprîmes que Daumeries ne reculerait devant aucune saleté, aucune lâcheté pour, comme i1 le disait lui-même, sauver sa peau. J'entrepris de raisonner Poquette, ce qui n'était guère facile, m'efforçant de lui faire comprendre qu'il valait mieux, pour l'instant, mettre son poing dans sa poche. Roger acquiesçait sur le moment, mais une heure après il semblait avoir tout oublié et recommençait. Il arriva qu'un jour, peu de temps avant de nous étendre sur notre paillasse, Roger remua à nouveau toutes les crasses du boucher de Jumet. Celui-ci laissait dire, car il voulait avoir le dernier mot, et sitôt que son adversaire se tut, il laissa tomber les paroles suivantes : « Dimwain, Poquette, quand t'arriv'ras sur l'travaû, on t'mett'ra i'satch. »(5) La croyant vaine, personne ne releva cette réplique, mais le lendemain, à peine étions-nous poussés au travail que Poquette fut appelé auprès du S.S. Weiss, qui lui asséna de terribles coups de chicote. Roger tombait, se relevait, pour tomber encore ; des stries sanglantes balafraient son pauvre visage, tandis qu'aux côtés de la brute qui frappait, un autre traître, Daumeries, ricanait. Enfin il la tenait, sa vengeance, et son regard nous défiait ; il nous réserverait le même sort s'il nous arrivait de nous dresser encore contre lui. C'est en titubant que Poquette, sur l'ordre du S.S., partit chercher un sac. Il s'agissait de sacs de l'armée belge, dit sacs à poils, bourrés de pierres. Leur poids était de 40 kilos. Je n'exagère pas en disant que Roger ne pesait plus 40 kilos ! Vous auriez pleuré, lecteurs, à le voir revenir... Il pliait sous le faix, tendait le cou et respirait en saccades par la bouche. Avec les pauvres paroles de courage que nous lui prodiguions, notre malheureux compagnon parvint, en travaillant, à résister jusqu'à l'heure de la soupe. Son sac fut posé près des bennes, car il devait le reprendre durant les heures de travail de l'après-midi. Rentré dans la chambre, il n'eut plus une parole pour Daumeries, il se jeta sur sa paillasse et se mit à pleurer. Chaque fois que sa poitrine se soulevait, nous entendions comme un bruit de soufflet, un bruit de râles, et sa figure marquée par la chicote prenait une teinte grise. N'importe lequel parmi nous aurait voulu tuer Daumeries, mais là, à Breendonck, ce n'était pas possible. L'après-midi et jusqu'à la fin de la journée, le petit Roger fit appel à toute sa volonté, tendit ses nerfs pour ne pas tomber, chargea et roula les bennes de sable. Sans cesse il s'informait de l'heure qu'il pouvait être, ses jambes se dérobaient, il ne tenait plus que par un effort surhumain de volonté. Jusqu'au coup de sifflet marquant la fin de la journée, las S.S. surveillèrent notre équipe. Poquette rentra, soutenu par deux camarades. La peau de sa figure était tirée, rétrécie ; les lèvres s'apercevaient à peine, le nez était aminci, et, sous les yeux, de fortes protubérances. Au faciès squelettique que nous rappelons s'ajoutait la détresse d'un corps qui n'en pouvait plus, qui semblait supplier pour qu'on le laisse tranquille. Roger fut étendu, on lui donna à boire, que pouvions-nous faire de plus ? Bien peu purent dormir, car de toute la nuit il ne cessa de se plaindre. Le lendemain matin, il ne put quitter sa paillasse, et à ce moment tous sentaient qu'il allait mourir. Les S.S. vinrent s'assurer qu'il était impossible de le mettre sur ses jambes, et quelques heures après, à notre retour, nous apprîmes que la froide main de la mort venait de lui clore les yeux. Roger Poquette était mort victime des criminels Weiss et Daumeries. Le lendemain du jour où Poquette était mort, Weiss interpella Daumeries sur le chantier en lui disant que les prisonniers ne travaillaient pas assez vite. Immédiatement, le dernier nommé se mit à crier : — Plus vite, bande de fainéants ! Chargez les bennes, remplissez les coins ! Schnell ! Schnell ! Weiss regardait, impassible en apparence, mais nous savions que tous étaient observés. A un certain moment, Daumeries s'avança au pied d'une butte de sable et se mit à invectiver notre camarade Désiré Mouffe. Celui-ci n'allait pas assez vite au gré du chien de garde des S. S. L'aurait-il pu ? Mouffe souffrait depuis plusieurs jours d'un anthrax placé à l'occiput. Cela faisait une bosse énorme avec, au centre, un trou large et profond d'où coulait le pus, d'où s'échappaient des bourbillons de matières renfermées dans les mailles du tissu cellulaire qui est sous la peau. Aucun médicament, aucun calmant, même pas une compresse d'eau, et depuis des jours, Désiré travaillait la tête inclinée sur la poitrine, serrant les mâchoires pour ne pas hurler de souffrance. La veille encore, son voisin de lit, Robert Stass, de Lodelinsart (Hainaut), nous avait dit : — Je ne comprends pas que dans l'état où il se trouve, il puisse encore tenir debout. Par suite des privations et du mal qui le torturait, Mouffe était devenu d'une maigreur effrayante, mais il voulait tenir, il voulait revoir sa femme et sa fille dont il nous parlait si souvent, il voulait vivre pour se venger, car lui non plus n'était pas un homme à qui l'on donne impunément du fouet, mais là, à Breendonck, il était aussi impuissant que s'il avait été lié à un palmier au milieu du Sahara. Revoir sa Wallonie, sa chère commune de Roux, il vivait avec cette idée qui brûlait son cerveau comme un diamant chauffé à blanc. Quelques jours encore et il espérait que son mal s'améliorerait. Avoir la chance de ne pas être trop remarqué au travail et en réduisant ses efforts à leur strict minimum, arriver à sortir de cette passe tragique de son existence. Telles étaient les pensées de Désiré. Il n'y a rien de plus éloigné du monde civilisé que le silence de Breendonck et c'est l'apparence d'une de ces périodes de calme que Daumeries d'abord, Weiss ensuite, vinrent troubler.Daumeries n'ignorait rien des souffrances de notre infortuné camarade. Il le voyait chaque jour dans la chambre. Il savait que Désiré arrivait difficilement à pouvoir lever sa pelle, il savait davantage qu'il lui eût été impossible de prendre encore la cadence de travail des autres prisonniers. Weiss cherchait, voulait une victime, et l'innommable lâche de Jumet allait la lui offrir. Les paroles de cette hideuse crapule me revinrent : « Nous sommes ici quarante-huit, mais même s'il faut en faire crever quarante-sept pour sauver ma peau, je le ferai. » Comme Poquette, Mouffe eut le sac de pavés au dos, et durant des heures, sans une seconde de répit, avec des halètements, soufflant comme une pauvre bête épuisée, trébuchant à chaque pas, les yeux hagards, le masque livide, le cerveau obnubilé, nous vîmes le grand Désiré dans son combat avec la mort. Quel triste spectacle que celui de cet homme voué à présent à une fin certaine, sans aucune aide, sans le moindre secours d'aucune sorte, mais peinant encore pour répondre aux demandes d'un corps qui voulait vivre. Je demande pardon à sa femme, à sa fille, à tous ceux de sa famille de rappeler la détresse mortelle de leur cher disparu. Ce n'est pas un état morbide qui m'y pousse, mais bien la volonté de voir punir ses tortionnaires. Sous les regards implacables des brutes, Mouffe ployait à demi, ses doigts gourds se crispaient sur le manche de sa pelle, et lorsqu'il voulait lancer sa pelletée, on voyait son long corps tordu, plié en arc, la tête s'inclinant lamentablement sous la pression impitoyable du sac de pavés. On dut le porter pour rentrer dans la chambre, il avait tenu jusqu'au coup de sifflet. Vite et dès la rentrée, on le fit asseoir sur un escabeau. M'approchant de lui, je demandai : — Qué nouvelle, Zirès, vos sintez mia ?» (6) II leva la tête, son regard était obscurci, enveloppé comme d'un nuage, et d'une voix affaiblie je l'entendis prononcer ces paroles : — Pinsez qu'nos les virons ?... (7) Tels furent ses derniers mots, mais que pouvaient-ils signifier ? Désiré fut couché sur sa paillasse et deux heures après il mourait ! Pleurez, pauvre femme, pauvre petite, et dites-vous que sans Daumeries, votre époux bien-aimé, votre papa adoré aurait probablement revu le clocher de sa bonne commune. Dans ses conversations des derniers jours, il ne cessait de répéter qu'il voudrait, quoi qu'il arrivât, que sa fille pût continuer ses études musicales. Je répète ses paroles et l'espoir qu'elles contiennent, afin que plus tard on crée une institution qui étende sa protection aux veuves et orphelins de ceux qui firent le sacrifice de leur vie pour la force et la foi de leurs sentiments patriotiques. Tel était son prénom.
Son nom ? Il n'est peut-être pas un prisonnier de Breendonck qui pourrait
vous le dire. Alexis était Russe et avait été fait prisonnier au cours
d'opérations militaires. Interné dans un camp de prisonniers, il avait
été mis au travail forcé dans un charbonnage de Winterslag, en Campine.
Ayant tenté de s'évader, il fut, ainsi qu'un de ses compatriotes, livré
à Son compagnon et lui étaient dans la chambre 7, mêlés à d'autres prisonniers parmi lesquels le brave Gaston Hoyaux, député socialiste, et six policiers de Jumet : Emile Hanard, Emile Renard, Jean Goisse, Fernand Huet, Ursmar Cambier et Louis Dehoux. Les deux Russes portaient, comme nous, la tenue du soldat belge, mais au milieu de la veste et au dos, bien apparent, un cercle blanc et sur celui-ci, un rouge plus petit. Pour dire vrai, ils paraissaient avancer avec une cible au milieu du dos. Afin de pouvoir toujours être repérés au travail, ils étaient les seuls autorisés à garder la veste. Alexis n'avait pas trente ans, ses yeux étaient noirs et ne manquaient pas d'expression. Il n'avait pas « un doigt de poils sur te tête et un doigt de poils au menton, ni une figure d'ignoble brute », comme Léon Degrelle définit les soldats russes au Palais des Sports, à Bruxelles, le 2 février 1944. Non, sa figure était celle d'un homme comme vous et moi, ni plus ni moins intelligente. Cependant, les longs mois de détention avaient produit chez cet homme une sorte d'affaissement, d'effondrement qui paraissait lui ôter toute énergie, toute vigueur. Il semblait à le voir qu'aucun changement, qu'aucune distraction ou émotion ne puisse faire disparaître son état de prostration. Les secousses morales et physiques subies l'avaient brisé. A l'époque des faits, au début de mars 1943, Alexis pouvait encore être sauvé, mais il lui aurait fallu le repos complet, absolu, du corps et de l'esprit, afin de ramener le calme dans les organes surmenés et trop irrités. Comme nous encore, il était commandé et surveillé par les S.S. et les « zug-führer ». Il fut un de ceux qui. à Breendonck, reçurent le plus de coups. Sans cesse on 1e battait, il était visé, les S.S. inscrivaient sur son corps au moyen d'une chicote les échecs que l'armée russe infligeait aux troupes du Reich sur les fronts de Russie. Ce que ce malheureux a pu souffrir est épouvantable ! N'ayant pas vécu dans la chambre d'Alexis, je ne puis parler que de faits qui se sont passés durant les heures de travail, et je passe sur les multiples scènes de sauvagerie dont il fut victime, pour ne plus vous parler que de la dernière, qui l'est passée un samedi. Il pouvait être 9 h. 30 du matin lorsque Weiss s'approcha de notre groupe. Nous étions cent cinquante environ occupés à charger du sable. Il fallait que la butte se trouvant devant nous soit chargée et faite dans les heures avant la rentrée. Les cris des « zug-führer » se multipliaient. Devant les menaças proférées, chacun essayait d'échapper à une surveillance trop personnelle. Pour cela, i1 n'y avait qu'un moyen : il fallait charger sa pelle, la relever en envoyant le sable qu'elle contenait dans la benne, se baisser et recommencer avec la vitesse et le mécanisme régulier d'une machine. A chaque voyage, les hommes de la benne qui était pleine la dernière recevaient des coups. A ce train, nous pouvions tenir une heure maximum, mais nous espérions que les S. S. n'allaient pas rester, et qu'à l'occasion d'un de leurs déplacements dans le camp, nous pourrions souffler un peu. Malheureusement, cet effort que nous pouvions encore fournir n'était plus possible pour Alexis, et si l'on sait que les S.S. guettaient tout mouvement de faiblesse chez un prisonnier, si l'on se rappelle qu'au moindre relâchement ils tuaient, on comprendra que le pauvre Alexis ne pouvait passer inaperçu. Weiss et De Bodt le poussèrent à coups de pied et l'étendirent, en lui bourrant les côtes, sur une planche. De Bodt s'agenouilla sur ses chevilles et lui tordit les poignets à les faire craquer. Son cou était contre le bois. Weiss prit la chicote, ronde lanière noire s'effilant depuis la grosseur du pouce à la poignée jusqu'à une pointe dure ayant la grosseur d'un crayon. Aussitôt il le fouetta de toutes ses forces, comme un fou, tandis qu'on voyait Alexis serrer les dents pour supporter cette horrible chose qui s'abattait sur son corps comme un fer rougi : dix coups... quinze coups... Alexis se tordait, se convulsait, mais il était tenu si étroitement que tous ses efforts étaient inutiles. La chicote tombait de plus en plus sur des traces fraîches, car j'ai omis de vous dire que sa veste lui avait été enlevée et que sa chemise était en lambeaux. Les morsures se firent plus noires et plus trempées ; un moment vint où toute sa chair trembla de douleur accumulée et de terreur devant le coup futur. Enfin, il fut complètement brisé et ils parurent satisfaits. Soudain, Weiss leva le bras et le sabra, de toute la longueur de son fouet, dans l'aine. Le coup le cassa en deux, hurlant, ou, plutôt, essayant en vain de hurler, haletant d'horreur par sa bouche ouverte. Un autre coup de plein fouet. Une clameur. Il fut relevé et jeté sur le coffre d'une benne où il resta sans un seul mouvement, la figure contre le fer. A l'heure de la rentrée, on l'aida à parvenir jusqu'au bac à eau où chacun devait nettoyer ses chaussures. A cet endroit se tenait un officier allemand surveillant l'opération de nettoyage avec les cris habituels de : « Schnell ! Schnell ! ». Alexis restait le dernier. Il ne parvenait plus à lever sa jambe pour poser son pied sur le rebord du bac. C'est ce moment que Daumeries crut devoir choisir pour s'en approcher et lui porter un coup de bâton au sommet de la tête ! A dix-sept heures, le même jour, Alexis mourait à Breendonck, à des milliers de kilomètres de sa patrie, loin des êtres qui l'aimaient, frappé à mort par Weiss et De Bodt, et recevant de Daumeries, avant d'être transporté mourant sur sa paillasse, un coup de bâton sur la tête. Etrange jeu du destin ! Un autre Daumeries que celui de Jumet se trouvait au camp. Empressons-nous d'ajouter qu'ils n'avaient aucun lien de parenté ensemble. II n'y a pas trois semaines que nous sommes à Breendonck, et, à ce moment déjà, le Daumeries jumétois a épuisé complètement la confiance qu'on lui a portée.
— Patience, Daumeries, la guerre ne durera pas toujours ! Que fait le boucher ? Il s'empresse de rapporter ces paroles à Weiss, qui arrache alors les vêtements du Binchois et se met à le fouetter jusqu'au sang. La victime de ces coups fut libérée un ou deux jours après les faits que nous rappelons, et ce fut bien sa chance, car elle n'eût pas manqué, par la suite, de voir ajouter son nom à ceux de tant d'autres qui n'avaient même pas eu la satisfaction d'adresser une parole de mépris à leurs bourreaux. Parions que Daumeries de Jumet n'a rien oublié et qu'il appréhende le jour proche où Daumeries de Binche arrivera, mais pas en costume de « gille », plutôt en tenue de « croque-mort », pour lui rappeler la règle de tous les jeux : « Qui perd, paie ! » Quelques années avant la guerre, Daumeries, mais pas celui de Binche, fut victime d'un accident de moto. Pour le transporter à l'hôpital, un voisin de l'endroit où l'accident se produisit, se présenta bénévolement. C'était Fernand Serbruyns, de Jumet également, que nous retrouvons à Breendonck. Serbruyns ne fut jamais remercié pour l'aide qu'il apporta au blessé dont il avait assuré le transport. S'il nous plaît de rappeler ce trait d'ingratitude, c'est parce qu'à Breendonck, Daumeries a frappé Serbruyns, et à la fin d'une journée de mars 1943, un autre jour, il s'est lancé à nouveau sur lui, bâton levé, en criant: « Fainéant, je vais te tuer ! » Prompt à la riposte, « mon » petit Fernand lui mit le fer de sa pelle devant la figure en disant : — Un pas de plus et je t'ouvre la gu... vaurien ! Le « courageux » Daumeries fit plusieurs pas en arrière. Il n'y avait aucun S.S. en vue et le boucher n'osa donner aucune suite à ses menaces. Il en avait déjà tant sur la conscience qu'il commençait à trembler, et justement on parlait de libérer ceux contre lesquels on n'avait pu établir quelque chose de précis. Serbruyns fut libéré trois semaines avant Daumeries. Lui non plus n'a pas oublié ! |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
8 |
|||||||||||||||||
|
En vous parlant de Burgeon, Poquette, Mouffe, Alexis, que je connaissais, j'ai voulu établir la preuve formelle qu'il n'y a pas de morts naturelles à Breendonck, bien que l'officier de l'état-civil de cette localité soit en possession d'attestations de décès signées d'un médecin militaire allemand. En agissant ainsi, les autorités du camp et celles des autres bourreaux responsables pendant l'occupation ont voulu masquer leurs crimes, mais nous ne le permettons pas ! Des centaines de camarades, sous la seule juridiction du puissant sur le faible et le malheureux, ont été assassinés dans ce bagne où le sang répandu avait causé dans l'esprit des monstres qui le dirigeaient une sorte de déséquilibre morbide, d'enivrement spécial et comme une déformation de la sensibilité. Les bourreaux de Breendonck, à quelque grade qu'ils puissent appartenir, étaient animés des plus viles passions. L'une emportant son masque et l'autre son couteau (8) Nous avons été les témoins de leurs forfaits, nous avons entendu leurs victimes hurler sous les coups, nous les avons vues livides de terreur, lamentables et tragiques. Nous savons qu'elles furent abattues dans un carnage confus et sans motif. Pour être soumises à la question, comme aux pires époques de l'Histoire, elles durent entrer à la salle des tortures, cette antichambre de la mort. Nous nous rappellerons toujours l'expression de détresse des innocents que l'on allait faire mourir et les minutes terribles que nous vivions dans ces moments où, avec Mme de Sévigné écrivant durant le procès du surintendant Fouquet, on pouvait dire : « On raisonne, on tire des conséquences, on compte sur les doigts, on s'attendrit, on craint, on souhaite, on hait, on admire, on est triste, on est accablé ! » Quant à nous, notre but a été jusqu'à présent et restera jusqu'à la fin de ce livre de livrer à la postérité le souvenir impérissable des atrocités allemandes. Il y a plusieurs lustres, les Boches s'étaient mordu les doigts lorsque les historiens de l'autre guerre évoquèrent les horribles massacres de Surice, Romedenne, Charleroi, Tamines, Dinant, Louvain, et j'en oublie. C'était ceux de 1914, mais la génération que nous connûmes en 1940 ne le cédait en rien à la barbarie de ses prédécesseurs, et c'est ce qui nous fit dire au début de cet ouvrage que l'Allemand était toujours le même. Boche il avait été, Boche il restait ! Boche est un terme de mépris que les peuples civilisés ont voulu accoler à l'étiquette nationale du peuple d'outre-Rhin, et malgré la fureur qu'il en ressent, plus que jamais ce qualificatif lui restera. Que l'on ne s'étonne pas si après avoir passé de longs mois à Breendonck, l'art de la vengeance me soit bien connu. Certes, je sais qu'il y a, même en Allemagne, des hommes attachés à la paix, des mamans qui n'ont cessé de maudire leur empereur et qui, aujourd'hui, maudissent leur führer, mais est-ce une raison suffisante pour taire tant de crimes ? Il est temps que le peuple germanique comprenne qu'il est possible de vivre heureux dans une atmosphère dégagée du bruit des bottes, du crépitement des mitrailleuses, du fracas des bombes et des obus. Si l'on admet qu'un accouchement ne peut se faire avec des fossoyeurs, il faut admettre aussi qu'une clique militaire envieuse et passionnée, nourrie par ses haines, par ses appétits rapaces, ne peut, malgré ses différentes fortunes, qu'aboutir à la ruine d'un pays, à la destruction de toutes ses institutions, à la mort de ses meilleurs enfants. Voués tôt ou tard, par leurs crimes, à une fin impitoyable, ils ont drainé toutes les énergies pour retarder le règlement de comptes, et par les méthodes de terreur de leurs polices, ils sont parvenus, en brisant les familles, en emprisonnant, en tuant, à faire marcher leurs divisions. Durant les années qui avaient précédé la guerre, les usines d'Allemagne s'étaient livrées aux fabrications d'armements de tous genres, d'engins de toutes espèces. Durant la même période, les ouvriers et ouvrières d'Allemagne avaient dû, pour permettre les dépenses occasionnées par cette fièvre des armes, se passer de tous produits d'importation dans leurs besoins vestimentaires et alimentaires. Qu'importait, puisqu'on faisait des fusils, des mitrailleuses, des avions, des bombes, des canons ! Hitler voulait une guerre-éclair, une guerre totale. Les autres pays d'Europe seraient vassalisés et leurs ressortissants deviendraient les domestiques des hommes du « grrrand » Reich. Et l'on vit en 1940 et 1941, ce peuple d'Allemagne, grisé par des succès faciles, organiser des réjouissances lorsque le sang des hommes, des femmes et des enfants des pays envahis se mit à couler. Qu'aviez-vous de plus, pauvres fous ? Vous seriez moins embarrassés si je vous demandais : Qu'aviez-vous de moins ? car dès ce moment vous étiez entrés dans la guerre ! La seule liberté qui vous restait était celle de chanter les louanges du führer. Votre seul droit, celui de mourir pour le défendre ! Si, plus tard, l'un ou l'autre illuminé s'avisait d'encore vouloir vous nourrir avec des idées de revanche, il faudrait vous souvenir du vieux proverbe français : « Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. » En attendant, le qualificatif de « Boche » vous restera au moins jusqu'à ce que la génération qui va naître soit parvenue à l'âge de la raison. J'ajoute, en plus, que ce qualificatif ne s'atténuera dans les souvenirs qu'à la condition que les Allemands de demain soient convaincus que le bonheur d'une nation peut s'établir seulement dans la liberté, l'amour du prochain, le travail et la paix ! ----------------------- Je revois encore quelques autres figures de la chambre III, entre autres un Bruxellois se prénommant François et que nous appelions « Siske ». Dès le jour où on le mit avec nous, en mars 1943, il devint sympathique à tous. Peu parlant mais fraternel, il acceptait son sort avec un courage magnifique. A différentes reprises, il intervint dans les conversations avec un esprit de justice qui ne fit qu'augmenter l'estime que nous avions pour lui. Revenant un jour d'un interrogatoire, il nous fit la déclaration suivante : — Camarades, je viens d'être interrogé. J'ai dû reconnaître que j'avais tué un officier allemand sur le boulevard Adolphe Max, à Bruxelles. Absolument rien ne changea dans l'attitude de « Siske », et jusqu'au jour où il fut fusillé, peu de temps après ma libération, il garda le même calme. Je lui ai pourtant connu un moment d'émotion. C'était un dimanche, le 14 mars 1943, la veille du jour où Van Schelle devait être fusillé. Une atmosphère de deuil flottait déjà dans la chambre... les hommes chuchotaient dans les coins... J'étais assis à une table avec Van Schelle, Zavarro et Wittezaele, quand François s'approcha de nous. Il m'interpella : Dis, Victor, crois-tu que je pourrai encore revoir ma mère avant d'être fusillé ? — Allons, «
Siske »,
tu n'en es pas encore là... Martial Van Schelle, qui écoutait et qui devait mourir le lendemain matin, lui répondit : — Ils t'enverront peut-être
en Allemagne, et puis tu ne dois pas penser ainsi, la guerre peut finir brusquement. .. ----------------- Le 15 mars 1943 au matin, lorsqu'on appela Martial et après qu'il eut quitté la chambre pour marcher au supplice, Emile Zavarro, de Mons, éclata nerveusement : — Je serai de la deuxième fournée... Ils vont revenir...Je vais être fusillé... Son raisonnement pouvait être vrai, car, la veille, le lieutenant était venu relever son numéro de matricule. Pour le calmer et beaucoup plus parce que je pensais qu'il avait peur — car à ce moment je partageais la pensée qu'il venait d'exprimer — je lui dis : — Mais non, Emile, il n'y en aura pas d'autres que ceux que tu vois dans le couloir. Sois courageux et ne pleure plus. Il essuya ses larmes, nous regarda tous et eut cette fière réponse : — Croyez, camarades, que ce n'est pas la peur qui me fait pleurer. Si je dois mourir tantôt, je ne faiblirai pas plus que ceux qui s'en vont maintenant. Si je pleure, c'est que je pense à ma femme, à mon petit garçon... Mais c'est fini, vous ne me verrez plus pleurer ! Je ne sais ce qu'il est devenu. Il était toujours en vie lorsque je fus libéré. Un autre visage me revient... Lambert (je crois), un Liégeois dont une main était amputée de plusieurs doigts. Lui aussi était condamné à mort, et le jour où je fus libéré, il me confia une adresse — que je n'ai pu emporter — en me disant : — Ecris à ma femme, à mes gosses ; tu leur diras que je suis ici et que tout va bien (sic). Pour échapper à la fouille qui précède toute libération, j'avais glissé le bout de papier qu'il m'avait remis dans un pli de mon pantalon. Je ne pouvais prévoir que le lieutenant allait me faire mettre nu pour aller prendre possession de mes vêtements civils, ceux que j'avais lorsque je fus arrêté. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Jean-Pierre Dhée
est né le 19 octobre
1896 ; il était originaire de Bracquegnies, où sa famille réside
toujours. Il fut arrêté au mois de décembre 1942 et est rentré de
Breendonck pour se coucher et mourir !
En juillet 1943, du grand et solide Jean-Pierre que nous connaissions depuis son arrestation, il ne restait plus qu'un cadavre, qu'une pauvre figure émaciée entrée dans la nuit livide pour l'éternité, qu'un corps squelettique brisé par les souffrances, déformé par les coups. Je revois comme alors notre camarade tombant d'inanition dans la chambre et, souvent, nous n'avions même pas d'eau pour le ranimer. Comme nous tous, Jean-Pierre était épuisé, toutes ses forces vidées, ses membres n'obéissaient plus à une volonté qu'il avait forte cependant, et, vers le mois de mai 1943, dans les rangs ou dans la chambre, Jean-Pierre s'écroulait comme un grand arbre aux racines brisées... C'était un brave
camarade, c'était un homme d'indépendance et de liberté ; i1 avait
des opinions consciencieuses parce qu'il était animé de vœux et
d'espérances pour la prospérité de
Non, les S.S. pas plus que les « moutons » de Breendonck n'ont pu faire reculer Jean-Pierre, n'ont pu le faire taire tant qu'il eut un souffle de vie sur les lèvres, Toi aussi, Jean-Pierre, tu fus battu... Je me souviens du mois d'avril 43, de ces nuits lugubres durant lesquelles, petit à petit, la vie se détachait de toi, et j'entends, comme alors, ce que tu nous disais : « Mes ys s'in vont... dji va mori !» (9) Les tortures du bagne
l'avaient rendu aveugle ! Regardez-le sur son lit de mort, voyez
l'affreuse tristesse qui se devine encore dans ses yeux, voyez ce grand corps d'où la vie fut arrachée,
dans la douleur. Dors en paix, Jean-Pierre, tu seras vengé ! A
Londres, le 29 décembre 1942, le Gouvernement belge faisait la déclaration
suivante : « II convient d'armer
le pouvoir judiciaire des sanctions nécessaires à l'égard des
individus qui auraient perdu le sens du devoir national au point de prêter
un concours actif aux desseins et aux manœuvres de nos ennemis... Pour
les traîtres qui n'ont pas craint de mettre leur main dans celle de
l'oppresseur de leur Patrie, ni de projeter une ombre aussi douloureuse
sur la fière attitude de leurs concitoyens, l'heure de l'expiation
sonnera, lorsque sonnera pour les autres l'heure de la délivrance.
|
|||||||||||||||||
|
Chapitre
10 |
|||||||||||||||||
|
Dire que l'on avait des poux, on n'y tenait guère, car on savait que pareille déclaration eût entraîné des représailles plus dures encore à supporter que les tiraillements de la vermine qui nous rongeait. Et puis, tous n'en avaient-ils pas, des poux ? Pour faire disparaître ces bestioles, il n'y avait qu'un moyen : brûler toutes les paillasses, tout le linge, tous les vêtements, nous faire passer dans un bain de désinfection et nous rendre ensuite à la vie civile. Hélas ! Il ne fallait pas y songer. En attendant, chaque prisonnier faisait la chasse... chasseur de poux ! Cinquante, soixante le soir avant de se coucher, on les comptait, on se montrait les plus gros, les noirs au dos bombé qui éclataient dans un bruit sec sous la pression des ongles en y laissant une tache de sang. Durant la nuit, il en revenait d'autres, des douzaines d'autres, que l'on sentait fourmiller, courir sur la peau. On les prenait dans le noir, dans un demi-sommeil, pour les lâcher sur le pavement de la chambre. Le matin, en s'éveillant, on s'octroyait encore cinq minutes de recherches, et quel tableau de chasse ! cent, cent cinquante poux expiaient à nouveau. Vous vous demandez comment était notre peau ?... Notre poitrine, nos cuisses paraissaient avoir été, millimètre par millimètre, passées à la machine à coudre. Un dimanche matin, le lieutenant allemand du camp vint inspecter la propreté de notre chambre. Déjà il allait s'en aller, personne n'avait reçu de coups, lorsque notre « zug-führer », le lâche Daumeries, boutonnant sa veste, s'approcha doux et peureux vers l'officier. N'est-ce pas, que vous vous seriez imaginé les dompteurs plus fiers ? — Herr leutnant, dit-il, tous les hommes de la chambre ont des poux... Si vous aviez vu la gu... du lieutenant ! Ses yeux faisaient roue libre... ses traits étaient crispés de rage et il hurlait un mot qui se prononce « chaise » (scheipze) (m...) et qui veut dire cochon, saligaud ou quelque chose d'approchant. Daumeries lui-même faisait une drôle de tête, et il y ayait de quoi ! Comment, il avait bien respectueusement fait savoir au lieutenant que les hommes avaient des poux ; il aurait voulu ajouter que lui, le « zug-führer », avait gagné la vermine au contact des détenus de sa chambrée, et qu'il attendait des ordres, et un fly-tox peut-être, pour partir en guerre contre les infâmes parasites. Mais voici que le lieutenant entrait en transes, et, pour comble de malheur, avec une chicote qui s'agitait dangereusement... Ce n'était plus de jeu, et, vrai, c'était à vous dégoûter d'être mouchard. Ce jour-là tout de même, je crois que notre salopard de Jumet comprit qu'il eût mieux valu collaborer avec les insectes plutôt qu'avec les Boches. De quelle façon tout cela allait-il finir ? Nous restions figés au garde à vous sous les invectives de l'officier qui venait d'appliquer un coup de chicote sur l'échine d'un Daumeries qui criait comme un putois pour un coup de trique. S'il avait pu être le seul à tâter de la saucisse, nous nous en serions réjouis... Pensez un peu, pour une fois que ça lui arrivait ! Mais les S.S. couraient en direction de notre chambre, et bientôt ce fut le branle-bas de combat. On fit sortir chaque prisonnier avec sa paillasse et sa couverture. Dans la boutique, c'était un vrai jeu de massacre dont nous étions les têtes, les coups tombaient dans un bruit de battage de tapis, et tant pour leur échapper que pour sortir de la fournaise, nous étions les uns sur les autres pour gagner le couloir. Au pas gymnastique, on nous fit porter paillasses et couvertures dans une sorte de grenier à paille. Rentrée à la même allure pour remettre, sous les coups, chaussettes, chemises, caleçons, pull-over, écharpes. Deux heures après, nous nous retrouvions enfermés dans une chambre qui ne contenait plus que quarante-huit caisses. Finie la paillasse sur laquelle, le soir, on pouvait se reposer ; finie la couverture qu'on doublait pour avoir plus chaud ; finis le chandail, l'écharpe. Nous étions consternés ! Le lieutenant revint nous annoncer que rien ne nous serait remis avant trois semaines. Eh ! quoi, il allait falloir s'étendre sur le bois pour dormir, on n'aurait pas de couverture, et la chambre qui était humide, glaciale. On allait donc crever comme des bêtes ? Je vous laisse à penser l'état dans lequel nous nous trouvions et notre rage impuissante vis-à-vis de Daumeries, seul responsable de nos maux. Je ne saurais vous dire combien nous avons souffert du froid, de la fatigue, de l'insomnie pendant ces ving-et-un jours. Le lieutenant fit encore retirer sur notre maigre ration en disant que c'était bien assez pour la chambre aux poux. La plupart parmi nous avaient si bien envisagé la mort que la vie ne leur paraissait plus que triste et ennuyeuse. Ils s'étaient préparés à mourir et en avaient toute la disposition. Comment fallait-il s'organiser pour passer la nuit ? Se coller les uns aux autres sur le pavement, mais il n'y avait pas assez de place pour allonger quarante-huit corps. Le pavement fut laissé aux vieux et aux malades qui s'entassaient, pêle-mêle, sur un espace de quatre mètres carrés environ. Les autres se tassaient à plusieurs dans une boîte. Nous étions sur les lattes, dans une caisse, étendus à trois sur le même côté. Quand celui du coin se sentait fatigué de sa position, il disait : « On bouge » et les trois se tournaient. Notre bol à soupe servait d'oreiller. Les poux continuèrent à vivre en rangs serrés. Nous en avions dans les plis de notre pantalon, de notre veste. La faim nous torturait, nos os étaient brisés de fatigue, la nuit on avait froid à en pleurer, le jour on recevait des coups, et plus de deux cents fois par heure on avait les oreilles cassées par les cris du boucher de Jumet : — Plus vite, plus vite, bande de fainéants ! Pour clore ce chapitre, nous dirons qu'on est parvenu, à Breendonck, à nous enfoncer une haine éternelle. |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
11 |
|||||||||||||||||
|
Quels qu'ils soient, les prisonniers aspiraient à pouvoir faire connaître l'endroit de leur séjour, car rares étaient les familles qui pouvaient avoir une certitude sur le lieu d'emprisonnement des êtres qu'elles recherchaient, et les recherches se révélaient quasi impossibles quand il s'agissait de Breendonck. Bien des mères passaient des journées sur la route allant à Willebroek pour tâcher, mais en vain, d'apercevoir un instant les objets de leur tendresse, adresser à ces enfants chéris un regard, un signe de souvenir et d'amour. Bien des femmes sont venues prier, implorer pour savoir seulement si celui qu'elles cherchaient était bien à Breendonck Ce n'était pas une faveur, une grâce qu'elles sollicitaient , elles ne demandaient qu'un renseignement ! L'enfant, l'époux, le frère sur le sort duquel elles s'inquiétaient avait été arraché à tout ce qui avait été sa vie, à tout ce qu'il avait de familier, de proche et de cher. Depuis, aucune nouvelle, aucune idée du lieu où il avait pu être conduit... Mais larmes et prières ne peuvent émouvoir des barbares. Ils insultaient au malheur de ces femmes, les accablant de sarcasmes. Rendant à ces lâches mépris pour mépris, et, sans leur adresser davantage la parole, elles se retiraient, la pâleur au front, le désespoir dans le cœur. Depuis plusieurs jours, nous avions pu remarquer dans le camp les allées et venues de civils. Ceux-ci, deux Flamands et un Wallon, foraient des trous de mine dans les coupoles du fort. A force de ruses, je parvins un jour à me faufiler parmi l'équipe des prisonniers qui se rapprochait le plus des coupoles, et profitant d'un moment où le civil wallon passait devant moi, je lui demandai l'heure. Il s'arrêta, jeta un coup d'œil circulaire, et comme aucun S.S. ne nous observait — ce dont je m'étais assuré avant de formuler ma demande — il sortit sa montre et j'obtins réponse immédiatement. Comme il repartait, je déclarai en me baissant de façon à ne me faire entendre que de lui seul : « Je suis commissaire de police et voudrais faire parvenir des nouvelles à ma famille. » II me regarda sans répondre et reprit sa marche. Qu'allait-il se passer ? Peut-être allais-je être dénoncé aux S.S... A seize heures, je le vis reprendre ses outils et se diriger vers la sortie du fort. Le lendemain, vers 6 heures du matin, comme on nous conduisait à la cour, je profitai d'un moment d'arrêt dans les couloirs pour mettre Henri Glineur, député communiste, au courant de mes agissements de la veille. Glineur était dans la chambre 7 et nous n'avions que de rares occasions de pouvoir nous parler. Si je m'étais adressé à Glineur plutôt qu'à un autre, c'est que je le connaissais depuis 1926, époque durant laquelle nous militions ensemble au sein de l'organisation syndicale des magasiniers-verriers que je quittai en 1929 pour entrer à la police. Bien que depuis lors je n'avais plus eu aucun rapport avec lui pour l'excellente raison que nos voies étaient devenues différentes, j'avais conservé un bon souvenir de nos anciennes relations et je savais pouvoir, sans crainte, lui demander d'envisager les possibilités qui s'offraient de communiquer avec l'extérieur. Sa première préoccupation fut de savoir si j'étais sûr que le civil accepterait une lettre. Glineur me fit envisager l'échec possible. C'était la certitude d'un châtiment exemplaire. Je répondis que je me chargerais, au préalable, d'obtenir un acquiescement, et que ce n'est qu'une fois celui-ci obtenu que je remettrais la lettre. Nous pouvions encore être trahis, malgré l'acceptation du civil, et ce risque était à courir. Bref, nous décidâmes qu'il fallait jouer sa chance. Il fut convenu que Glineur me remettrait, le lendemain matin, une feuille et une enveloppe qu'il avait pu, lors de son arrestation, soustraire à toutes les recherches. En outre, je recevrais une autre enveloppe cachetée et timbrée dont la préparation était antérieure à mon arrestation, mais que, faute de moyens, il n'avait pu faire parvenir. |
|||||||||||||||||
|
Ainsi, ma proposition tombait à pic et devait nous satisfaire tous deux. Le lendemain soir, ma lettre était écrite, j'avais celle de Glineur, j'étais paré. Hélas ! les jours qui suivirent, on me fit travailler aux bennes, il ne m'était plus possible d'approcher les civils. Les correspondances étaient placées sur ma jambe gauche et j'avais enroulé, autour, des bandes découpées à ma chemise. Cette situation ne pouvant s'éterniser, nous décidâmes de mettre un tiers au courant de nos projets. Ce fut Jules Clara, dit « Kiki », de Leval, un sincère, un pur et un dur, mais bien qu'il fût occupé non loin des civils et malgré plusieurs tentatives, il ne put parvenir à remettre les missives que j'avais dû lui passer. Les ayant reprises, je décidai de jouer le grand jeu. Kiki prendrait ma place au sable et j'occuperais la sienne aux cailloux. Si l'on s'apercevait de la substitution, je devais dire qu'un sabot cassé (c'était exact), me permettait difficilement de rouler les bennes et nous en serions quittes pour quelques coups de chicote. Transportant de grosses pierres sur une brouette à coffre de fer, je m'approchai du civil et fus assez heureux pour qu'il n'y eût aucun témoin à notre conversation. —
Camarade, lui dis-je, veux-tu te charger
de déposer deux lettres à
la boîte postale lorsque tu quitteras le Il me jeta un coup d'œil méfiant et répondit : — Je n'ai pas envie d'aller au poteau pour vous. Dès ce moment, je compris que moi aussi j'avais échoué. Je me retrouvais las, découragé. Il me semblait à présent que les S.S. allaient arriver, trouver les lettres et me battre à mort. Pendant les heures qui suivirent, je n'ai pas cessé de surveiller le civil. Si je l'avais vu se diriger vers un S.S., l'aurais tout tenté pour détruire les lettres, mais rien de pareil ne se produisit. Glineur reprit sa lettre Je fis brûler la mienne dans le poêle de la chambre. Ma femme, mes enfants, mes parents attendraient encore de longs mois avant d'apprendre que j'étais à Breendonck. Léon Beeldens, né à Mons le 16 novembre 1881, est mort à Breendonck le 3 mai 1943. Ce camarade n'était pas dans ma chambre. Je me le rappelle cependant, car chaque dimanche matin, il venait nous raser et nous tondre. Léon Beeldens était coiffeur. Ses compagnons de la chambre 5, comme tous ceux qui l'ont connu, lui conserveront leurs souvenirs émus. Léon était aussi un de ces hommes que la mort seule pouvait abattre. Il n'est plus... Breendonck et ses multiples tortures en ont fait leur proie ! Lui aussi s'est sacrifié aux horreurs de l'enfer de Breendonck pour l'honneur et la liberté de son pays. Saluons Léon Beeldens, c'est un Belge ! |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
12 |
|||||||||||||||||
|
Nous avions avec nous, depuis Charleroi, un ingénieur gui s'appelait Mentens. C'était un Carolorégien, qui, si mes souvenirs sont bons, devait habiter, avant d'être arrêté, dans la rue de Montigny. Mentens avait dépassé la cinquantaine. A Breendonck, c'était un camarade calme, plutôt effacé, mais toujours obligeant envers ses compagnons de captivité. Mentens a souffert énormément à Breendonck. Frappé chaque jour, son corps était couvert de plaies et d'ulcères. Nous-mêmes étions effrayés de sa maigreur, et cependant, nos corps étaient déjà squelettiques... Pendant plus de quinze jours, Mentens eut à souffrir d'une forte diarrhée et les S.S. Weiss et De Bodt l'empêchaient de satisfaire ses besoins. Les coups de chicote le renvoyaient au travail, et Mentens rentrait de l' « arbeit » avec son pantalon souillé, son corps meurtri et sa pauvre figure de spectre. Dans la chambre, il ne pouvait même pas espérer trouver un peu d'eau pour se nettoyer. Je l'ai vu tomber sous les coups des S. S. et des officiers allemands du camp. Son extrême faiblesse le faisait rechercher, et justement à cause de celle-ci, Mentens nous paraissait marqué pour une fin lamentable et rapide. Par quel miracle d'énergie a-t-il pu résister ? On ne le comprendra jamais. |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
13 |
|||||||||||||||||
|
La faim à Breendonck était le faire-le-faut, c'est-à-dire une chose inévitable qu'il fallait subir. Imaginez-vous des hommes travaillant chaque jour au grand air, tenus de fournir des efforts physiques considérables et ne recevant, pour toute nourriture, qu'un bol de soupe à midi, soit un litre d'eau dans laquelle nageaient des hachures de choux, et à six heures le soir, une boule de pain noir de 225 grammes. L'estomac se resserrait, on éprouvait des tremblements, on voyait les rations arriver avec des yeux d'affamés, on regardait celui qui les distribuait avec méfiance. On se surveillait sans cesse et le vol d'une simple croûte de pain aurait pu entraîner la mort de son auteur. Le pain, c'était de l'or, c'était la vie ! Nulle part ailleurs on n'a connu la faim comme à Breendonck, et il faut avoir vécu dans cet antre pour le comprendre. Vous avez vu des chiens attachés à leur niche au moment où on leur apportait la pâtée. Vous les avez vus, hargneux d'abord, et bientôt prêts à s'égorger si une seule gamelle leur était laissée. C'est comme cela qu'on nous trouvait aux heures de distribution ! Je sais tout ce qu'il peut y avoir de dégradant dans une telle attitude et ce que peuvent en penser certains esprits chagrins assis au coin d'un bon feu et ayant dans les oreilles les bruits de marmite d'un souper qui mijote. « Ventre affamé n'a pas d'oreilles », dit le proverbe, et à Breendonck le ventre criait famine. Pour satisfaire un estomac avide de nourriture, on mangeait des feuilles et des bourgeons d'arbustes, des racines, de l'herbe et des vers de terre aux rares endroits où il y avait du gazon. Tous les yeux inspectaient, prospectaient le sol en vue d'y découvrir une épluchure de chounavet, de betterave, ou, découverte plus exceptionnelle, de pomme de terre. Pendant les rares moments de distraction des S.S., on se lançait dans le trou au fumier qu'on fouillait pour y trouver un os. Quelle que fût sa grosseur, et dût-on le casser à l'aide d'une pierre, on en venait à bout. Si les dents n'arrivaient pas toujours à le broyer, on le faisait calciner, et, de toute façon, il y passait. Entre 6 heures du soir et le lendemain à midi, nous ne recevions rien. Que l'on juge des tourments que nous faisaient éprouver nos pauvres estomacs délabrés, privés ainsi et durant dix-huit heures de toute nourriture. Nous cherchions dans le fumier, dans les coins, les égouts, les poubelles, et nous précipitions avec avidité sur les immondices et rebuts jetés par l'homme qui soignait les cochons destinés à la cuisine des Boches. Notre voracité exaspérée ne reculait devant rien. Un trognon de chou, une tête de sauret étaient pour nous une magnifique trouvaille. On combinait parfois de se rendre aux mottes de navets ou de betteraves. C'était dangereux, et plus d'un, pour avoir été pris, fut frappé à mort. Ça se passait devant les fenêtres des pièces réservées aux bureaux des officiers et à moins de 40 mètres des sentinelles. Ces combinaisons êtaient exercées avec une si merveilleuse audace que leur réussite seule les empêchait de passer pour des traits de folie. Comme d'autres, beaucoup d'autres camarades, j'ai risqué le coup bien souvent. Les coups ne pouvaient plus nous effrayer, nous en recevions chaque jour. L'égalité la plus complète régnait pour la souffrance dans notre affreuse prison. La mort ? Nous avions eu le temps, depuis que nous étions entre leurs mains, de nous familiariser avec une image dont on nous mettait journellement le tableau sous les yeux. Je n'exagère pas en vous disant que la faim nous brûlait la poitrine. C'était horrible ! Nous sucions des boutons de culotte, des morceaux de goudron durci. La nuit, on voyait des mirages, des restaurants, des hors-d'œuvre, des plats de pommes de terre. Ah ! quel supplice ! Lorsque la soupe arrivait, les quarante-huit gamelles étaient disposées sur les tables. Pendant qu'on les remplissait, tous suivaient des yeux, farouchement, l'opération. On donnait des indications : un peu plus dans le bassin du coin... une bonne cuillerée en trop au milieu...etc., etc. Malgré l'attention qu'on apportait à la distribution, on tirait ensuite au sort les numéros des détenus, et à l'appel de son matricule, le prisonnier s'avançait. On tirait encore deux numéros et les élus emportaient chacun un bidon vide de la soupe qu'il avait contenue, pour en lécher les parois. Oui, comme un animal, le gagnant se retirait dans un coin, serrant son bidon comme l'avare serre la bourse qui contient son trésor. On agissait de même pour la boule de pain du soir. Me croirez-vous à présent si je vous dis que des hommes pleuraient de faim, la nuit, sur leur paillasse ? Beaucoup ruminaient leurs aliments. La première fois, ils avalaient, sans mâcher, leur boule de pain qu'ils partageaient en sept ou huit morceaux, et une heure ou deux après ces morceaux de pain leur remontaient, et à ce moment seulement on pouvait dire qu'ils mangeaient ! Tous ceux qui ont passé à Breendonck vous diront .— et j'en suis — qu'ils eussent préféré une année de détention dans une prison ordinaire plutôt que deux mois d'emprisonnement à Breendonck. Ceux qui émettaient cet avis avaient connu les deux régimes. J'avais moi-même subi un premier emprisonnement à la prison de Roulers avant de connaître Breendonck. J'entends encore la voix d'un brave camarade, Jules Clara, dit « Kiki », de Leval (Hainaut), me répondre dans son patois, alors que pendant la nuit je posais ma main sur son bras en lui demandant pourquoi il pleurait : — Fréy, èd' su tout bleu d'feigne ! (10) Peut-être le lecteur me reprochera-t-il à présent de ne pas avoir parlé davantage de « Kiki ». A cela je répondrai que mes souvenirs de captivité étant de la plus scrupuleuse exactitude et ne pouvant par conséquent ressembler à des scènes de roman, je suis forcé, lorsque le hasard ne vient pas à mon aide — et il y vient rarement — de laisser la plupart des épisodes que je raconte sans un dénouement. J'aime à croire que « Kiki » est toujours en vie et que je le reverrai bientôt. Sans les S.S., dont la race dégradée n'appartenait plus à l'humanité, sans le froid et les coups, Breendonck eût déjà, pour la faim qu'on y connaissait, mérité son nom de camp de la mort. Aucune description, quelle qu'en soit l'énergie, aucune plume, quelle que soit sa puissance, ne sauraient rendre le spectacle que présentait la vue des prisonniers. Que l'on se figure une génération de morts sortant un moment de leurs tombes, les yeux caves, le teint hâve et terreux, le dos voûté, le corps d'une maigreur effrayante, et l'on n'aura encore qu'une idée bien affaiblie, bien incomplète de l'aspect que nous présentions. Nous avons parlé d'Alexis, prisonnier russe. Vous savez qu'il avait avec lui un de ses compatriotes et c'est de celui-ci qu'il sera question dans les lignes qui vont suivre. Il avait un prénom russe finissant en « ir », comme « Emir » ou « Jomir » (11), et malgré tous mes efforts de mémoire, je n'ai pu me le rappeler. Son âge ? Dix-huit ans tout au plus. Son physique était agréable, ses traits réguliers et deux grands yeux d'enfant. Tous à Breendonck vantaient son courage et nous devons dire que les éloges qu'on lui décernait étaient mérités. Il supportait de 15 à 20 coups de chicote sans laisser échapper une seule plainte et il n'est pas un S.S. qui eût pu seulement lui faire baisser les yeux. D'une adresse surprenante, il parvenait bien plus souvent que les plus fins d'entre nous à tromper la surveillance des gardiens. On le voyait ramper sur les buttes de sable, se faufiler d'un groupe de| prisonniers à un autre, rejoindre les hommes de son équipe et y enterrer jusqu'à la fin du travail un chounavet ou une betterave qu'il était parvenu, aux heures les plus difficiles, à aller prendre dans la motte. |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Outre des porcs, les Allemands avaient aussi quelques brebis. Il arriva qu'un matin, le long de la rivière, l'une d'elles mit bas pendant que nous étions au travail. Un des soldats emporta l'agnelet, fit rentrer la mère et c'est à ce moment que le petit Russe s'élança à l'endroit que la brebis venait de quitter. On le vit se baisser, ramasser quelque chose qu'il se mit à manger. C'était l'arrière-faix ! Plus de quatre cents prisonniers ont vu ce que nous racontons, mais Weiss aussi l'avait vu... Pendant deux heures, avec un sac de pierres au dos, le jeune prisonnier dut courir, se coucher, se relever, courir encore et sans cesse suivi par le S. S., qui le frappait avec une cruauté inouïe. Au terme de son supplice, le Russe était méconnaissable ; des sillons sanglants balafraient sa figure, il se tenait accroupi contre un mur de coupole, incapable de se redresser. Ses reins étaient brisés, sa poitrine déchirée, et quelques jours après, nous apprenions qu'il était atteint de crises hémoptysiques. Ne vous hâtez pas, lecteurs, de conclure sur les faits qui précèdent, car c'était un drame de la faim ! |
|||||||||||||||||
|
Chapitre 14 |
|||||||||||||||||
|
Un docteur en médecine ayant grade de major était arrivé au camp.
Tous les prisonniers iraient à la visite. Dans notre chambre comme dans
les autres, les hommes n'étaient plus que des épaves. Plusieurs
souffraient d'hémorroïdes, d'autres avaient des ulcères aux jambes,
presque tous avaient les chevilles et les jambes gonflées par un mal
que notre brave camarade Camille Jeuniaux, médecin et détenu, appelait
« œdème de carence ». Ajoutons-y le scorbut, la dysenterie, la
tuberculose et les affections nerveuses pour compléter le programme
des maladies de bagne.
Une petite pièce bien
chauffée avait été mise à la disposition du docteur allemand, et
dans une pièce attenante, nue et froide comme une région qu'on nomme
Chaque détenu vit le docteur pendant vingt à trente secondes et se retrouva hors de sa présence un peu plus vite qu'il ne l'avait souhaité, car les S.S. y aidaient au moyen de la chicote. Beaucoup avaient espéré cette visite, et on peut même dire que tous l'attendaient. Hélas ! les espoirs s'effondraient, et, comme avant, il allait talloir rester sans soins, avec la certitude d'être abattu comme une bête nuisible le jour où on n'aurait plus la force de pouvoir lever sa pelle. Notre rentrée fut des plus tristes ; mais jugez de notre effarement lorsque le lendemain matin, au moment où toutes les compagnies de prisonniers étaient au garde à vous et alignées dans la cour, le lieutenant se mit à nous invectiver en allemand. Mentalement, à chacune de ses pauses, nous lui disions cinq lettres, celles d'un illustre général ayant nom Cambronne, mais bientôt le traducteur attitré de la boîte, le S.S. De Bodt, répéta textuellement ce qui suit : « Hier, à la visite du médecin, beaucoup de prisonniers ont déclaré qu'ils avaient des hémorroïdes. Le lieutenant fait savoir que les médecins allemands ne viennent pas à Breendonck pour soigner votre derrière... Dorénavant, ceux qui se plaindront encore de ce mal seront soignés par nous à grands coups de pied dans l'c... » (sic). Vous le voyez, la maladie était séparée de la vie, et dire : « Je suis malade », constituait un suprême outrage. Malade ou pas, il fallait travailler. Si vous tombiez en travaillant, c'était le sac de pierres, les coups la mort ! Si vous déclariez ne plus pouvoir quitter votre paillasse, l'infirmier arrivait et d'une piqûre à dose massive vous envoyait rejoindre vos ancêtres... Comme les grands magasins qui ont des rayons de soie, de jouets, etc., Breendonck avait, lui, son rayon de la mort. Ses chefs de rayon avaient grade de major, oberleutnant, leutnant. Ses vendeurs s'appelaient De Bodt, Weiss et autres. Ils y vendaient la mort par fusillade, par pendaison (aff. Colin), par variété de coups, par la faim, la piqûre, le délaissement, l'immersion, la torture, le froid, l'épuisement. En se passant de votre autorisation, ils pouvaient aussi vous inhumer. En plus, vous aviez toujours le droit de devenir fou et celui de vous suicider. Des centaines d'hommes sont tombés à Breendonck et ceux qui ont pu en sortir ne se remettront jamais complètement des souffrances et des privations qu'ils y ont endurées. Nombreux aussi sont ceux qui, par suite de leur âge ou de leur état de faiblesse, n'ont revu leur foyer que pour y rentrer mourir, et l'on sera épouvanté, plus tard, lorsque les statistiques pourront être publiées. Peu de temps après ma libération, je recevais le faire-part suivant : Monsieur François
LEMAITRE (en captivité). Monsieur Siméon VANDEVANDEL né à Genappe le 30 décembre
1888 et décédé à Jolimont le 28 septembre 1943, des suites de
maladie contractée en 1943 à Breendonck. L'enterrement civil aura lieu à Leval-Trahegnies le samedi 2 octobre, à 5
heures. Réunion à la mortuaire, rue J. Jaurès, 38, à 4 h. 45.
Leval-Trahegnies. le 28 septembre 1943. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Chapitre
15 |
|||||||||||||||||
|
Ils sont deux, le père et le fils, prisonniers dans la chambre n° 3. Leur nom est Mendiaux ; ils habitent la commune de Leval (Hainaut). Le père peut avoir 60 ans, le fils de 27 à 30 ans. Le vieux Mendiaux souffre d'une paralysie qui a son foyer au bas de la colonne vertébrale et doit, de ce fait, éviter de rester trop longtemps debout. Le jeune n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été et pourtant tous ses efforts vont tendre à protéger son papa. Il parviendra à se tenir à ses côtés sur le chantier et bien souvent à faire reporter sur lui seul la colère, la cruauté des S.S. Mais les possibilités physiques ont leurs limites. Il arriva qu'un jour le vieux Mendiaux ne put quitter sa paillasse ; il y restait cloué par la faiblesse et un état aggravé de ses maux. Bon gré, mal gré, il fallait pourtant qu'il en sorte, et plutôt que de le voir frapper sur son grabat, son fils le prit dans ses bras et lui permit d'arriver au rassemblement des compagnies de prisonniers. En agissant ainsi, il pensait qu'avant de partir au travail, il pourrait s'adresser au lieutenant allemand, montrer à celui-ci que son père se trouvait absolument incapable d'aller à l' « arbeit » et obtenir qu'il puisse réintégrer sa chambre. Nous étions arrivés à l'endroit où, plusieurs fois chaque jour, notre chambrée devait s'aligner. Une grande cour rempierrée, plus de quatre cents détenus. Le commandement : « Tilstonne » (12) allait retentir, et dans les quelques secondes qui devaient le précéder, l'enfant dit à son père :— Du corâdge chonq munutes, papa, ès après on s'occup'ra d'vous (13). Le commandement retentit, le vieux raidit ses membres, ses lèvres sont bleues, sa figure livide il veut tenir, mais il tombe sans connaissance. N'ecoutànt que son cœur le fils sort des rangs, se précipite sur son brave vieux écroulé, le prend dans ses bras et les yeux pleins de larmes, dans son immense désespoir, ne trouve que ce mot à crier, à répéter sans cesse : — Papa... papa... papa... Le S.S. Weiss d'abord, le lieutenant ensuite, arrivent, et, horreur, frappent avec une monstrueuse frénésie le père inanimé et le fils qui le soutient, qui veut le couvrir. Le jeune Mendiaux doit plier contre la force et plus de quatre cents détenus pleurent avec lui. Nouveaux commandements, les prisonniers partent au travail. Ceux des pierres quittent la cour les premiers, et c'est un bonheur, car les prisonniers occupes au sable — dont nous étions — seront les seuls à voir le vieux papa ouvrir les yeux, à le voir traîné par Weiss près du bac à eau dans lequel on lui plonge la tête, à voir le lieutenant le cravacher à nouveau, à voir enfin Mendiaux s'écrouler dans une nouvelle perte de connaissance. Mais patience, le temps est un juge incorruptible qui fait justice à tous. -------------- Un autre vieux était l'ancien conseiller communal communiste de la commune de Lodelinsart (Hainaut). Ignorant son nom et vivant traqué, il ne m'est pas possible, bien qu'ayant aussi mon domicile à Lodelinsart (depuis 1941), de permettre qu'on l'identifie autrement qu'en faisant état de son ancien mandat politique. Dans une de leurs rages criminelles, les S.S. Weiss et De Bodt s'acharnèrent sur lui pendant plus de deux heures. C'était en février 1943. La violence des coups était telle qu'à chacun de ceux-ci, le corps du supplicié se faisait plus rouge, plus sanglant. Sa chemise était en lambeaux. Il gisait presque nu sur le sable que balayait une bise glaciale. Il parvint encore, pour la quantième fois, à se mettre debout. Les coups s'abattent à nouveau, et, vaincu par la douleur, il tombe une dernière fois après avoir vu couler son sang, après avoir senti craquer ses os. Bien des prisonniers pleurent de rage impuissante et de tristesse, leur émotion cédant sous l'impression douloureuse du spectacle offert à leurs yeux par deux créatures sataniques se réjouissant des larmes qu'elles font répandre, se complaisant au milieu des cris de leur victime, au milieu du sang qu'elles ont versé. Les S.S. s'acharnèrent jusqu'au meurtre, car c'est à l'état de cadavre et dans une brouette qu'il rentra dans le fort. En cette journée sinistre, les griffes de Satan parurent sous les dehors des hommes, des S. S. Weiss et De Bodt --------------- L'oberleutnant regarde charger les bennes. Il a l'œil mauvais, et, pour ne rien changer à ses habitudes, ce digne représentant du déséquilibré de Bergtesgaden se trouve sous l'influence de la boisson. Il commande au chien du major de nous attaquer, de nous mordre, mais ce jour-là le chien est meilleur que lui, il ne veut pas ! D'autres chiens veulent bien, ce sont les S. S. et les zug-fiihrer. Les chicotes sifflent, s'abattent. On entend des cris de douleur. Le zug-führer Valère Devos, d'Alost (Flandre Orientale), un ancien volontaire des Brigades Internationales d'Espagne, mais un « tourne-casaque », appelle deux camarades et les oblige, en les frappant de coups de poing en pleine figure, de coups de pied au ventre, à se charger chacun d'un sac de pierres. Lèvres fendues, dents cassées, arcades sourcilières ouvertes, les deux prisonniers, la figure méconnaissable, doivent reprendre la pelle. L'oberleutnant approuve et Devos crie : — Pas-op, zulle (14), celui qui ne charge pas va crever. A ce moment, il semble qu'il n'y a plus qu'un tortionnaire à Breendonck. Les S.S. eux-mêmes prennent rôle de spectateurs. Une benne commence à rouler. L'une des victimes s'y accroche et s'éloigne vers la rivière, où le sable doit être déversé. L'autre, moins heureuse, reste appuyée sur sa pelle ; elle crache ses dents et son sang. Devos s'en approche et lui crie : " Vous allez travailler maintenant ?" Notre camarade tente de se mettre debout, mais il tombe. Le « zug-fiihrer » lui brise les côtes à coups de pied... Cinq, six, dix coups, mais l'homme ne s'est pas relevé, il ne bouge même plus ! Une bave sanglante bouillonne en lui sortant de la bouche. Le soleil rejoint un horizon lointain, ses derniers rayons couvrent le sommet de l'église de Breendonck ; est 17 heures ! L'oberleutnant est satisfait, les S.S. sont contents, et le « zug-fiihrer » Valère Devos, prisonnier lui-même, dévisage les hommes, les provoque de ses regards. A l'arrière de la colonne, on transporte un corps, et à dix-neuf heures, le même jour, une mère, une épouse» des enfants pouvaient pleurer : l'être chéri avait cessé de vivre ! Un mort encore qui allait vivre dans le souvenir des vivants et un nouveau meurtre à venger. D'autres pourront après la guerre rappeler le nom de ce malheureux. Nous fûmes plus de deux cents à voir scène atroce rappelée ci-dessus. Il en sera de même
pour le « zug-führer » de la chambre 7, dont j'ai aussi oublié le
nom, mais dans la chambre duquel couchaient Henri
Glineur, député
communiste, et Alfred Musin, militant de
Je ne pense pas que ce « zug-fiihrer » ait jamais tué mais ce que je puis affirmer, c'est qu'il a souvent frappé, c'est que lui aussi a mouchardé et trahi bien des prisonniers en livrant leurs confidences aux S.S. ou à la Gestapo. Ses coups n'étaient pas moins violents que ceux des S.S. ou autres « zug-führer ». La dernière fois que je l'ai vu frapper, c'était sur la personne de l'agent de police Armand Brockaert, de Jette (Brabant). Il porta à ce dernier un violent coup de poing à la figure. Brockaert lui plaça un fameux direct, nous arrachant à tous un cri d'admiration. En agissant ainsi, Brockaert rentrait dans ce droit primitif, dans cette liberté antérieure aux conventions humaines, que tout homme à de se défendre contre un étranger qui l'attaque. Mais le feldwebel de service arrivait à la rescousse et le policier fut sauvagement battu. Brockaert ne devait plus sortir vivant de Breendonck. Il fut passé par les armes le 15 mars 1943. Je dois à la vérité d'ajouter qu'il ne faut établir aucun lien entre la scène de coups et celle de l'exécution. --------------- Il est neuf heures du matin ; le vent est froid... On nous a fait enlever notre veste, nos membres sont glacés. Weiss et De Bodt s'approchent. Le dernier nommé interpelle un jeune homme ayant à peine 17 ans : - Vous ne pouvez pas
travailler plus vite ? Avec un gros rire, De Bodt s'adresse à Weiss : - Weiss,
Leleux heeft
koud (15). De Bodt pousse Leleux dans la rivière, lui laissant reprendre pied, le repoussant une nouvelle fois dans l'eau. Leleux revient à nouveau ; il prie, supplie qu'on cesse de le torturer. Les S.S. le frappent, ils sont sourds à sa voix, insensibles à ses prières, à ses gémissements. Pendant que De Bodt fait un trou, l'autre frappe toujours. Ils enterrent l'adolescent jusqu'au cou et lui jettent des pelletées de sable à la figure. A onze heures, le petit Leleux fut transporté par ses camarades et nous espérions qu'il pourrait s'en tirer, que sa jeune et forte constitution lui permettrait de vivre. C'était compter sans la rage destructrice des rebuts humains qui nous gouvernaient. Les S.S. reprirent Leleux qui fut couché complètement nu sous une douche glacée : autant eût valu le fusiller. Cette mortelle opération terminée, il fut reconduit dans chambre, où il ne vécut plus que quelques heures. C'est déjà bien dur de voir tuer un homme, mais un enfant... Cette nuit-là, je n'ai pu dormir. Les cris qu'il avait poussés, les coups qu'il avait reçus, le bruit de la chute de son corps dans la rivière retentissaient encore douloureusement dans mon cœur, et je dus appeler tout ma force de volonté à mon aide pour ne pas éclater sanglots. Pauvre maman qui à Châtelet pleurez votre grand gamin, je vous prie de me pardonner cet horrible récit. Mon but, je le répète, est d'alerter la conscience universelle afin qu'elle porte le même verdict sur les criminels de guerre que nous connaissons. Je me souviens aussi d'un Juif que Weiss et De Bodt ont mis à mort de la même façon. Le prisonnier travaillait le long de la rivière au remblaiement, mais il n'avait plus la force de tenir la cadence de travail imposée par les S.S. C'était suffisant pour nos tortionnaires et le crime fut décidé. Voici, très exactement rapporté, tout le processus de l'exécution : II pouvait être 14 h. 30 lorsque les S.S. arrivèrent à hauteur des hommes travaillant à la rivière. Après avoir repéré leur victime, ils la firent remonter le talus et l'obligèrent à enlever ses pantalons. Frappé de coups de chicote par De Bodt, l'homme tomba sans que pour cela la brute cessât de s'acharner sur lui. Les coups tombaient sans arrêt, et nous qui assistions journellement à ces scènes, nous disions : « II ne rentrera pas vivant. » Ce ne fut bientôt plus qu'un pauvre corps pantelant, saignant de partout... une masse de chair meurtrie, toute dégouttante de sang... Ils s'en rappelleront, mes camarades de Breendonck ; c'était à la fin de février 1943. Comme moi, il leur suffira de fermer les yeux un instant pour revoir comme alors le drame qui s'accomplissait, et eux aussi réentendront ces cris épouvantables, ces supplications désespérées, ces cris d'agonie, ces râles... Weiss revint avec deux morceaux de bois et une pelle. Il creusa un trou dans le sable, joignit les bouts de bois en croix et figea celle-ci à hauteur du trou. Ensuite, les bourreaux soulevèrent le supplicié qu'il lancèrent dans l'eau glacée de la rivière. Le malheureux parvint à reprendre pied ; son corps ne formait qu'une plaie, ses dents s'entre-choquaient. et, près de lui, un prisonnier tentait de le ramener vers le plan du bas du talus. Ce prisonnier, c'était son frère ! Weiss et De Bodt s'emparèrent à nouveau de leur victime et la placèrent dans le trou. Celui-ci fut comblé et seule, devant la petite croix, la tête passait encore. Sur cette pauvre face mourante, les coups de chicote tombèrent à nouveau... Mais vous le représentez-vous, ce crime ?... Les yeux du malheureux s'ouvraient après chaque meurtrissure comme s'il pensait : « Allons, maintenant vous êtes satisfaits... Là, oui, je souffre, je suis glacé, je saigne... » Ah ! si vous aviez vu ses regards lorsqu'il se senti perdu, quelle expression de révolte contre une mort ausi tragique ses yeux avaient : ces yeux qui, en un instant, rendaient compte de toute une existence... En cet après-midi de drame, il a compris que le jour suivant ne se lèverait plus pour lui. Le pauvre corps était mutilé... Ce qu'il dut souffrir avant de trouver le calme dans cette sérénité de la mort après l'assassinat ! Retiré du trou, le corps apparut comme une forme de cauchemar, les tueurs avaient signé leur crime de plus de cent coups de chicote, et c'était vrai, vrai, terriblement vrai. A l'heure de la rentrée au bagne, le cadavre fut mis sur une brouette.Dans les bras de celle-ci, on mit — je frémis en l'écrivant — le frère... le frère qui avait assisté, impuissant, à l'horrible assassinat, et derrière la brouette, la pelle sur l'épaule, une cinquantaine de Juifs qui, sous la menace d'être abattus immédiatement, furent obligés de traverser le camp en chantant ! Pauvre camarade, tu n'eus personne pour te réchauffer dans cette suprême étape. Le souvenir de ton horrible supplice hantera nos nuits jusqu'au moment ou tu seras vengé. --------------- Un autre monstre dont tous ceux de Breendonck se souviennent est l'ignoble Van Praet. C'est un Belge qui exerçait librement les fonctions de chef jardinier. Nous l'avons vu plus de cinquante fois dénonçant, livrant aux coups des S.S., des malheureux qui s'étaient approprié une carotte ou un chou-navet. En ces circonstances, il commençait à frapper l'homme pour lequel il réclamait ensuite les coups des bourreaux militaires. Beaucoup de nos compagnons ont vu le soleil se lever pour la dernière fois pour avoir été surpris par Van Praet avec des déchets de légumes en poche. Cet individu avait son foyer à Breendonck ou dans un petit village des environs. Chaque matin, il arrivait au camp, prenait dix ou quinze prisonniers, se faisait accompagner de six ou dix soldats mitraillette au poing et les conduisait aux mottes de navets, de carottes, pour faire travailler. Imaginez-vous ces affamés qui auraient mangé n'importe quoi, chargeant des légumes à la fourche et pouvant mordre dans un navet, ni même mâcher quelques racines ? Mais quand une faim enragée vous tient, on voit rouge la raison est absente, un navet c'est la vie... on le parce que les jambes et les bras n'en veulent plus... va tomber s'il faut continuer à charger ces « bonnes choses » sans pouvoir y toucher... On n'a plus qu'une idée dans la tête : prendre un navet et le mordre...manger... manger ! Quel supplice on endure, et Van Praet qui est là, qui observe, qui sait tout ce que ces hommes souffrent, qui le sait mieux que n'importe quel autre, car il fut lui-même prisonnier (17). Son regard est cruel... il affecte de ne pas comprendre le français, qu'il entend et parle correctement. Il aura ainsi l'occasion de surprendre des conversations imprudentes qu'il rapportera par la suite à la clique galonnée. |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Le prisonnier sent croître son impatience, il ne pense qu'à la faim qui le dévore, il est incapable de rassembler d'autres pensées, il s'efforce de concentrer son esprit pour bien examiner, prendre toutes les précautions, mais il ne sait rien faire. Attendre ? Oui, cela vaudrait mieux, mais après... Tant pis ! Il se baisse, s'empare d'un navet... le fourre sous sa veste. Son cœur bat la chamade dans sa poitrine, il reprend sa fourche, ses mains tremblent... On n'a rien vu — du moins il le croit — il se rassure, il travaille. Soudain, il voit Van Praet s'avancer vers la rivière, d'une voix forte il l'entend héler les S.S. Une barque traverse la rivière, les S.S. arrivent... c'est pour lui... il le sent ! Il voudrait se débarrasser du chou-navet, mais il n'ose... Il voudrait voir tous les siens présents, leur expliquer sa faim, leur faire comprendre « son crime ». Hélas ! ils sont si loin ! Les brutes accostent, leurs ricanements sont prometteurs de maux épouvantables. On lui arrache ses vêtements, le navet tombe ! Il sera fouetté tant et tant qu'il restera à l'état de cadavre sur cette terre des Flandres, près d'une motte, près d'un navet qu'il désirait tant, d'un navet qui devait lui rendre un peu de vie, mais qui n'a pu que lui apporter la mort... L'assassin n° 1, c'est Van Praet ! Les autres, vous les connaissez ! Je laisse aux Juifs le soin de défendre leurs compatriotes tombés à Breendonck sous les coups ou enterrés vivants. Deux, trois, quatre et
jusqu'à six le même jour ! Les Juifs étaient logés
dans les chambres I et II Le « zug-führer » du I, juif aussi, répondait
au nom de « Hopla ». Celui du II n'était jamais appelé que par
son prénom : « Khann ». Ils ont prêté la main
à assez de crimes pour disparaître à jamais du monde des vivants.
J'ai vu « Hopla » tuer un de ses compatriotes à coups de bêche. J'ai
vu « Khann » participer avec De Bodt aux meurtres de trois Juifs.
Ceux-ci étaient nus et enterrés jusqu'au cou après avoir été jetés
dans l'eau placée de la rivière. Devant leurs yeux épouvantés, Weiss
planta trois croix, faites avec des bouts de bois ramassés dans le
camp. Ils les regardèrent pendant plus de deux heures avant d'être délivrés
par la mort de l'effroyable supplice. J'ai vu bien des choses
atroces commises sur les Juifs. Ceux-ci en témoigneront un jour eux-mêmes
et leurs témoignages entreront dans l'histoire des cruautés de notre
temps. On était toujours heureux de pouvoir se trouver, durant les heures de
travail, auprès d'un camarade connu, d'une figure amie. Occupé à charger une
benne, j'ai parfois un regard pour un grand et beau jeune homme qui
peine à mes côtés. Je l'interpelle : — Ça ira, camarade ? Sa figure était éclairée
d'un bon sourire. Le sabot gauche était celui qu'un fusillé avait
laissé sur la route oui le conduisait au supplice et que mon camarade
Fernand Serbruyns, de Jumet, avait déterré. Le droit, d'un autre moèle
m'avait été donné par André Wittezaele, un armateur ostendais.
Pendant des semaines, des mois, Emile travailla à mes côtés. Il était grand, résistant aussi et solide. Nous nous aidions mutuellement. Dans les derniers jours du mois de mars, on vint crier son numéro sur le chantier. Il partit avec une sentinelle armée. Je le revis dans l'après-midi : — Alors,
Emile,
interrogé ?... Le 1er avril 1943, avec une vingtaine d'autres détenus, Emile fut rappelé de son travail. A midi, je le vis dans le costume qu'il portait au moment de son arrestation. Il se tenait sur le seuil d'entrée de la chambre 6, et au moment de mon passage dans le couloir il m'appela : — Victor... On s'embrasse, quelques larmes que l'on tente vainement de refouler. Je me hâte, car tous les hommes de ma chambre sont rentrés. Quelques jours après, Emile Maufort était fusillé à Bruxelles. Fauché à vingt ans
pour l'honneur de sa race, pour l'amour de son pays : La mort ? Il n'en a pas peur, mais il veut vivre pour sa patrie, pour ses parents, et même dans sa cellule il ne veut pas encore se déclarer vaincu. C'est le soir, on vient d'opérer la relève, les galeries de la prison sont désertes. Il entend le bruit des pas du geôlier allemand. Il partage sa cellule avec d'autres condamnés. Ils ont déjà voulu desceller les barreaux de la fenêtre, mais ils n'y sont pas parvenus. L'Allemand entend heurter une porte, on l'appelle. Il ouvre, et sans avoir eu le temps de pousser un cri, il est réduit à l'impuissance. Emile et ses compagnons s'emparent des clés, se précipitent dans les galeries, arrivent à 'la grosse porte de la prison, mais, malheur ! ils ne peuvent l'ouvrir. Les bruits de lutte, leur course ont donné l'alerte, ils sont repris ! Ils sont enfermés à nouveau, tout est perdu ! A présent qu'il n'y a plus aucune chance d'échapper à la mort, Emile, cet enfant dont ses anciens maîtres d'école vantent encore la sagesse, la modestie, la bonté, la droiture, Emile, fils dévoué et aimant, va écrire à ses parents sa lettre d'adieux. Il leur écrit de sa cellule, leur explique la tentative d'évasion, il leur dit qu'il sera fusillé à l'aube, après avoir entendu la messe à la chapelle de la prison. Il saura mourir bravement et ajoute combien il trouve réconfort en ses derniers moments par la présence de l'aumônier de la prison qui, par son éloquence pleine de douceur et d'onction, l'a amené à ces sentiments de résignation et de piété qu'il a devant la mort. Voici le texte de la lettre qu'Emile Maufort écrivait quelques heures avant de mourir :(In het Nederlands) |
|||||||||||||||||
|
Bruxelles-Saint-Gilles. le 19 avril A ma Maman, mon Papa et ma petite Sœur, |
|||||||||||||||||
|
Cette lettre, mes trois chéris, est la
dernière que vous recevrez de votre fils. Elle va vous causer bien de
la peine. Mais, hélas ! je vous demande bien du courage pour la lire.
Quand vous la recevrez, j'aurai fini de vivre. Le Tribunal militaire m'a condamné à mort, je dois être fusillé demain mardi 20 avril 194S, à 7 heures du matin. Mes dernières pensées sont pour vous. Je vous écris de ma cellule, à la prison de Saint-Gilles. Peut-être ces lignes vous sembleront désordonnées. Excusez-moi, j'ai peur de ne pas vous dire tout ce que mon âme exprime. La première chose, la plus importante : je vous demande pardon devant Dieu de la grande peine que la triste nouvelle va vous causer. Mais j'espère que vous serez forts, très forts tous les trois, afin de supporter cette dure épreuve. Pour ma part, n'ayez aucune crainte, la seule chose que je regrette est la douleur que je vous cause. La mort me trouvera très courageux, soyez-en sûrs. Lorsque je vous ai quittés, j'avais l'espoir que notre séparation serait courte et que de beaux jours viendraient pour nous quatre. Il ne sera plus de beaux jours. Pour vous, il ne sera plus que le souvenir d'un grand garçon qui dans sa courte vie vous aura causé bien des tourments et bien des soucis. Pour moi, l'espoir de nous voir réunis dans un monde meilleur.Je relaterai ici les menus événements de ma vie de détenu depuis le triste moment de mon arrestation. Lorsque je vous ai quittés, la nuit du jeudi 31 décembre 1942, je fus conduit à la prison de Charleroi et mis en cellule de passage. J'y fus bientôt rejoint par quatre autres civils des environs de Roux et Courcelles, arrêtés vers la même heure que moi. Le matin du Si, donc le même jour, après nous avoir servi notre déjeuner, un morceau de pain et une tasse de café chaud, on nous réunit à une vingtaine de détenus dans le hall de la prison et l'on procède à l'appel de nos noms. Ensuite, nous sommes chargés en camion et dirigés vers la caserne d'infanterie, où quatre autres camions sont chargés également de détenus. Nous sommes en tout 84, je crois, acheminés vers Bruxelles par un temps déplorable : îl neige abondamment. Nous passons Bruxelles vers midi et arrivons au camp deconcentration de Breendonck dans l'après-midi. Là, on nos vêtements civils en échange d'uniformes mili-taires de l'Armée Belge ; on nous rase également les cheveux. Vers 6 heures du soir, nous sommes départagés dans chambres du fort. Pour ma part, je me trouve avec prisonniers des environs de Charleroi arrivés dans le même transport. Jusqu'à mon départ de Breendonck, j'ai eu en eux de bons camarades, surtout en ..................., qui fut très bon pour moi. Il fut là-bas mon frangin, comme nous nous appelions. Si vous le pouvez, remerciez-le pour moi quand vous le pourrez. Quelque temps après, on nous réunit dans une autre chambrée, où nous sommes plus nombreux (48) et où je retrouve une connaissance. A son retour, allez le remercier de ce qu'il fit pour moi. Il me soutint moralement dans les moments de cafard, mais n'a pas toujours su me comprendre, comme le fit si bien mon ami Honoré, avec qui j'avais formé bien des projets. Demandez-lui qu'il remette un dernier souvenir de ma part aux autres amis de Breendonck. Pour beaucoup d'entre eux, j'espère y avoir laissé le souvenir d'un bon camarade. Vers la mi-janvier, on nous mit aux travaux de déblaiement à l'intérieur du camp, travaux tres durs, surtout pour ceux qui n'étaient pas habitués. Nous y travaillions toujours lorsque le 1 er avril, dans la matinée, après l'appel, on nous réunit, 45 d'entre nous, et l'on nous remet nos vêtements civils ; les mieux informés parlent d'un convoi pour l'Allemagne. Au juste, on ne sait rien. On part, c'est tout. Seuls des camarades du début viennent avec. Nous sommes conduits à la prison de Saint-Gilles et logés en commun. Le lendemain, vendredi, nous sommes répartis en cellules, par quatre. Je m'y trouve avec .............. Ces noms ne vous disent rien, sans doute ; ils étaient chefs de groupe de l'organisation dont je faisais partie. Bientôt le projet de nous évader mûrit parmi nous. Il causa notre perte. Nous avions à cette fin commencé à scier un barreau de notre cellule, lorsque le hasard fit changer nos projets. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
La nuit du lundi 5 au mardi 6, il y a juste quinze jours, la porte de notre cellule étant restée ouverte, par quel mystère encore maintenant nul ne l'a compris, nous en profitons pour assaillir la sentinelle au cours de sa ronde et lui prendre ses clefs — nous croyions du moins qu'elle les possédait — afin de libérer nos camarades et nous enfuir en commun. Mais, hélas ! ces clefs ne nous permettaient point de sortir du bâtiment et nous étions toujours prisonniers, mais, hélas ! dans d'autres conditions ; nous fûmes mis en cellule séparément. Nous en sortons le lundi 11 avril matin, afin de passer devant le Tribunal militaire, qui nous condamne à mort tous les quatre. On nous autorise néanmoins à introduire un recours en grâce. Jusqu'à il y a quelques heures, j'ai fermement espéré en celui-ci et prié Dieu afin qu'il nous soit accordé. Mais cette grâce nous a été refusée, et ce jour, à 18 heures, le Tribunal nous a appris la confirmation de notre peine. Nous devons être fusillés demain 20 avril, à 7 heures du matin. A l'énoncé de ce jugement, ma seule pensée a été pour vous, mes trois chéris. Quel coup terrible cela va être pour vous, et comme il vous faudra bien du courage lorsque vous apprendrez la triste nouvelle. Votre fils, que vous espériez tant revoir, ne vous sera plus rendu. Et pourtant, j'avais formé de si beaux projets pour après mon retour. Comme je m'étais promis de bien vous chérir, après la peine que vous aurait causée notre séparation. Hêlas ! je ne vous reverrai même plus, cette dernière grâce m'ayant été refusée. Je vous écris, c'est tout. Je vous écris pour vous demander pardon comme je ne saurais assez le demander. Pauvre maman, comme tu vas souffrir ! Et pourtant, il faut être forte, très forte quand tu apprendras la nouvelle. Il faut vivre, crois-moi, pour mon papa et ma petite sœur; il faut vivre pour toi. Il ne faut point que mon sacrifice soit inutile. Toi aussi, papa, tu dois être fort, pour toi d'abord, pour maman et Paulette ensuite. Je compte sur toi pour les aider à supporter leur douleur. C'est la guerre, que veux-tu, et je ne suis qu'un soldat qui tombe comme tant d'autres tombent dans tous les coins du monde. Tu dois te taire à cette idée, je sais que cela sera très dur, mais il le faut, et je suis persuadé que tu le feras, que tu comprendras que notre mort n'est point inutile, que notre sacrifice n'est point vain et que notre mort, pour être moins glorieuse, n'en est pas moins celle d'un soldat. Je te demanderai beaucoup du courage, à toi aussi, petite soeur chérie, et que je regrette ne pas avoir chérie beaucoup plus. Ta douleur sera grande, je le sais, mais ton courage devra être de même. Tu es la seule qui reste à présent pour supporter nos parents. Tu n'es plus une petite fille, tu es une femme ; comme une femme, tu seras forte. Je te demanderai de prier beaucoup pour moi. Je sais que tu le feras déjà pour toi, fais-le également pour moi. J'ai beaucoup prié depuis mon arrestation, et cela me fut d'un grand réconfort. D'ici quelque temps, je l'espère, tu feras ta vie, petite soeur, tâche de bien la faire. Montre-toi femme honnête, bonne épouse, prends exemple sur notre chère Maman qui est si bonne, si douce, et que je n'ai su récompenser comme je l'aurais dû de toutes ses bontés. Tu auras une famille ; à nouveau, prends exemple sur la nôtre, si belle au temps des beaux jours. Mais avant tout, je te demande, jusqu'à leurs dernière jours, de bien veiller sur nos parents. Je t'adresse ce vœu comme une prière. Il faudra le respecter en souvenir de moi et tâcher, par tes bons soins, tes caresses, de leur adoucir la peine que je leur aurai causée. Je dois également vous dire une chose qui vous réconfortera
quelque peu ; j'espère que ce sera beaucoup plus tôt : je meurs chrétien.
Dans quelques heures, à 3 heures, je crois, j'entendrai
J'espère qu'ils conserveront de moi un bon souvenir. Je n'oublie pas non plus nos deux prisonniers, qui auront bien de la peine à l'annonce de la triste nouvelle. J'adresse une pensée particulière à nos deux fiancés, Georgette et Pol, et leur souhaite une vie heureuse à tous deux. Qui aurait cru qu'un aussi bel événement que leurs fiançailles serait suivi d'une aussi brutale séparation ? Grâce à eux, nous aurons passé de dernières belles heures ensemble. Je m'excuse si j'oublie ici un membre de la famille. Je les embrasse tous bien fort une dernière fois. Je vous demanderai aussi, chers parents, de remettre mon dernier souvenir à tous les amis que j'ai pu avoir. Tout d'abord, notre chère Henriette, à qui ce sera le tour de supporter Maman dans l'épreuve qu'elle traverse. Dans quelques heures, j'irai rejoindre notre petit François. Bon souvenir à ce cher vieux « Solid' », à Aimée et Willy, à qui je souhaite un mariage heureux, et demande de bien veiller sur Poulette ; je compte beaucoup sur eux pour cela. Chez les Bailleux également, qui furent pour moi de vrais amis et qui seront également bien peines lorsqu'ils apprendront la nouvelle. Ne pas oublier Marcel et Elise, Emile Van Acker et sa femme. Je remercie ici Marcel et Emile de l'attention qu'ils ont eue pour moi pendant ma courte carrière de coureur cycliste. Je te demanderai, Papa, d'aller à l'Arsenal remettre une dernière pensée de moi aux amis. Tout d'abord au Commandant Ledieu, qui, je le crois, fut toujours content de mes services, ainsi d'ailleurs que les autres officiers pompiers. Ensuite, au bon camarade que fut pour moi Ernest Gonne. A toits enfin, Xavier, Willy, Gaston, etc. Aux amis de Chez Astrid également, à la gentille camarade que fut pour moi Camélia et à ses parents. J'oublie certainement de citer des camarades, mais à tous je leur adresse une dernière pensée, aux amis de Thy-le-Château, à mon ancien chef M. Dargent, etc. Ne pas oublier M. Gérard et le remercier de l'attention qu'il a eue pour moi au cours de mes études. Je ne vois vraiment plus qui citer, mais si j'oublie quelqu'un, pensez-y pour moi. Nous avons été autorisés pour la dernière nuit à être réunis deux par deux, je suis ici avec Frans Michiels, qui, de même que mot, écrit à sa famille. Notre moral est bon à tous les quatre ; il le faut, nous saurons tomber en hommes. Je ne sais plus que vous dire, chers parents, et j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Toujours cette même idée : implorer votre pardon. Je prie Dieu, afin qu'il me l'accorde. Je ne vois plus rien d'autre à vous dire, mes trois chéris, qu'à vous demander à nouveau du courage. Je viens d'être confessé ; dans quelques minutes, je pourrai entendre la sainte messe et communier. Je vous adresse donc un dernier adieu avant d'aller rejoindre tous ceux qui nous sont chers et qui nous ont déjà quittés et à qui nous serons réunis tous les quatre un jour. De Là-Haut, près de ma chère Bonne-Maman, je prierai afin que vous puissiez vivre de beaux jours encore. Adieu, mes chéris, bon courage. Votre fils, qui jusqu'à la dernière heure a pensé à vous, EMILE. NOTE. — Les passages de la lettre où se trouvent des pointillés avaient été supprimés par la censure allemande. Le jour de ma libération, à peine débarqué de la gare de Charleroi, pouvant à peine mettre un pied devant l'autre, je me rendis au café du « Prince Charles », tenu par le frère du docteur Camille Jeuniaux. Je tenais une promesse faite à celui-ci avant de quitter le bagne. En cet établissement, le même soir, je fis appeler Félix et Joseph, les oncles d'Emile Maufort, mais je n'ai pu me résoudre à voir ses parents, mes sentiments attristés ne pouvant qu'accroître leur immense douleur. - - - - - - - - - - J'avais retrouvé à Breendonck les policiers de Jumet dont je vous ai déjà donné les noms dans un précédent chapitre. Magnifiques de courage et de dévouement, ils eurent à Breendonck une conduite digne de tous les éloges. Les coups ne leur furent pas ménagés. A certaine période de notre détention, j'ai bien cru qu'ils quitteraient le fort dans un cercueil ! Cambier, Huet, Renard n'étaient plus que les ombres de ce qu'ils avaient été Les yeux s'apercevaient à peine, la face était devenue quasi méconnaissable. Un jour après-midi, Jean Goisse vint me dire : « On m'a fait travailler près de la rivière et du côté de l'entrée du fort ; j'ai vu ma femme, c'est elle que j'ai aperçue sur la route de Willebroeck, j'en suis certain, Victor... » Et je serrais les mâchoires pour cacher mon émotion, car deux grosses larmes perlaient aux yeux de mon camarade. C'est Dehoux, avec qui je partageais quelques épluchures de navet ramassées dans le camp et c'était si bon... Chaque matin, lorsque nous sortions pour la cour, Je profitais de quelques minutes pour me rapprocher d'eux. On s'encourageait mutuellement... on se racontait les dernières traîtrises des mouchards, on parlait du pays, on espérait, oui, toujours on a espéré !A nos brèves conversations venaient se joindre Gaston Hoyaux, Alfred Musin, Bracops, Willy Colassin, et d'autres, bien d'autres que j'oublie et auxquels je demande de ne pas m'en vouloir. Puissent-ils comprendre que je ne puis tout me rappeler et qu'une menace terrible pèserait sur moi si par malheur mes écrits étaient découverts. Il faut que l'on sache immédiatement qu'aucun nom n'est désigné dans mes feuilles manuscrites, mais qu'une personne spécialement désignée se chargerait de combler cette lacune. Hanard, Renard, Cambier, Goisse, Dehoux, Huet représentaient la police wallonne à Breendonck. Et tenez, justement, Fernand Huet, il faut que je vous en parle : Frappé quasi journellement par Weiss, Huet se trouvait déjà, au mois de février 1943, dans un état physique I lamentable. Un jour, une benne chargée qui précédait 'celle de Huet déraille. Huet se précipite pour aider les camarades de la benne accidentée. Les S. S. ne sont pas en vue, mais Daumeries, le salopard de Jumet, veille et commence à crier : — Schnell ! schnell ! fainéants ! On le supplie de se taire, on lui dit qu'aucun S.S. ne se montre et que la benne va pouvoir être remise sur rails, sais le « zug-führer » gueule de plus belle. Et Weiss, De Bodt arrivent. Les chicotes tombent et Huet reçoit la pointe effilée de l'un de ces instruments de torture dans l'œil. Pendant quinze jours et quinze nuits, il va souffrir sans même une simple compresse à pouvoir appliquer sur l'organe blessé. Son oeil gauche n'est plus un œil... c'est un trou d'où coule le sang, et Huet doit travailler ; s'il faiblit, c'est la mort ! Son état général est tellement délabré que bientôt l'œil droit lui-même est attaqué. Le gauche est irrémédiablement perdu et l'autre est sur le point de perdre sa visibilité. Après les premières heures de travail, Huet ne voyait plus... il chargeait sans voir, recevait les coups sans savoir de quel côté ils venaient. Dans les rangs, Weiss qui savait que notre camarade ne voyait plus, s'amusait à lui faire perdre la notion de son emplacement. Coups de poing, de chicote, et Huet tombait pour se relever et tomber encore. C'est ainsi que Huet fut éborgné par Weiss, après avoir été signalé par Daumeries. Si Huet n'est pas mort à
Breendonck, il le doit à notre camarade
Emile Maufort, dont je vous ai
narré la fin tragique, à Emile Maufort entré dans l'éternité au cri
de : « Vive Chaque fois que Fernand Huet tombait, Emile le ramassait, malgré les coups que Weiss lui portait également. Au travail, Emile aidait Fernand pour empêcher qu'il puisse être repéré, et l'on savait, à Breendonck, ce que cela pouvait signifier. Je connais assez Huet pour savoir qu'il y aura toujours dans son esprit une pensée émue et affectueuse pour le cher disparu. Un de leurs camarades avait été appelé à la chambre des tortures, mais bien qu'au plus haut point de fureur et de frénésie, ses bourreaux ne purent cependant le faire parler. Il savait qu'il serait à nouveau soumis à la question jusqu'à ce qu'il en meure ou veuille reconnaître ce qu'on voulait le forcer d'avouer. Pour être certain de ne pas céder lors de nouvelles tortures, pour ne pas en entraîner d'autres dans son malheur, il préféra se donner la mort. Il s'était sectionné les artères des poignets et mourait sans proférer une seule plainte. Se sentant mouillé, Colassin dont la paillasse était juste placée sous la sienne, s'éveilla. Il faisait noir dans la chambre, il crut que son voisin du lit supérieur urinait dans son sommeil. Il s'éleva jusqu'à lui, le secoua, et c'est en lui touchant le poignet que, dans un éclair de raison, il comprit le drame qui venait de s'accomplir. Ce jour-là, le détenu-coiffeur était passé dans la chambre et y avait laissé son rasoir, car il devait revenir leEn échappant la veille aux mains qui le déchiraient, il s'était juré de ne plus se laisser conduire à la torture. Il est mort pour sa petite Belgique que les Boches égorgeaient. _ _ _ _ _ _ _ Tous les hommes sont au travail. Un des prisonniers s'avance vers le S. S. Weiss et lui dit : — Herr S.S. man, puis-je aller à la cour ? Le S.S. lui applique un solide coup de chicote en criant : — Demande en allemand. Notre camarade, que nous appelions « le potier » en raison de sa profession, fit un effort de mémoire pour se rappeler une phrase qui nous avait été enseignée et recommença : — Herr S.S. man, bitte austreten zu dürfen ? Le S.S. ordonna au potier d'avoir à répéter sa demande en marchant à reculons et de façon telle que sa voix soit toujours entendue. Par crainte des pires choses, notre infortuné compagnon s'exécuta. Nous l'avons vu reculer de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mètres et plus. Lorsque les buttes de sable l'arrêtèrent, il dut les gravir, s'arrêter, crier sa demande du plus fort qu'il le pouvait, gravir encore, recommencer, et il arriva que le prisonnier fut au faîte de son ascension, c'est-à-dire au sommet d'une coupole. Le « potier » était déjà considérablement affaibli, son pauvre corps complètement dérangé par la nourriture infecte du camp. Il avançait péniblement et dans l'état où il se trouvait on pouvait affirmer que chaque journée de travail lui coûtait dix années d'existence... Du haut de la coupole, le « potier » criait toujours : — Herr S.S. man, bitte austreten zu diirfen ? Weiss riait, mais voulait que notre camarade criât plus fort encore. Cette scène dura deux heures au moins ; elle ne fut interrompue que par la fin du travail. Trois jours après, le « potier » mourait d'épuisement en rentrant du travail. Ce camarade n'était pas dans ma chambre et tous au bagne l'appelaient le « potier ». _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nous sommes occupés à charger les bennes; A mon côté se trouve « Robert », un chef-facteur de Bruxelles. Robert a toujours fait montre d'un courage magnifique durant sa longue détention, mais sa santé est ruinée et ses forces l'ont abandonné. A un pareil degré d'épuisement, il devient fatalement une victime toute désignée pour Weiss et De Bodt. Les coups de chicote ne lui sont pas épargnés et les S.S. se tiennent à hauteur de notre benne. Bon gré, mal gré, il faut accélérer la cadence, car les coups peuvent nous tuer et nous en recevons tous. Weiss ordonna à Robert de mettre le sac, et pendant une journée, les 40 kilos au dos, nous voyons notre ami haleter sous l'effort, s'accrochant à tout pour ne pas tomber et mourir sur cette plaine maudite. Je vous ai dit que Robert avait un grand courage, mais dans la chambre je lui ai connu des moments de profond abattement. Il se savait visé par les S.S. : sa faiblesse était extrême et il avait l'impression qu'il ne sortirait pas vivant de Breendonck. Je le revois couché sur sa paillasse après une syncope prolonguée. Il n'était pas le seul à penser qu'il mourrait à Breendonck ; nous le pensions tous. Robert est rentré dans sa famille. Par un miracle d'énergie, il a pu tenir jusqu'à sa libération. A lui-même, à nos autres camarades postiers de Bruxelles qui partageaient notre détention et dont les tortures subies dépassent tout ce qu'on peut imaginer d'atroce, de bestial, j'adresse mon souvenir fraternel. |
|||||||||||||||||
|
Chapitre 16 |
|||||||||||||||||
|
|
« Si la liberté était partout bannie, elle trouverait Un refuge inviolable dans la pensée humaine. Si elle succombait dans ce dernier asile, l'espoir des siècleS l'évanouirait. » (BASTIAT). |
||||||||||||||||
|
Pères et mères, épouses et enfants de tous ceux que Breendonck a tués, c'est à vous que j'adresse cette lettre. Je ne me suis pas reconnu le droit de taire les souffrances sans nom subies dans l'enfer de Breendonck, et comme les victimes du bagne se chiffrent par milliers, il ne m'était pas possible de parler de chacun. Pour tous le régime était le même, les souffrances identiques, les cruauté pareilles... Vous pleurez un enfant, un mari, un père ; et nous, les rescapés, ressentons vivement votre douleur Oui, vous pleurerez avec vos enfants et petits-enfants, vous élèverez leur enfance, vous cultiverez leur jeunesse ; vous leur parlerez de leur père, de votre douleur, de la perte qu'eux etAprès avoir rattaché votre âme au monde par l'amour filial et l'amour maternel acceptez l'hommage de l'amitié et de l'intérêt que tous ceux de Breendonck prendront toujours aux épouses et enfants de leurs anciens et douloureux compagnons de chaîne. Tous, là-bas, savaient être malheureux avec courage. La lutte de ces bagnards aux prises avec des forces les plus cruelles restera un spectacle digne de fixer les regards des historiens de notre temps. Egaux devant les souffrances, tous nos infortunés camarades se trouvèrent devant la mort avec le même courage. A Breendonck, il n'y avait plus de distinction de classes, il n'y avait que des hommes immatriculés, des frères engagés dans une même et terrible épreuve. Qui les soutenait au milieu d'incroyables fatigues, d'incroyables cruautés, d'incroyables privations ? Ils songeaient à l'estime des combattants des pays alliés, à l'estime plus précieuse de leurs concitoyens ; et semblables à ce héros qui, au milieu des périls et des combats, s'écriait : « 0 Athéniens ! qu'il m'en coûte pour être loué de vous ! » cette douce perspective leur adoucissait l'éloignement de leur famille, l'inclémence des saisons le poids des fatigues, la souffrance des privations et l'atroce cruauté des bourreaux. Ils ont immolé leur vie à l'amour de la patrie, ne l'oublions jamais ! Ils savaient que l'ordre nouveau, c'était la force triomphant à la fois du devoir et du droit... L'ordre nouveau érigé en dogme, en idole et qui ne se bornait plus à un pays, à une époque, mais qui prétendait envahir l'esprit humain tout entier, lui tenant lieu de religion et de société, qui prêchait la légitimité du meurtre partout et toujours, sauf contre lui-même ; qui, sous le nom de révolution nationale socialiste, n'était que l'explosion de l'orgueil, qui exigeait tout, insatiable comme la mort, et, comme elle, implacable. Hitler et Mussolini n'auront attaché leur nom qu'à une vaste destruction. Ils ont préparé des fers à leurs compatriotes et bientôt ces fanatiques de l'impossible entendront prononcer leur terrible sentence, car pour eux aussi l'heure du règlement des comptes sonnera ! Pères, mères, épouses et enfants de tous nos
morts de Breendonck, comptez sur ceux de
Nous ne serons dupes d'aucun déguisement du crime
; nous détruirons tous ses abris, nous lui arracherons tous ses
masques. Toute faiblesse serait une insulte à
_ _ _ _ _ _ _ Voleur, bourreau à l'occasion et mouchard, tel était aussi le « zug-führer » de la chambre 5, le fameux Van Borm, d'Ostende. Vous souvenez-vous, lecteurs, de Van Borm ? Quelques années avant la guerre, un crime sadique est perpétré à Ostende. La victime est une femme dont on retrouve le cadavre enfoui dans le sable des dunes. On recherche son meurtrier, une arrestation est opérée, un homme est arrêté. L'affaire paraît terminée quand soudain une lettre arrive d'Espagne. C'est Van Borm qui se dénonce comme auteur du crime pour lequel un autre vient d'être condamné, c'est Van Borm qui va bientôt quitter l'Espagne pour partir en Amérique du Sud et qui avoue, en se promettant bien d'ailleurs de ne plus jamais venir traîner ses savates en Belgique, L'affaire rebondit, la presse s'en empare, l'opinion publique est à nouveau alertée et le parquet général ordonne de nouvelles informations. Mais la guerre d'Espagne se termine, Van Borm est
arrêté, son extradition est réclamée, il est livré à la justice de
son pays. Au moment où les Allemands envahissent La vérité est dure pour vous aussi, hein, Van Borm? Hier "zug-führer", et demain? Hier au Capitole et demain à roche Tarpéienne. J'ai souvent été aux navets et déchets de cuisine. Dans ces expédions, mon homme de couple étair "Kiki", dont je vous ai déjà entretenus. Nous avons agi bien souvent avec la plus folle audace, trompanyt la surveillance des S.S. et bravant les sentinelles. Pris à différentes reprises, nous avons eu la chance d'avoir pu résister aux coups, mais qu'es-tu devenu, toi, mon vieux Kiki? Nous étions repérés, et même et sans aller aux "mottes", il nous suffisait de nous trouver à proximité d'un S.S. pour recevoir des coups. En ce qui me concerne, j'étais encore capable de tenir quinze jours, un mois maximum, lorsque je fus libéré. Un jour, je parle avec le docteur Jeuniaux. Weiss s'en aperçoit et m'appelle : - Vous parlez ? Ce disant, il m'empoigne par le cou, m'entraîne à quelques mètres et je reçois dix coups de chicote. _ _ _ _ _ _ _ Je charge des pierres avec Kiki. Weiss s'approche : - Bientôt fini... oui
?... oui ?... - Pas travailler... non
? non ? Il nous fait déposer nos outils (pinces, pioches), nous place contre un mur de béton et nous assomme à coups de chichote. Le lieutenant m'ordonne de placer de grosses pierres le long de la rivière. L'une d'elles est trop lourde pour ce qui me reste de force et je la fais rouler dans l'eau. Le lieutenant prétend que j'irai la rechercher et il me frappe avec une cravache. Il crie, m'injurie, mais je n'y comprends rien. Il appelle un Flamand, qui vient me traduire les invectives du Boche : « Cochon, fainéant, saboteur. » Je lui fais dire à l'officier que c'est bien involontairement que la pierre s'est échappée de mes mains, et comme les coups qu'il m'a portés l'ont un peu calmé, plutôt que de me jeter à la rivière, il me renvoie à Weiss pour recevoir dix coups de chicote. _ _ _ _ _ _ _ Un autre jour, parce que j'avais une petite flanelle sous ma chemise, Weiss et De Bodt me font dévêtir et mettre à genoux. Je reçois dix coups de chicote du premier et dix coups de cravache du second. J'ai craché du sang pendant plusieurs jours et suis resté près d'un mois sans pouvoir me coucher sur le côté gauche. L'oberleutnant m'a frappé à différentes reprises et m'a fait mordre aux jambes par le chien du major. Je terminerai ces notes me concernant en vous racontant comment, une fois, j'ai fait marche arrière à Breendonck : Après la mort des camarades Mouffe et Poquette, je pris Daumeries à partie dans la chambre. Devant tous mes compagnons, je lui ai tenu le langage suivant : - Daumeries, tu es un lâche, un criminel, et le jour où la guerre finira, on te tirera comme un lapin. Il me répondit : - Nous verrons si tu auras autant de gueule demain au travail. Je te ferai crever ! Tous firent chorus avec moi : les Pesleux, Palise, Serbruyns, Saublens, Bertiaux, Clara, François, Pète, Zavarro, Stass, Lorent, Mendiaux, Lefèvre, Sélifet, Quintellier, Leemans, Coppens, Mertens, Wittezaele, Lems, Dauvin, Missoul, Félix, le neveu de ce dernier et d'autres dont je ne me rappelle plus les noms. Daumeries se tint coi, mais ses yeux disaient assez combien il m'en voulait. Peu de temps après cette scène, il fallait se coucher. Plusieurs heures se passèrent sans que je puisse trouver le sommeil. A mes côtés, mon camarade Fernand Serbruyns était aussi resté éveillé. A certain moment, il m'adressa la parole : - Dis, Victor ? Avant d'aller au travail, le lendemain matin, j'ai dit à Daumeries qu'il n'avait pas à s'offusquer de mes paroles de la veille, qu'il ne fallait voir dans mes propos que la conséquence de mon état d'énervement. Daumeries s'est calmé et voilà ! Je laisse au lecteur le soin de tirer toutes les conclusions qu'il voudra. Lorsqu'il m'arrive de penser à cette scène, je me répète qu'au fond j'avais dit au boucher de Jumet ce que ni moi, ni les autres n'auraient osé dire à un S.S. et pourtant ils étaient tous de la même couvée. Nous avons déjà dit qu'il était strictement défendu de fumer, qu'aucun de nous ne pouvait recevoir la moindre quantité de tabac. Tous les fumeurs savent ce que pareille défense peut faire souffrir un homme, et les Allemands, moins que tous autres, ne l'ignoraient. On fume une cigarette, on « panse » une idée, mais en captivité une cigarette « change » les idées... Voilà la différence. Une cigarette, quelques goulées seulement et les tiraillements de la faim se font moins sentir. Une cigarette permet de pouvoir coordonner ses pensées, de voir la situation moins tragique, moins noire qu'on se l'imagine... une cigarette c'est comme un souffle de la vie d'autrefois, c'est un peu de liberté qui revient... Pendant une vie entière, nous n'avons cessé de gémir et d'aspirer sans cesse à une amélioration de notre condition. Notre arrestation est venue tout détruire, notre vie ne tient plus qu'à un fil, le moindre soulagement à notre malheur serait pour nous le bonheur suprême. N'est-ce pas en considération de ce qui précède qu'on accorde une cigarette aux condamnés à mort ? Et croyez-vous qu'ils la refusent ? Non, ils l'acceptent, ils savent qu'ils n'iront pas au poteau sans en griller une, et, à sa manière sans doute, cette cigarette les prépare aussi à la mort. Tenez, le 15 mars 1943, je regardais mon ami Martial Van Schelle s'en aller au poteau d'exécution. Lui n'a jamais fumé, c'était un sportif de classe, mais je regardais aussi le dernier de la colonne. Petit, mince, les yeux cachés par des lunettes à verres bleus, c'était Louis Everaert. Il avait les mains liées, mais la cigarette en bouche, et je vous assure qu'elle ne tremblait pas. Il aspirait la fumée et la rejetait d'une façon voluptueuse. Je suis fumeur et certain de ne pas me tromper en vous disant qu'il la goûtait vraiment, sa cigarette. Autre exemple : Je passe dans la cour avec ma brouette chargée de pierres. Aucun S.S. en vue, mais derrière les barreaux de la chambre n° 11, fenêtres ouvertes, car c'est une belle journée d'avril 43, je vois deux prisonniers tirant chacun une cigarette. Comment est-ce possible ? Je m'approche et les interpelle : - Dites, camarade, pas
moyen d'étendre
votre bras pour que je
puisse tirer une fois ? Je n'avais osé lâcher les bras de la brouette ; j'ai poussé, suis reparti, mais je ne saurais dire si, à ce moment, je pensais plus au sort de ces malheureux et moins à la cigarette que je les avais vus fumer ou si c'était le contraire... J'ai pourtant fumé en cachette lorsque l'un ou l'autre camarade avait pu mettre la main sur un « mégot » abandonné au sable du camp. J'ai trouvé moi-même des bouts de cigarette, les fumées en furent partagées le soir, sous une couverture, quand les lampes étaient éteintes. Dieu, que c'était bon ! _ _ _ _ _ _ S'il est vrai qu'il n'y a pas de règle sans exception, il est juste que
nous ajoutions que tous les « zug-führer » n'étaient pas de la
trempe de ceux dont nous venons de rappeler les tristes exploits. J'en
ai connu deux dont les sentiments patriotiques ne se sont jamais démentis
: Les camarades « B...
» et André « X... », armateur ostendais. Ils furent désignés en
raison de leur connaissance des langues étrangères. André
« X... » a sauvé plus d'un prisonnier à Breendonck. Différentes
fois, il parvint à soustraire des malades à l'obligation du travail.
Alphonse Coppens de Montigny-sur-Sambre, Fernand Mentens, ingénieur, de
Charleroi, et d'autres dont je n'arrive plus à me rappeler les noms,
lui doivent d'être encore en vie. J'ai parlé précédemment
de quelques personnalités, politiques ou autres, se trouvant à
Breendonck durant ma détention : L'ardeur patriotique
entretint de façon constante chez tous ces hommes l'âpre et fougueux désir
de servir. Aux heures les plus sombres de notre captivité, ils n'hésitèrent
jamais à se porter au secours des confiances en péril. Si l'on veut se
rappeler ce que nous avons dit du Chaque jour des mamans, des épouses, des sœurs arrivaient avec des
colis qu'elles devaient déposer à un poste de garde placé en dehors
du fort. Elles ne voyaient personne, mais partaient heureuses en se
disant que l'être aimé aurait quelques douceurs. Ah ! si nous avions pu
leur crier de tout remporter ! Elles ignoraient que
leurs colis étaient mangés par les officiers et les S.S., pendant que
dans une chambre pouilleuse et humide nous crevions de faim. Elles
ignoraient qu'on brûlait les papiers, boîtes d'emballage devant nos
yeux, mettant les adresses en évidence pour bien nous les faire voir,
pour qu'il nous soit possible d'imaginer tout ce que le colis pouvait
contenir. Le moindre sentiment
d'honnêteté leur commandait de refuser les colis déposés ou de nous
les remettre. Mais je vous l'ai déjà dit : nos bourreaux étaient des
voleurs ! Pensez aux privations
des mamans, des épouses qui voulaient que leurs fils, que leurs maris
puissent recevoir un peu de nourriture... Pensez aux petits enfants qui
se sont endormis, un pauvre sourire aux lèvres malgré leur faim, en
pensant au papa qui allait recevoir son colis... |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
17 |
|||||||||||||||||
|
Des camarades ont pu
tenir à Breendonck en vivant en cellule. Ils devaient y rester en vue
de confrontations éventuelles. Le régime qui leur était imposé était
cependant épouvantable ; il comportait des souffrances atroces. Les
cellules mesuraient Durant une nuit, nous entendîmes ces cris d'épouvante : « Au secours ! Au secours ! On va me tuer ! » Ces cris étaient poussés par Fernand Devaux, de Fontaine-l'Evê-que. Immédiatement après ces appels, nous entendîmes trois coups de feu ! Nous avions tous été arrachés à notre sommeil et les entendus nous faisaient comprendre que les criminels du camp opéraient du côté des cellules. Que s'était-il passé ? C'est notre camarade Joseph Van Hoorde, de Fontaine-l'Evêque, qui nous l'a appris : Marcel Devaux savait que son fils se trouvait dans une cellule voisine, et, malgré les coups, il ne cessait d'appeler son enfant, de le réclamer. La nuit des faits rappelés, les bruits du couloir lui laissant deviner qu'on venait pour le frapper, il parvint, avec la planche de son lit, à barricader la porte de sa cellule. De Bodt, le S.S., criait : « Ouvrez la porte, vous aurez une cigarette ! » Pendant ce temps, le S.S. Weiss était monté au-dessus de la cellule, tendant, de son perchoir, la main à Devaux en invitant celui-ci à la prendre, mais Devaux a toujours refusé. Les bourreaux firent alors appel au « zug-führer » juif Hopla et à l'officier allemand du camp. On enfonça la porte et l'oberleutnant déchargea par trois fois son revolver sur notre malheureux camarade. Malgré ses blessures, Devaux cria à Van Hoorde, qui était dans la cellule voisine : « Djoseph, y m'ont yeu !» (19). Il essaya aussi d'appeler encore son gamin, car ce qui faisait son désespoir, c'était de savoir son enfant en cellule. Témoignages horribles, mais qui sont nécessaires au châtiment des coupables ; c'est dans ce seul but que je les évoque ici. L'oberleutnant était
un homme de Un coiffeur de Ransart répondant au prénom de Valéry apprend qu'il est libéré. Il attend dans le couloir du bagne qu'on veuille le diriger vers la sortie. Les S.S. arrivent et conduisent Valéry auprès de l'oberleutnant. Le S.S. De Bodt dit alors à notre camarade : — Vous allez raser Monsieur l'oberleutnant. Vous lui ferez ensuite un massage facial et lui couperez les ongles en pointe. Si vous èraflez seulement la figure de Monsieur l'oberleutnant ou si votre travail n'est pas parfait vous resterez à Breendonck. Ainsi, Valéry devait, d'une gu... de chimpanzé, faire une figure d'homme. Par quel miracle l'officier boche n'a-t-il pas été coupé ? Pas plus que moi notre camarade ne pourrait le dire, mais ce qu'il peut vous affirmer, c'est que son rasoir tenait à peine dans sa main... Si près de la liberté, de la vie... comme nous le comprenons ! _ _ _ _ _ _ _ Pendant que leurs noms me sont rappelés, j'adresse mon fraternel souvenir à mes anciens camarades de souffrance de la province de Liège : Noville
Jean, de Liège
; |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
18 |
|||||||||||||||||
|
Le sanglant faisceau des décemvirs de Breendonck était formé, en ordre principal, par les individus suivants : Un major du nom de
Smith ou Schmidh ; _ _ _ _ _ _ _ D'autres feront bien de ne pas oublier le couple suivant : Hopla et Khann, qui battirent tous les records de sauvagerie, de bestialité, de tueurs auprès des Juifs. On se rappellera aussi que des arrêts de mort furent pris à Breendonck sur simple avis d'un policier de la Gestapo. Tous ceux de cette clique auront aussi droit au partage quand l'heure de « Némésis » sonnera. Nous avons dit que la
garde du fort était en partie assurée par des soldats et feldwebel de
Je crois que déjà ils se livraient à d'amères réflexions sur les agissements de leurs chefs politiques du Troisième Reich... Ils voyaient sans doute plus clair qu'en juillet 1934 lorsqu'ils capitulèrent devant les Hitler, Himmler, Goering et Goebbels... C'est un auteur français qui nous ramène à cette période de terreur qui devait se continuer par la suite sur les peuples des pays voisins. Ecoutons-le : « C'est le 30 juin 1934 ; la journée qui commence sera une des plus tragiques de l'après-guerre. « Arrivé au ministère, Hitler se fait amener les chefs des S. A. II y a là le général Schmidt, commandant en chef des S.A. de Munich, plusieurs autres encore. Pâle de colère, Hitler s'avance vers eux et leur arrache des épaules les insignes du commandement. Ils seront sommairement jugés et fusillés dans l'après-midi. « Un peu après 7 heures, les voitures s'arrêtent devant l'annexe de l'Hôtel Hanselbauer, où Röhm et ses amis ont établi leur quartier-général. « Le Führer et son escorte mettent pied à terre et pénètrent dans la maison. Quelques heures plus tard, Röhm était fusillé dans une cellule de prison. Il en est de même pour Heines, général des S.A., comte von Spreti, Standartenfiihrer des S.S. de Munich, et Reiner, chef du bureau politique des S.A. « Au début de l'après-midi, la répression commence. Les exécutions sont commandées par le colonel Busch, chef de l'Uschla, ou section de discipline et d'épuration du Parti. « Après avoir subi un bref interrogatoire, les plus hauts chefs de l'armée brune sont introduits un à un dans la cour du Stadelheim. Un ordre retentit. Puis on entend crépiter, à intervalles réguliers, le feu du peloton d'exécution. « Tirer sur des compatriotes est toujours douloureux. Mais tirer sur des camarades auxquels on a été longtemps liés par des liens de l'amitié ou de l'estime, est atroce. Les hommes qui font partie des pelotons d'exécution ont été soigneusement sélectionnés parmi les compagnies de S.S. Ils obéissent au commandement suivant : « Telle est la volonté du Führer ! Heil Hitler ! Feu ! » Les pelotons sont composés de huit hommes, dont quatre ont des fusils chargés à blanc, pour que chacun ignore s'il a personnellement tué. Mais malgré toutes ces précautions, il faut les renouveler fréquemment, car les nerfs les plus solides ne résistent pas au spectacle des corps qui s'effondrent les uns après les autres. « Une première salve abat le général August Schneidhuber, Obergruppenfiihrer des S.A. de Bavière et préfet de police de Munich. Une seconde salve abat le général Hans Hayn, Gruppenführer des S.A. de Saxe ; une troisième salve abat le général Hans Peter von Heydebreck, Gruppenführer des S.A. de Pomérame ; une quatrième, le général Schmidt, Gruppenführer des S.A. de Munich ; une cinquième, une sixième, une septième, abattent le général Fritz von Kraussner, le colonel Lasch, le colonel Kopp ; puis viennent le comte Erwin von Spreti, commandant du régiment de S.S. de Munich, le capitaine Uhl, le lieutenant Reiner, d'autres encore... « Quant à Rohm, un revolver a été placé devant lui dans sa cellule. On lui a accordé, comme une grâce suprême, le droit de mettre lui-même fin à ses jours. Mais il refuse. On lui donne alors dix minutes pour réfléchir. Ce délai écoulé, la porte de sa cellule s'ouvre. On tire à l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'écroule, le corps criblé de balles. Son cadavre est enterré dans la cour de la prison. «
Tandis que ces événements se déroulent
à Munich, Berlin est le théâtre d'incidents peut-être plus
dramati « Goering rentre à son ministère, où il a convoqué le vice-chancelier von Papen. «
— La journée va être très agitée, lui dit-il. Je
vous conseille de rester chez vous et de ne sortir sous aucun « Von Papen va
s'enfermer chez lui et téléphone à
« A la même heure, six hommes en civil s'arrêtent devant la villa du général von Schleicher, sonnent, forcent la porte, et font irruption dans la pièce où se tient l'ancien chancelier. On entend une courte discussion, suivie de plusieurs détonations. Le général s'écroule, tué sur le coup. Sa femme, qui s'est élancée entre lui et son agresseur, est mortellement blessée. Elle expire une demi-heure plus tard, sans avoir repris connaissance. « Cette exécution marque le début d'une série de coups de main qui va donner au 30 juin, à Berlin, sa physionomie particulière. « Vers midi également, Erich Klausener, chef politique des catholiques de Berlin et bras droit de von Papen, se trouve dans son bureau au Ministère des Transports. Deux S.S. font irruption dans la pièce et le mettent en état d'arrestation. Malgré l'ordre reçu, Klausener veut sortir, se lève et prend son chapeau. Deux balles l'atteignent par derrière, au moment où il va franchir le seuil Klausener s'écroule, le chapeau sur la tête. Les S.S. verrouillent la porte du bureau et mettent deux miliciens de faction pour empêcher qu'on y entre. « Une scène similaire se déroule, au même instant, à la vice-chancellerie. Le conseiller von Bose, chef de cabinet de von Papen, se trouve dans son bureau, en compagnie de deux industriels. Trois S.S. entrent sans se faire annoncer et prient Bose de les suivre dans la pièce voisine. On entend quelques coups de feu, Les S. S. se retirent. Le cadavre de Bose gît à terre, dans une flaque de sang. « Quelques heures plus tard, on vient chercher à son domicile le colonel von Bredow, confident de von Schleicher. Il semble avoir déjà été tué dans la voiture qui l'emportait. Edgar Jung, l'auteur du discours de Marbourg, Walther Schotte, conseiller intime de von Papen, et le docteur Voss, avocat de Strasser, disparaissent aussi, sans qu'on ait jamais su les circonstances exactes de leur mort. « II y a là le général
Ernst, Obergruppenführer des S.A. de Berlin, arrêté le matin même
aux environs de Brême,
au moment où il s'apprêtait à quitter l'Allemagne ; le colonel von
Detten, Standartenführer de S.A. à Berlin; l'aviateur Gerd, ancien
aviateur décoré de l'ordre « Pour le Mérite », que Goering a dégradé
lui-même avant de l'envoyer au poteau d'exécution, ainsi qu'un certain
nombre de sous-chefs, arrêtés au Quartier Général de
« Les prisonniers sont collés au mur les uns après les autres. Le peloton, composé de huit hommes, dont quatre ont des fusils chargés à blanc, n'est éloigné que de cinq mètres. A cette distance, les décharges produisent des effets terribles. Bientôt tout le mur est éclaboussé de sang et de lambeaux de chair. « Bien que les salves se succèdent presque sans interruption, il semble que l'exécution ne doive jamais finir. Certains S.S., brisés par la tension nerveuse, ne résistent pas à l'épreuve et doivent être remplacés. Les autres tirent toujours, mus par une sorte de frénésie sauvage. C'est toute la violence accumulée au cours de ces quinze années de lutte, qui se dépense d'un seul coup. « Une atmosphère oppressante règne sur la capitale. La rapidité et la vigueur de la répression ont terrifié les esprits. » Vingt-quatre heures avant, les généraux discutaient encore Hitler et voici que le jour de cet affreux massacre, le général von Blomberg adresse la proclamation suivante aux officiers et soldats : « A
« Le Fûhrer a attaqué lui-même et a écrasé les mutins et les traîtres, avec la décision d'un soldat et un courage exemplaire. «
« Le Führer nous demande d'entretenir des relations cordiales avec la nouvelle S.A. Nous les cultiverons avec joie, dans la conscience de servir un idéal commun. « L'état d'alarme est levé dans tout le Reich. » « Von BLOMBERG. » Si l'armée avait relevé la tête, la dictature se serait écroulée et l'Allemagne n'aurait pas connu cette guerre dans laquelle Hitler débuta par d'autres crimes commis contre ses compatriotes : Le 17 décembre Découvert à l'aube du 13 décembre par le croiseur britannique Ajax bientôt rejoint par deux autres bâtiments de Sa Majesté, l'Exeter et l'Achiles, le Graf-Spee soutint le combat de 6 heures du matin jusqu'à la nuit. En dépit de son armement très supérieur a celui de ses adversaires, il ne réussit pas à les couler, subissant lui-même des dommages tels qu'il dut chercher un refuge dans la rade de Montevideo. Soixante-douze heures après, il en sortait, toujours guetté par la division anglaise prête à rouvrir le feu. Mais à la stupeur générale, arrivé à la limite des eaux territoriales, il stoppait ses machines et, ses prises d'eaux ouvertes, se laissait couler doucement. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Cette fin sans gloire ne peut être imputée
ni à son commandant, le capitaine de vaisseau Langsdorf, ni à son équipage,
mais à des ordres formels envoyés de Berlin par le chancelier Hitler,
en dépit de la résistance opposée par l'amiral Raeder, commandant en
chef de la marine allemande, soutenu par toutes les autorités navales
du Reich. Elle constitue un fait sans précédent dans l'histoire
maritime, et venant après tant d'autres crimes, ajoute au nom d'Hitler
un supplément d'opprobre.
La honte de cette capitulation incroyable, infligée à des marins qui s'étaient vaillamment battus, a été ressentie par tous les gens de mer, à quelque pays qu'ils appartiennent. Quant au commandant du Graf-Spee, pour sauver son honneur et protester à la face du monde il s'est volontairement donné la mort enveloppé dans les plis de son pavillon. Il a, de son propre sang, lavé le déshonneur imposé par un chef indigne, et respecté la tradition qui veut qu'un commandant ne survive pas à son bâtiment. Sa mémoire mérite le respect. Pour arriver d'abord, pour se maintenir ensuite, Hitler et sa bande n'ont fait que tuer. Fusiller, pendre, tuer au travail, etc., etc., c'est éliminer par la manière directe, et c'est à ce calcul qu'Hitler et ses lieutenants, sa Gestapo et ses S.S. ont toujours obéi. |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
19 |
|||||||||||||||||
|
En supposant que les Weiss, De Bodt et autres S. S. du camp aient pu quitter le pays, comment les obliger à rentrer ? Il est évident que cette question se pose tout autant pour les « zug-fiihrer » traîtres de même que pour le chef-jardinier de Breendonck. Le moyen n'est pas de nous. Il fut l'explicatif de la radio de Londres pendant la tourmente, et c'est : la suppression du droit d'asile. En quelque contrée du monde civilisé les traîtres, les criminels de guerre puissent se trouver, quel que soit l'endroit de leur gîte ou le lieu de leur tanière, ils devront être délogés. Aucune loi d'aucun pays ne pourra les protéger, et toutes les polices du monde auront l'obligation de prêter leur concours pour qu'ils puissent être arrêtés et livrés à leur pays d'origine. Aucun refuge ne peut être permis aux criminels. En attendant d'être appréhendés, ils seront effigiés et leur capture sera mise à prix. Les peuplée comprendront que dénoncer ces criminels est une question de morale publique. Pourtant, il faudra que l'on sache que ces assassins ont renouvelé des horreurs qu'on pensait ne plus jamais voir, qu'ils ont rempli de crimes et de malheurs la terre qui les avait vus naître et leur entière volonté à les commettre les condamnera irrémédiablement. On saura qu'ils ont mis des hommes au-dessous des animaux les plus vils. On saura que, par eux, il y avait moins de justice et plus de cruautés à Breendonck que dans les abattoirs où la vie des animaux est sacrifiée à l'entretien de la nôtre. Vis-à-vis des criminels de guerre, il faut que la force, l'autorité des cours militaires, les châtiments fassent ce que la dignité, l'honneur et l'amour du sol natal n'ont pu faire. Lorsqu'ils comparaîtront, vous verrez que la mort d'un homme leur tenait pour si peu de chose qu'ils ne s'en souviendront même plus. Mais s'ils ne se souviennent plus de leurs crimes, vous nous les confierez et l'on peut croire qu'ils se souviendront de leurs supplices Après tant de crimes froidement prémédités, nous joignons notre voix à celles des mères, des veuves les orphelins, des frères, sœurs, des parents qui n'abandonneront pas la mémoire et le sang de leurs chers disparus. Des milliers de voix crient qu'il faut punir les criminels de Breendonck. Pour eux, une seule loi, la mosaïque ; une seule peine : celle du talion ! Ils seront, pendant l'instruction, placés dans une enceinte spéciale, sous le contrôle de l'autorité militaire du pays et gardés par des anciens prisonniers de Breendonck. Après leur condamnation, un sursis de vie de trois mois leur sera accordé. Ils bénéficieront d'un régime exactement pareil à celui que nous avons connu : travail nourriture, chicote, bains glacés, etc., etc. A l'expiration des nonante jours, on leur lira un arrêt de mort inspiré par les souvenirs tragiques dont leur âme est pleine, et ils seront pendus !Avant que la trappe ne s'ouvre, on fera l'appel de leurs victimes. A ce moment, ils se sentiront talonnés par quelqu'un au-dedans d'eux-mêmes, plus pressé, plus rapide, plus impatient, et ce quelqu'un sera la mort qui dans son souffle glacé leur dira : Quittez cette terre que vous avez déshonorée, quittez cette race qui vous comptait au nombre des siens et que, publiquement, vous avez abjurée. Avant d'écrire ce qui précède, nous nous sommes interrogé dans la rigidité de notre devoir et c'est notre conscience qui nous a dicté ces pages du châtiment. Que l'on se hâte, nos « anytos » (20) doivent être punis ! |
|||||||||||||||||
|
Chapitre 1 Libération |
|||||||||||||||||
|
Depuis près d'un mois,
Je me rappelle mes camarades de Châtelet se plaignant des accusations portées contre eux par un de leurs concitoyens, tout comme je me souviens d'un Daumeries, celui de Jumet, s'informant discrètement du nom de famille d'un policier de Jumet, Ursmar Cambier, qu'il allait dénoncer comme ayant eu une activité politique communiste, ce qui, cependant, était archifaux ! Van Schelle aussi m'a parlé d'une trahison, mais il me manque un témoignage avant de pouvoir la stigmatiser. Dès la fin de la guerre, je me tiendrai prêt à rappeler aux autorités qui enquêteront à ce sujet, les déclarations de Van Schelle lui-même la veille du jour où il fut fusillé. Un jeudi après-midi, j'étais occupé à charger des pierres lorsqu'une sentinelle vint appeler le n° 329. C'était celui de René Bertiaux, dit « Crolè » (21), de Jolimont. Bertiaux avait des plaies aux pieds et pouvait à peine se tenir debout. Je le chargeai sur mon dos et le conduisis au bureau où se faisaient les interrogatoires. Dès que la porte en fut ouverte et que j'eus installé mon camarade sur une chaise, j'interpellai l'interprète : —
Monsieur, je voudrais savoir si je pourrai bientôt
interrogé. Fouillant ses dossiers, il en sort un à mon nom et me dit : — Sortez et attendez dans le couloir, la figure contre le mur, qu'on vous appelle pour retourner avec Bertiaux. Dès que vous l'aurez ramené au travail, vous reviendrez; et ce sera votre tour. Durant une période de temps qui me parut ne devoir jamais finir, je me tins immobile, l'oreille au guet, attendant. .. Je me demandais ce qu'allait être mon interrogatoire, j'ignorais toujours le motif de mon arrestation ou, plutôt, j'en apercevais plusieurs sans pouvoir définir lequel... Lors de mon arrestation, la perquisition pratiquée à mon domicile n'avait rien permis de découvrir et, sur ce sujet, j'étais tranquille. Quelques jours avant d'être arrêté, je m'étais rendu à Bruxelles, chez J. M..., qui m'avait remis des tracts que j'avais distribués à Charleroi. En octobre 1942, j'avais sectionné les fils téléphoniques d'une ligne allemande installée en bordure du bois à Thuin et adressé des lettres de faire-part aux administrateurs embochés du Borinage, leur annonçant une prompte punition au jour de la libération. Fallait-il me reporter plus avant et voir le motif de mon arrestation dans la conduite que j'avais eue au début de la guerre ? En mai 1940, au
Restaurant du Palais, à Tours, avec l'aide d'une patrouille de soldats
belges, j'avais procédé aux arrestations de trois espions — deux
hommes et une femme — qui, depuis le littoral belge, renseignaient
l'ennemi sur l'activité et les lieux de déplacements des membres de
notre Gouvernement. Leur signalement m'avait été donné par M. D...,
du ministère de
De Tours, je m'étais rendu à Poitiers, et deux jours après encore, suite à un ordre radiodiffusé, je remontaia à Paris et me rendais à la caserne des Tourelles. A M.
Maes, consul de Belgique, je demandai officiellement et en présence de
MM. Dehon et Delvaux, commissaires de police, à pouvoir être embrigadé
comme parachutiste pour les services de
|
|||||||||||||||||
|
Après plusieurs jours d'attente, M. Maes me remerciant de mon offre, m'apprit que la rapidité avec laquelle les événements se déroulaient ne permettait plus la possibilité de mon engagement. Dirigé sur Foix, dans l'Ariège, je fus attaché au service du contre-espionnage français, sous les ordres de M. M..., commissaire spécial de ce département. J'avais aussi été chargé d'exercer une surveillance sur les ouvriers travaillant à creuser sous les montagnes de l'Ariège, à Bédeillac, non loin de Tarascon, où Dewattine préparait l'installation d'une fabrique d'avions, mais l'armistice étant intervenu, je décidai de rentrer en Belgique, car j'avais hâte de savoir si ma femme et mes enfants étaient rentrés au pays. Depuis plus de deux
mois, j'étais sans nouvelles, les ayant fait évacuer dès le 14 mai
1940. Le 29 juillet, à 22 heures, monté sur un triporteur acheté à
Paris, j'arrivais au Borinage. Des voisins m'apprirent qu'on était sans
nouvelles de ma famille. Mme Robert, de
J'avais quitté ma commune le 18 mai, après m'être dépensé sans compter pour les réfugiés de passage dans la commune, ainsi que pour les blessés recueillis, et au lieu d'un mot d'affection qui m'eût largement payé de mes peines, je recevais le coup de pied de l'âne... Bref, à 7 heures du
matin le 29 juillet, je repartais a pied par Frameries, Noirchain,
Bois-Bourdon en direction de Maubeuge. Avant de passer la frontière,
j'adressai ma démission de commissaire de police. Dès ce moment, je ne
m'assignais plus qu'un but : retrouver coûte que coûte ma femme et mes
enfants. J'ai vu Cambrai et la camionnette à l'état de ferraille...
j'ai lu les noms de centaines de personnes sur des croix funéraires
placées le plus souvent en bordure des routes... Le cœur angoissé,
j'ai refait pendant de longs jours le chemin qu'avaient suivi les
réfugiés : Maubeuge, Avesnes,
Que l'on n'aille, pas croire que je veuille dénigrer l'hospitalité française dont j'ai, en d'autres circonstances, éprouvé maintes fois les bienfaits, mais sur cette terre aride d'Auvergne, et à l'époque que je rappelle, ce genre d'accueil était normal. Je ne suis rentré en Belgique qu'au début du mois de novembre 1940, et comme tous mes collègues avaient repris leurs fonctions, j'estimai que je pourrais rendre plus de services en reprenant ma place, et, dans ce but, j'adressai une demande de réintégration disant, ainsi que j'en avais le droit, que ma démission devait être considérée comme nulle et non avenue. Suite à ma lettre, je fus traduit devant une commission administrative siégeant à Mons, dans la salle des délibérations de l'ancien Conseil provincial, mais entendu par des rexistes notoires qui me déclarèrent (un avocat de Tournai et un chef de division de l'ancien Gouvernement provincial), que j'étais un danger pour le nouvel ordre établi et que ma place de commissaire de police ne me serait pas rendue.M. Schmith, Procureur du Roi à Mons, me tint les propos suivants : « S'il n'y avait que moi, vous pourriez reprendre vos fonctions, mais le gouverneur civil y met obstacle. » Entre-temps, la clique
pro-boche de ma commune ne restait pas inactive, et malgré le retrait
de ma lettre de démission fait en novembre 1940, au mois d'avril 1943
le bourgmestre m'informait que ma démission était acceptée et
publiée au Moniteur du même mois. J'ai écrit, disant que je
contestais la légalité de cet arrêté et que je continuerais à me
considérer comme le commissaire de police de
Pour échapper à la haine que m'avaient vouée ceux que les Boches avaient appelés aux fonctions administratives, j'avais quitté le Borinage pour m'installer à Charleroi. La suite, vous la connaissez... Ce sont tous ces événements que je faisais revivre avant mon interrogatoire et je n'avais encore pu me faire aucune idée précise lorsque je fus appelé pour reconduire Bertiaux. Dix minutes après, j'étais de retour et je prenais place en face de l'interprète et de l'instructeur allemands. - Votre nom ? J'ai nié, ajoutant : - Ne pourriez-vous me
confronter avec celui qui m'accuse ? L'interprète
se mit
à parler longuement en
langue allemande avec
l'instructeur. Je sentais qu'il
n'y avait déjà plus de poudre
dans l'air... J'avais conscience de la fragilité de l'accusation, et
pour conserver l'avantage que je venais d'obtenir, j'ajoutai : On me fit signer deux feuilles dactylographiées en allemand, et en me faisant sortir l'interprète — allemand aussi — me remit un petit paquet de cigarettes en disant : - Nous arrêtons, mais nous savons libérer aussi. Demain on vous appellera, ainsi que six autres prisonniers, et vous pourrez rentrer chez vous. Je n'avais plus qu'une nuit à passer dans ce bagne ! Une étrange nervosité s'empara de moi, grandissant avec les heures qui passaient. Je ne pouvais analyser le sentiment qui m'obsédait, et aujourd'hui encore ma période de détention pèse sur moi comme un nuage sombre. Enfin apparut l'aurore
du 24 avril 1943 ! J'étais resté éveillé toute la nuit, mûrissant
des projets, et en tout premier lieu celui d'organiser ma vie en dehors
du toit familial, car je ne voulais plus être arrêté de nouveau et je
sentais qu'il ne pouvait plus y avoir de tranquillité, de bonheur
possible pour l'homme redoutant un retour en cet enfer. Je suis allé au
travail durant toute la matinée, portant de grosses pierres. Nous
formions une chaîne de plus de cent détenus sous la surveillance des
S.S. Les coups tombaient, les hommes aussi... accablés par la fatigue,
la faim et la chaleur d'une chaude matinée. Tout le camp savait que je
serais libre ce jour-là et mes camarades, en silence, me serraient la
main, me considérant avec des nuances différentes d'émotion, mais
sans le moindre signe de jalousie. Ceux de ma chambre m'avaient demandé
d'oser signaler à Beaucoup d'autres m'avaient supplié de faire parvenir des nouvelles à leur famille, j'avais formellement promis de le faire, et en ce jour de libération j'étais content surtout de sentir combien je tenais aux sentiments d'amitié de mes compagnons d'infortune. Après la soupe et au moment où l'on se préparait à sortir pour le travail de l'après-midi, René Bertiaux s'avança vers moi, des larmes plein les yeux en me disant : - Vos indirès rimbrassî m'n'èfant, hein, Victor, ès donner des nouvelles à m'feume... (22). - Va à Mons, tu verras ma femme, mon fils, mais ne leur dis pas comment nous vivons ici... Fais-leur prendre courage, dis aussi que je compte leur revenir pour la fête de juin... - Tu réconforteras les miens, je compte sur toi. - Promets-moi de passer chez mon frère en débarquant à Charleroi. - Va rendre visite à mes vieux parents, à Grand-Manil, car ils ne savent où je suis... D'autres camarades me demandèrent de ne pas les oublier, et j'ai fait pour les uns comme pour les autres, tout ce qui m'était possible de faire. Vint le moment où, après
la visite, je jetai un dernier coup d'œil autour de la cour et là,
transportant des pierres, je vis les faces pâles des prisonniers tournées
vers la sortie du fort pour un dernier regard, un dernier geste d'adieu
vers le groupe des libérés. Nous étions sept qui avions subi une détention
égale et contre lesquels Sur la route de Willebroeck, nous avions l'impression de revenir d'un autre monde dont l'horreur avait laissé en nous des traces ineffaçables. Devant mes yeux passaient les visages de Hoyaux, de Musin, de Glineur, de Wittezaele, de Zavarro, de Bertiaux, de Pesleux, de Mendiaux, de Dubois... de tous mes autres camarades du régime politique. Sur l'écran de ma mémoire revenaient tous les événements sanglants, dramatiques, aussi clairs que des larmes, les prisonniers aux corps squelettiques, les sentinelles, les S.S., la chambre des aveux spontanés..., les murs gris des chambres, des fenêtres à barreaux, les paillasses et leurs poux. J'entendais des plaintes étouffées de souffrances, des cris de haine ou de supplication, l'écho des fusillades... A peine sorti, je sentais déjà que tous ces souvenirs allaient désormais dominer toutes mes pensées... Dans le village de Breendonck que nous traversions, des regards pleins de commisération se posaient sur nous, car il suffisait de nous regarder pour voir d'où nous sortions. Dans un petit café, on nous servit de la bière et on nous apporta du pain... Du pain ? Oui, noir de seigle, sec, mais si bon ! Nous dévorions sans souci pour ceux qui nous regardaient, nous étions affamés. L'autobus nous conduisit de Willebroeck à Malines et en chemin de fer de cette ville à Bruxelles. Durant ce court voyage, sans avoir mangé plus que mes compagnons, j'avais cependant avalé deux pains de trois livres chacun ! Je ne parvenais pas à me remplir, il me semblait que ma faim ne pourrait plus jamais s'apaiser et les autres étaient comme moi. Au poste de Croix-Rouge
de la gare du Midi, à Bruxelles, les infirmières pansèrent nos
plaies. Nous eûmes du café chaud et des tartines de margarine. Des
places assises nous furent réservées dans le train partant pour
Charleroi, et avec une sollicitude touchante, avec un dévouement que
connaissent ceux qui furent emprisonnés, les membres de
Aussitôt débarqué,
je me rendis chez Marcel Jeuniaux, le frère de Camille, qui exploite le
« Café du Prince Charles ». Je tenais ma première promesse. Là
aussi on m'invita et l'on me fit manger trois grosses tartines et
quelques tranches de lard. Il était 22 heures et déjà j'avais
enfreint les recommandations de
A 22 h. 30, je téléphonais à ma femme, mes gosses, leur annonçant une brève visite pour le lendemain... Ma femme comprenait que je ne pouvais rentrer à la maison. Secouant ma lassitude, je me rendis au domicile d'une personne amie qui m'hébergea. On me fit prendre un bain et l'on me donna du linge de rechange. On me servit deux assiettes de gruau d'avoine, et, enfin, je pus m'étendre dans un bon lit. Le lendemain matin, à 8 heures, j'arrivais à proximité de mon domicile. Mes enfants guettaient sur le seuil de la porte, et dès que je leur eus fait signe — car ma détention m'avait rendu méconnaissable — mes petites filles accoururent à ma rencontre. Comme on était heureux de se retrouver ! Mes gosses pleuraient d'émotion, de joie, et les changements survenus dans ma personne étaient tels que les voisins eux-mêmes essuyaient leurs larmes en disant : « Comme ils (les Boches) l'ont arrangé ! » Le même jour, j'appris
que le docteur Magonette, de Charleroi, occupait un poste dans le comité
de Voici notre entretien : - Je vous
trouve dans un état
de maigreur considérable. D'où sortez-vous ? Le docteur m'examina, me remit un certificat de ses constatations et refusa que je lui verse ses honoraires. Je rapporte sincèrement mon entretien avec un médecin que l'on m'avait signalé comme ayant des sympathies pour les milieux rexistes ou pro-allemands. Peu de temps après, j'appris par un nouveau libéré que le régime alimentaire venait d'être amélioré, qu'il n'y avait plus que quatre heures de travail par jour et qu'on avait supprimé les chicotes. Mon intervention y a-t-elle été pour quelque chose ? Je voudrais l'espérer. Je ne pouvais sans danger continuer à rester dans Charleroi, où ma présence éveillait les curiosités et offrait un sujet de conversations dangereuses pour moi. C'est à ce moment qu'un camarade carolorégien, Raoul Ranwez, proposa de me cacher dans un pavillon de chasse situé dans les bois de Chimay. J'ai accepté avec empressement, car j'avais besoin de repos et j'étais pressé de commencer mon reportage. Je ne dirai jamais assez à Ranwez, Mol, Hanotaux (autres locataires), combien je leur suis reconnaissant de m'avoir donné cet abri sûr pendant les mois qui suivirent. Un étang poissonneux entourait le pavillon ; j'étais seul à y pêcher sous l'œil bienveillant du brave papa Bossart, le garde, qui veillait sur ma sécurité comme si j'eusse été son propre fils. Dans cette région pittoresque entre toutes, j'ai trouvé le repos qui m'était indispensable et les soins que réclamait ma santé délabrée. Chimay et sa région étant fouillés sans cesse par des patrouilles de la feldgendarmerie, je suis revenu à Charleroi, estimant qu'il est plus facile de passer inaperçu dans une grosse agglomération. Je reste enfermé dans un appartement, ne sortant que pour me ravitailler ou pour voir ma famille. C'est un jeu dangereux auquel, cependant, je ne puis me soustraire. Chaque jour, je note mes impressions. Le soir, mes copies sont cachées en vue d'une arrestation toujours possible. Les 12 octobre, 22
novembre, 16 décembre 1943 et les 3 janvier et 21 février 1944,
Mes gamines furent arrachées de leur lit par les policiers, qui, dès que la porte leur était ouverte, se partageaient pour me rechercher à la fois à l'étage et au rez-de-chaussée. Les petites eurent des éruptions de boutons provoquées par la peur, mon épouse contracta une affection cardiaque. Quant à mon fils, qui venait d'atteindre sa dix-septième année, je l'avais mis en sécurité chez mes beaux-parents. Le plus dur est passé. Mes tortures morales et physiques, cette prison de cauchemar, les souffrances d'une existence de brute à Breendonck, l'infini du désespoir... Cela, c'est le passé maintenant.Aujourd'hui que la victoire se dessine et que les possibilités d'un débarquement s'avèrent de plus en plus certaines, je me sens gonflé à bloc. De ma fenêtre, je vois passer des escadrilles alliées, les sirènes ne cessent de mugir, les Boches se rendent aux abris en rasant les murs, tandis que la population, nez en l'air, reste pétrifiée devant un déploiement aussi considérable des forces du ciel... Chaque jour le réseau ferroviaire est attaqué par les flottes aériennes. Les gares de triage, de formation, les embranchements de lignes, les ponts, les dépôts de machines et de carburant, les terrains d'aviation sont soumis à un bombardement massif. Ce mardi 11 avril 1943 fut une journée de deuil pour le pays de Charleroi. Déjà, hier, des escadrilles de bombardiers américains avaient survolé la région, prenant pour objectif la gare de Couillet-Formation, qui commande les lignes ferrées en direction de l'Allemagne. Quelques bombes ont bien été lâchées' dans la soirée du 10, mais les résultats ne peuvent être considérés comme définitifs. «Ils reviendront... », c'est ce que nous entendons répéter. Ce matin, à 10 h. 45,
les sirènes mugissent et déjà l'on assiste aux
manœuvres aériennes des
chasseurs qui, à plusieurs milliers de mètres d'altitude, commencent
leur, travail de repérage. Ils laissent derrière eux des lignes de fumée
blanche, et eux l'immense tableau du ciel, comme avec
une craie, ils tracent de larges arabesques qui forment bientôt un
encadrement au-dessus du bas Montigny, que l'on appelle
Montigny-sur-Sambre. A ce moment, je me trouve sur la place de Montigny-Neuville. La population est angoissée ; je circule parmi les groupes qui stationnent, nez en l'air... Je rappelle à mes amis montagnards que la veille, à Marchiennes, les quartiers de St-Martin et de « Matadi » furent bombardés après les évolutions indicatives des chasseurs. Comme pour confirmer mes déclarations, l'on voit arriver de fortes escadrilles de bombardiers. Cinquante, soixante appareils. Ils paraissent venir de directions différentes, mais tous convergent vers un même point, et bientôt, dans un roulement de tonnerre, les bombes éclatent. Quels bruits épouvantables, quel vacarme d'enfer ce bombardement produisait, et quelles horribles et hallucinantes visions de mort cet écroulement de fer faisait naître dans notre esprit ! Cinq vagues de bombardiers répétèrent l'exercice de destruction et de mort, car, malheureusement, il y eut plus de cent victimes parmi la population. |
|||||||||||||||||
|
D'énormes colonnes de flammes, de fumée, de poussière montaient vers le ciel comme une vaste draperie aux plis lourds, faite de noir et de pourpre, noire de deuil et rouge de sang ! Sitôt la fin de
l'alerte, je suis descendu vers Montigny-sur-Sambre, et trente minutes
après le bombardement, je me trouvais en face de l'hôpital
Sainte-Thérèse. Transportés par des sauveteurs bénévoles, les
blessés arrivaient déjà, de tous sexes, de tous âges, figures
horrifiées par ce
qu'ils avaient vu,
membres déchiquetés, sanglants. Les secours s'organisaient, des
camions de D. A. P. amenaient les équipes de sauveteurs, et, au risque
d'être arrêté par une patrouille allemande, je me dirigeai vers
- C'est tout ce qui me reste... Je travaillais aux usines de Sambre-et-Moselle ; ma femme, ma fille et mon fils, qui prévoyaient le bombardement, s'étaient dirigés vers l'usine pour venir me reprendre... Les avions sont venus, nous avons à peine eu le temps d'être ensemble que les bombes tombaient, et ma femme, ma fille ont été tuées ! Les rues Solvay, du Marais, de l'Eglise ne nous montrent que des toitures ravagées, des murs amputes, des amoncellements de briques, mais plus une seule maison entière. Plus loin, vers
Il est hors de doute que les objectifs visés ont été atteints ; on peut dire que leur destruction est complète. Quel dommage qu'il y ait eu tant de victimes, tant de malheureux dont l'âme vibrait de joie pourtant à chaque évocation des succès des armées alliées ! Ils ne seront plus là pour assister à la fuite des Boches et leur situation matérielle n'a pu leur permettre de chercher, dans un rayon mieux éloigné des objectifs, un lieu d'habitation offrant plus de sécurité.Demain, la presse servile dira que ce bombardement fut uniquement dirigé contre la population, et le Journal de Charleroi, sous la plume des Spilette, Fesler, Mariani. qualifiera les aviateurs anglo-américains de « cow-boys » et d' « assassins »... Certes, il faut déplorer ces massacres et nous pleurons bien plus que ces journalistes pro-boches la mort de nos concitoyens, car nous savons, les Belges savent que parmi les flottes aériennes alliées se trouvent des aviateurs français, belges et que même s'il n'y en avait pas eu, les autres n'auraient pu penser à tuer volontairement les hommes, femmes et enfants de notre pays. De l'horizontale ayant
dans sa ligne la gare et les usines susmentionnées jusqu'à la limite
extrême des maisons détruites, place de Montigny-sur-Sambre, sur la
gauche de cette ligne, on peut évaluer la distance maximum à 300 mètres
(vol d'oiseau). Peut-on, de bonne foi, prétendre que ce bombardement était
dirigé contre la population civile ? Seuls pensent ainsi ceux qu'on
appelle les collaborateurs, et ce sont les mêmes qui, en mai 1940,
excusaient de véritables raids terroristes, ceux que les Allemands
dirigeaient contre des populations affolées sur les routes de l'exode.
Y avait-il des objectifs militaires ou des unités combattantes dans les
campagnes de Taisez-vous, Spilette,
Steurs, Fesler, Gaillard, Vassart, Mariani, la grosse Nell... et
autres... vous n'avez pas le droit de parler de ceux dont nous pleurons
la perte. Les patriotes savent qu'hypocritement vous vous réjouissez
sur ces cadavres dont vous allez vous emparer pour les besoins d'une
propagande à Vos amis les Boches étaient venus sur les lieux après le bombardement, et près de la maison communale stationnait une de leurs voitures ; près de celle-ci, un officier passait et repassait, erratique, indifférent à tout ce qu'on pouvait voir. Que lui importaient ces civils que l'on transportait sans vie dans la salle des mariages de l'hôtel-de-ville ? Il n'en était pas plus touché que vous ne pouviez l'être ; il lui manquait comme à vous autres le sens des plus nobles valeurs humaines. Nous ne pouvons même pas espérer qu'il n'y aura plus d'autres bombardements, car bien que la guerre soit entrée dans une phase décisive, elle ne pourra se terminer que par de nouveaux harcèlements qui n'iront pas, ô malheur ! sans nouvelles victimes. Les hommes devront-ils toujours s'entretuer ? Le génie humain ne peut-il se traduire dans des œuvres de vie plutôt que de s'affirmer dans des œuvres de mort ? Ne verrons-nous pas un jour dans les écoles de tous les pays les photographies exécrées de ceux qui déclenchèrent les guerres avec, au bas, cette adresse : Ils ne furent grands que par leurs crimes ! Cela ne vaudrait-il pas mieux que de passionner les foules avec un Landru, un vampire de Dusseldorf ou autre Petiot ? Il est temps d'en finir, car après cette guerre il n'y aura plus de gouvernement possible dans aucun pays si l'on continue à laisser augurer la perspective d'une « prochaine ». Des primes à la natalité offrait-on, et aujourd'hui, après avoir à peine eu le temps de vivre pour soi, il faut mourir pour d'autres ! J'aime ma patrie et suis prêt dans cette guerre qu'elle n'a pas voulue, à lui sacrifier ma vie, mais mon patriotisme n'est pas belliqueux, il est fait seulement de l'amour que je porte à la terre qui m'a vu naître, aux clochers, usines, aux choses de chez moi auprès desquelles j'aime vivre, et c'est cette forme du patriotisme qui me nourrit dans mes idées de résistance aux Boches pillards et sanguinaires. S'ils s'installaient chez nous, comme tout changerait, et jusqu'à l'esthétique de nos sites, qui deviendrait la leur... Plus rien de ce que nos vieux admirèrent ne pourrait s'offrir à nos regards... Notre « beau » deviendrait leur « schoen » et ce ne serait plus beau ! Les vainqueurs de demain — nos alliés — feront bien de penser à cette force d'attachement à la glèbe des peuples européens ; ils veilleront à leur rendre leurs institutions, leurs libertés, et, pour ce faire, ils penseront que des centaines de milliers de Français, d' Hollandais, de Polonais, de Serbes, de Grecs, de Tchèques, de Belges furent tués pour défendre ces institutions et ces libertés. Une victoire même éclatante serait vaine si l'intelligence n'assumait pas la mission d'en préparer et d'en recueillir les fruits. Les peuples démocratiques ne pourront jamais se faire à un régime totalitaire et ceux-là même qui durent supporter l'idéologie nazie aspirent à en sortir. Si vingt siècles de civilisation ne peuvent faire de l'homme un « homme », et si l'on ne parvient, dans l'avenir, à brider les appétits morbides et cruels des Hitler et Mussolini, plutôt que d'assister à la destruction complète du genre humain, on verra se dresser les partisans d'une nouvelle théorie : celle du suicide collectif ! |
|||||||||||||||||
|
Chapitre 2 |
|||||||||||||||||
|
Nous sommes au mois de mai 1944. Des milliers d'hommes battent les bois, les campagnes en vue de se soustraire aux arrestations des Boches. Ceux-ci traversent les agglomérations en camions automobiles et ramassent tous ceux qui ne sont pas munis des pièces prouvant qu'ils sont occupés dans les usines. Des rafles sont opérées dans les théâtres, cinémas, cafés, aux arrêts des tramways, dans les gares, les trains, sur la rue. On rassemble dans les prisons, les casernes, les hommes arrêtés et il ne se passe pas une semaine que des trains entiers ne quittent le pays en direction de l'Allemagne, emportant leur chargement humain. On est traqué par
Et ces gredins
faussement qualifiés de défenseurs de l'Europe, que sont-ils ? Des ratés,
de livides crétins, des Nous vivons sous le règne de la vengeance, des dénonciations et des lettres anonymes, mais patience, ceux qui doivent payer paieront. Il y a du sang sur la porte, comme on dit en Corse, et nous allons entrer dans l'ère des châtiments. En écrivant ces lignes, je pense qu'il y a deux années déjà que j'ai dû quitter mon foyer. Cependant, je me considère comme exceptionnellement favorisé... J'ai pu sortir de Breendonck, de ce camp de toutes les destructions. J'ai pu échapper aux cercles sataniques de ce bagne et mon état moral n'en est pas affaibli. Quant à mon état physique, je sais que si la chance m'est donnée de pouvoir écrire ces pages, je les paie du prix de ma santé La vengeance est le seul rayon consolateur tombant dans ma solitude. Je suis « un » parmi des milliers d'autres patriotes ; ni moins, ni plus intéressant... jouant ma tête à ma façon comme d'autres jouent la leur, avec l'espoir que la résistance des Belges aura contribué à la délivrance finale. Des arrestations, des fusillades, de l'horreur des crimes commis, de cette guerre, enfin, devra naître un monde meilleur, un monde de plus en plus riche d'amour et d'humanité, de justice et de bonté. Nous ignorons quel sera demain le statut des différents pays, mais nous voulons croire qu'après les tueries, les massacres collectifs de ces terribles années, il se formera, dans chaque Etat, une majorité qui saura imposer la paix. Les peuples ne devront plus admettre que des aventuriers puissent provoquer des conflits idéologiques, les plus destructeurs, les plus vains. Faites le compte des victimes de l'idéologie nazie... des millions de victimes embarquées dans une aventure sans issue... des millions d'autres abrutis par les idées baroques d'un demi-fou, Hitler, qui prétend — ô farce lugubre ! — qu'il va changer la face du monde, bâtir l'Europe moderne et libérer le genre humain. Nous sommes déjà à bonne distance pour juger de son beau travail... Il a pillé, saccagé tous les pays européens, il a déporté des millions d'hommes, il en a fait emprisonner et tuer des centaines de milliers d'autres ! Et tout cela, au nom de «l'ordre nouveau » ! Nous avons des traîtres chez nous, reconnaissons-le, mais l'immense majorité des Belges tient ferme, sa foi reste intacte, elle sait ! Tous les Belges savent ce que l'ordre nouveau peut leur amener. Pour les ouvriers et fonctionnaires, suppression radicale des syndicats ; un « front du travail » de carnaval pour les remplacer, et, à la direction, un nazi qui en choisirait tous les chefs et réglerait souverainement tout ce qui concerne les salaires, le chômage, l'ap prentissage, les conflits professionnels. Pour les agriculteurs, on soustraira à la loi du partage le champ héréditaire. Les domaines seront indivisibles et incessibles et passeront à un seul des enfants du propriétaire, au choix de celui-ci. Les industriels sauront que le crédit dépend de l'Etat, et pour en obtenir, l'entreprise devra être nationale-socialiste, bien entendu. Nous aurons, en plus, du caoutchouc artificiel, de la soie artificielle, de la laine de bois et serons admis à faire partie de l'Empire de l'Ersatz. Hitler ajoutera : « Vous avez la liberté de penser comme moi, sinon gare à vous ! » Enfin, pour que tout
puisse tourner en rond, nous aurons les types de
Eh bien ! non, les Belges ne participeront à aucun repêchage. Ils souffriront davantage s'il le faut car ils gardent de l'espoir en l'avenir. Ils retrouveront leurs libertés, tandis que pour avoir attaqué, dissocié, détruit la personne humaine, les régimes totalitaires s'écrouleront, car il n'est aucun peuple digne de ce nom qui puisse admettre l'esclavage de l'intelligence. |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
3 |
|||||||||||||||||
| Au
mois de mai 1940, j'avais reçu l'ordre d'arrêter les ressortissants
allemands qui se trouveraient sur le terri- , toire de ma commune. J'ai
procédé à l'arrestation de la famille Schallès (mère, fils et
fille) que j'ai conduite à la. prison de Mons, où elle fut écrouée.
Dans la rue de
Ceux qui savent de
quelles atrocités les hommes de
|
|||||||||||||||||
|
Chapitre
4 |
|||||||||||||||||
|
La radio d'abord, les journaux ensuite, nous apprennent qu'un attentat vient d'être perpétré contre Hitler. Celui-ci porte des blessures légères, tandis que plusieurs membres de son état-major sont tués ou grièvement atteints. Quelles qu'elles soient, les nouvelles sont suffisantes pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui craque dans le régime et qu'une forte opposition, tant militaire que politique, vient de se manifester en Allemagne. De tous nos espoirs nous appelons le jour de la débâcle, de la culbute finale, du dernier assaut, et nous espérons en être, pour aider dans la mesure de tous nos moyens ceux qui viendront nous libérer. Dès que le défaitisme allemand se manifestera chez nous, nous sortirons pour l'encourager en conseillant par ici, en insinuant par là, en tuant s'il le faut pour hâter la faillite de l'hitlérisme et l'anéantissement des suppôts de son régime. Bientôt nous passerons à l'attaque avec la résolution de culbuter les bandes nazies que l'on suppose dures à mourir, mais dont les patriotes viendront cependant à bout. Les jours passent, la bataille de Normandie bat son plein. Les F.F.I. libèrent villes après villes, et bientôt, nous le sentons, ce sera notre tour ! Charleroi libéré ! Enfin, la délivrance approche ; Tournai vient d'être libéré et les armées alliées avancent en direction de Mons. Etant caché à Landelies, j'en repars le 3 septembre 1944, à 7 heures du matin, et par la route, car les tramways ne circulent plus, je me hâte de rejoindre Charleroi. Tout au long du parcours, on peut voir des groupes de S.S. transportés sur des voitures blindées qui se rapprochent des ponts. Ceux-ci sont minés et les Boches se préparent à les faire sauter, croyant pouvoir ainsi assurer la retraite des colonnes allemandes en direction de l'Est. C'est un dimanche, de rares personnes circulent et l'on a la nette impression que des événements graves vont se dérouler. J'arrive à Charleroi, il est 9 heures du matin, et je me dirige vers les habitations de l'Avenue Général Michel. Les Allemands procèdent au chargement des blessés qui se trouvent installés dans un bâtiment du Boulevard Zoé Drion. Plus de quarante camions de Croix-Rouge attendent, et, pendant ce temps, des S.S. défendent à la mitraillette l'accès des voies qui conduisent à cet établissement. Sur le coin de la plaine des manœuvres, un tank est installé. Par contre, on apprend que les services administratifs et policiers allemands ont quitté la ville. Il reste cependant dans celle-ci un groupe de blindés et de chars de combat qui doivent, en dernière minute, assurer la fuite des équipes chargées de faire sauter les ponts.Il est treize heures
lorsque les derniers véhicules de Croix-Rouge descendent la ville en
direction de Marcinelle, et au même moment, nous pouvons voir deux S.S.
répandre de l'essence sur le tank installé sur la plaine, préparer un
cordon d'allumage, y mettre le feu, et, quelques secondes après, dans
un bruit formidable de détonations, l'engin explose avec tous ses
coffres de balles et d'obus. Les deux Boches s'enfuient par la rue de
En quelques minutes, nous sommes sur la rue, en face de la caserne des Chasseurs. Une voiture allemande vient dans notre direction, et lorsqu'elle n'est plus qu'à une vingtaine de mètres de nous, le feu est ouvert. L'un des Allemands installé sur le siège avant s'affaisse, mais le conducteur parvient à tourner le véhicule et à redescendre la rue à une vitesse folle, toujours poursuivi par nos balles. Peu de temps après, nous tirons sur deux soldats motocyclistes, mais on nous signale qu'un blindé comprenant sept S.S. armés de mitraillettes, se trouve installé pour le tir dans la rue des Bouchers. Avec S..., de Montigny-sur-Sambre et trois autres camarades, nous nous rendons à cet endroit et ouvrons le feu avec nos fusils sur les Boches qui se défendent à la mitraillette. L'un d'eux, touché à la poitrine, tombe, mais la lutte est trop inégale. Ils sont protégés par leur véhicule, tandis que nous devons plus ou moins nous découvrir pour tirer et nous sommes à moins de vingt mètres les uns des autres. Venant du bas de la ville, nous percevons nettement le crépitement des mitraillettes. Trois S.S. s'efforcent de dégager le carrefour des Jésuites tenu par plusieurs camarades faisant le coup de feu et visant particulièrement les soldats installés au pont de Marcinelle. Une décision immédiate s'impose, car nous allons être tournés. S..., et deux autres entrent dans l'abattoir de Charleroi et parviennent à lancer une grenade à l'endroit où se trouvent les Boches du blindé. L'engin explose en touchant la tête de l'un d'eux ; un de moins encore, il est complètement décapité, un autre est mortellement blessé. Quittant leur véhicule, les Allemands se retirent, abandonnant la lutte. C'est à ce moment précis que je vois mes camarades du carrefour se replier vers la rue de Montigny. L'un d'eux tombe, frappé à mort. _ _ _ _ _ _ Trois S.S. passent le coin de la rue de Montigny prolongée ; ils se trouvent à hauteur de la porte particulière du Café de l'Horloge. Je tire et un Boche s'écroule face contre terre. Un tir en rafales est dirigé contre nous et nous évitons la mort de justesse en nous abritant sous le porche du café « Boulot ». Les mitraillettes s'étant tues, nous regardons, mais les Fridolins ont disparu et nous ne sommes plus que trois partisans dans la rue. Nous devons avoir été les premiers à faire le coup de feu dans la ville, mais bientôt des armes sortent de la caserne d'artillerie, et, vers 15 heures, on entend des coups de feu crépiter de partout. Sur les indications de quelques braves citoyens de la rue de Montigny, nous pénétrons dans une maison située près de la place de Bosquetville. A l'intérieur, et suant de peur, nous y trouvons un Boche revêtu d'un vêtement civil et un Belge... le propriétaire de la boîte dans laquelle vient de s'opérer la transformation. Au moment de notre arrivée et pour se remonter sans doute, tous deux sont attablés devant une bouteille de cognac.Nous les mettons en état
d'arrestation et les conduisons à la rue des Trieux, à
Montigny-sur-Sambre, où siège un groupe de
Au moment où nous montons la rue d'Assaut, un monsieur inconnu demande à nous photographier. Nous accédons à son désir, ce qui nous permet aujourd'hui, l'amateur s'étant fait connaître, de reproduire cette photo. Jusqu'à 21 heures ce jour-là, sur la plaine des manœuvres, au Parc, au boulevard Zoé Drion et à la gare de Charleroi-Nord, nous aiderons à bouter l'ennemi dehors. Hélas !, nombreux furent les patriotes qui trouvèrent la mort dans ces combats de rue. Je pense avec émotion à mon ami Georges Carpet, de Charleroi, je pense à ceux que j'ai vus tomber près de moi, à tous ceux qui ont payé d'un sang généreux la libération de notre bonne et belle ville de Charleroi. _ _ _ _ _ _ _ Les troupes américaines firent leur entrée dans la ville le 4 septembre 1944, vers 18 heures, au milieu d'une foule débordant de joie. Les drapeaux des nations alliées flottent partout, des milliers de mouchoirs s'agitent, des mains se tendent vers celles des libérateurs, on pleure de joie, d'émotion, c'est la fin d'un horrible drame, nous sommes libérés ! _ _ _ _ _ _ _ Le 6 septembre 1944, à 11 heures du matin, je me hisse sur un camion américain
qui roule en direction de Mons. En arrivant dans cette ville, je me présente
à M. Schmit, Procureur du Roi, qui fut aussi emprisonné par les
Boches. Je prends ensuite la direction du Borinage, et lorsque j'arrive
à Point de pitié pour les traîtres : justice ! Daumeries !Le 12 septembre 1944, j'ai pu quitter ma commune pour rentrer à Charleroi. J'y suis arrivé dans une camionnette, armé d'une mitraillette boche et avec un but précis : me saisir de Daumeries. Il venait d'être arrêté, j'arrivais trop tard ! Qu'importe, je me retrouverai face à face avec lui devant ses juges. Ils m'entendront leur rappeler la conduite infâme de la loque qu'ils auront devant eux, car nous gageons toujours que Daumeries sera aussi lâche devant ses juges qu'il l'était devant les S.S. de Breendonck. Les hommes de la chambre 3 viendront témoigner. Ceux qui sont encore prisonniers ne pourront venir. Et ne viendront pas non plus : Désiré MOUFFE et Roger POQUETTE dont la mise à mort pèse sur la conscience du boucher de Jumet. |
|||||||||||||||||
|
Chapitre
5 |
|||||||||||||||||
| Le
jeudi 21 septembre 1944, mes camarades de Binche, anciens prisonniers de
Breendonck, sont rentrés au bagne, mais cette fois' ils étaient
libres.
Etant l'un des responsables du travail d'épuration de ma commune, je n'ai pu être des leurs, mais en pensée j'étais avec eux. Je les ai vus à leur retour du bagne, je voulais connaître leurs impressions. Voici ce qu'ils m'ont dit : Le bagne de Breendonck est à présent sous la garde des milices patriotiques. C'est le comte de Mister qui en assume la direction. Parmi les trois cents prisonniers qui actuellement se trouvent au camp, on retrouve le sinistre Van Praet, le S.S. Van Hull et le fermier qui s'occupait, sous le régime boche, d'entretenir le bétail des nazis. De Weiss et de De Bodt, aucune nouvelle... C'est avec une émotion que nos lecteurs comprendront que Breendonck fut visité par ses anciens pensionnaires... Ils ont pensé à ces jours d'atroces épreuves pendant lesquelles le régime hitlérien semblait vouloir les écraser de sa masse formidable. Il ne leur a pas été permis de prendre des photographies intérieures du camp. |
|||||||||||||||||
|
Discours prononcé par Pierre Lansvreugt, (In het Nederlands) Président
de l' «
Association Nationale des Rescapés de Breendonck », C'est avec une émotion profonde — émotion que ressentent les rescapés qui m'entourent — que je me retrouve aujourd'hui dans ce lieu sinistre, dans ce lieu sacré. Breendonck, lieu sacré ! Car c'est ici que tant des nôtres ont été martyrisés lâchement, c'est ici qu'ils sont morts, le cœur ferme et la tête haute, nous laissant une grande et inoubliable leçon. L'Histoire rapporte
que, lors des guerres de religion dans le Midi de
Leurs dernières pensées,
à ces martyrs, furent pour leurs parents, pour leurs épouses, pour
leurs fiancées, pour leurs amis, pour
Bientôt, on connaîtra
leurs noms, on saura quelles furent leurs douleurs, quelle fut leur foi.
On saura que c'est de leur sang que doit renaître une Belgique
nouvelle, libre, grande, belle, une Belgique dont tous les citoyens
s'uniront afin qu'elle prenne le rang qui lui revient parmi les nations
civilisées, dans la paix, la justice et le travail. On connaîtra leurs
noms. On les gravera dans le marbre où l'on écrira : « ils ont
bien mérité de On connaîtra aussi les noms des infâmes bourreaux. S'il est une justice sur la terre, ils seront châtiés comme ils le méritent. Mes chers compatriotes, je n'ai pas l'intention de vous décrire le camp de Breendonck, lieu sinistre, ni de vous en dévoiler les horreurs. Pour en avoir écouté quelque écho, il n'est personne qui ne sente les larmes lui venir aux yeux, larmes de pitié, larmes de colère. Et moi-même, aujourd'hui où je puis parler librement, je frémis jusqu'en mon âme au souvenir de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons enduré. La douleur et les râles rôdent encore ici comme des fantômes. Il faudrait la voix d'un Dostojevski pour évoquer cette nouvelle « Maison des Morts ». On le fera plus tard. Qu'il me suffise de dire que la fureur et la bestialité des tortionnaires ont dépassé en ignominie, en cruauté, en sadisme, tout ce que l'on peut imaginer. Faut-il vous dire notre misère, la faim perpétuelle, la fatigue, le néant de toute hygiène, le travail exténuant par tous les temps ; puis les coups, les injures et les tortures les plus abominables. Ce fut l'enfer ! L'enfer de Breendonck ! C'est que, outre les tortures physiques, nos âmes et nos cœurs se sentaient parfois envahis de détresse. Toutes les valeurs morales, la justice, la bonté, la pitié, avaient disparu pour faire place à 1a terreur de jour, à 1a terreur de nuit, sans répit, sans miséricorde. L'espoir, cette source suprême des plus misérables, je vous avoue qu'à certaines heures il faillit nous manquer. Abandonnés de Dieu et des hommes, nous semblait-il, on nous privait des consolations spirituelles. Il ne nous restait que la petite prière chacun dans son coin, le spiritisme, l'appel aux réussites des jeux de cartes, les coups de la table tournante. Abandonnés des hommes. Nulle voix de l'extérieur ne parvenait jusqu'à nous, nul signe ne venait nous réconforter, nous n'avions pas la consolation d'une lettre de chez nous, d'un colis de vivres, gage d'une affection qui veille. Eh bien ! si, dans ces moments-là, nous n'avons pas sombré dans l'accablante réalité, si, à l'entrée de notre enfer il eût été malséant d'inscrire la parole de Dante : « Vous qui entrez ici, laissez toute espérance », nous le devons à l'exemple, au courage, à la foi, au patriotisme, à la haute dignité de ceux qui allaient mourir. Qu'ils en soient glorifiés ! Mes chers compatriotes, ce lieu est plus sinistre que jamais. Sans doute on n'y entend plus de cris d'agonie, le sang n'y coule plus. Mais on y a enfermé les traîtres et des dénonciateurs. Pendant l'occupation ennemie, Breendonck fut un camp de martyrs ; aujourd'hui, c'est un camp de scélérats.
Vive
|
|||||||||||||||||
|
Chapitre
6 |
|||||||||||||||||
|
Le 25 octobre 1944, je me suis rendu au Tir National à Bruxelles. L'enclos réservé aux fusillés — ils sont si nombreux ! — présente l'aspect d'un vrai cimetière. Dans la première pelouse reposent 261 fusillés de la guerre de 1940 dont les noms nous sont connus. Dans la seconde, 81 fusillés dont les noms ne sont pas encore connus. Sur les tombes, des mères, des épouses, des enfants, des frères et sœurs, des parents, des amis sont venus déposer des fleurs en un dernier hommage d'affection aux chers disparus. C'est avec un sentiment d'indicible tristesse que je suis entré au Tir... J'en ai suivi les allées ombragées par les arbres qui les bordent... Ensuite, ce fut la prairie, les croix ! Sur celles-ci, j'ai retrouvé les noms d'amis qui m'étaient chers, de camarades avec lesquels j'étais à Breendonck. Des souvenirs tragiques me furent brutalement rappelés: BROECKAERT
Armand, habitant à Jette (Bruxelles),
tombe 12, rangée II, et comme
à l'aube
du 16 mars 1943, à 7
heures du matin, je revoyais ce grand garçon avec lequel j'avais
travaillé aux bennes, foulant le sable du bagne avec, à son côté, un
Boche qui l'escortait vers les poteaux d'exécution... Armand était
grand, près de EVERAERT Louis, habitant à Laeken, 36, rue Mellery, tombe 8, rangée II. Dans la file des suppliciés du 15 mars 1943, il venait le dernier. Aveugle et toujours porteur de lunettes noires, il était guidé, dans la direction des camarades qui le précédaient dans cette ultime étape, par un Boche. Louis avait une cigarette aux lèvres... Il suivait le chemin le conduisant à la mort avec un stoïcisme admirable. D'autres que moi le suivaient des yeux ; ils peuvent aussi affirmer que sa cigarette ne tremblait pas I FALISE Nestor, habitant a Courcelles, tombe 14, rangée II. Lui aussi s'en allait à la même date, mais je ne l'ai pas connu et regrette de ne pouvoir apporter à tous ceux qui le pleurent les quelques paroles de consolation qu'ils attendent. J'ai dit dans la dédicace de mon livre qu'ils étaient tous beaux le jour de l'exécution ; je ne puis que le répéter. HERTOGHE Jean, habitant Anvers, tombe 13, rangée II. Est arrivé le 12 avec Falise et fut également fusillé le 15. Il put, avant sa mort, s'entretenir avec le vicaire de Courcelles, car lui aussi avait été installé dans la chambre 11. La photographie de Jean Hertoghe nous est remise par Madame Veuve Hertoghe. Nous lisons au bas du document photographique cette touchante dédicace : "Mon cher petit Papa. — Jour pour jour un an avant sa mort, le 15 mars 191,2, et fusillé par les Allemands le 15 mars 1943." Les Boches ne respectaient pas à Breendonck les sentiments religieux des hommes qui allaient mourir. Le vicaire de Courcelles, à qui on avait interdit de dire la messe, apportait cependant à ses compagnons de chaîne qui allaient au poteau tout le secours de son ministère, tout le réconfort moral de sa foi ardente et sublime. LOWENWIRTH Michel, né à Berechovo le 9 avril 1922, tombe 11, rangée II. Du 16 mars 1944, mais je n'ai pu le connaître. Son domicile en Belgique est inconnu. J'espère que sa famille apprendra un jour que l'être aimé que certainement elle recherche repose en cette pelouse arrosée du sang de tant de martyrs. MOHRFELD Frédéric, habitant & Jette (Bruxelles), tombe II, rangée II ; est tombé courageusement sous les balles après avoir, durant sa captivité, pu révéler ses qualités de brave à tous ceux qui le côtoyèrent au travail. STORCK Jacques, habitant à Bruxelles, tombe 7, rangée I. Lui aussi s'en alla en cette matinée de drame en sachant bien que le prochain jour ne se lèverait plus pour lui... L'enthousiasme ardent qu'il vouait aux choses de sa patrie l'a réchauffé dans cette suprême étape. VANROME Alphonse, habitant à Carnières, chaussée Brunehault, 66. Tombe 15, rangée II. Est arrivé à Breendonck avec Hertoghe et Falise. Son image aussi restera fixée dans une vérité terrible, par le souvenir de ses souffrances. VAN SCHELLE Martial, habitant à Bruxelles. Tombe 10, rangée II. Il laisse une réputation de grand sportif. Aéronaute, champion olympique de natation. Je pense chaque jour à mon ami Martial ; je pense à toute la tendresse inassouvie qui pleurait dans son cœur. La mort de tous ces camarades, la mort de tous ceux que nous avons connus, n'ajoute rien à notre affection, à notre dévouement pour eux ; mais elle grandit notre admiration à la hauteur de leur sacrifice. _ _ _ _ _ _ _ prononcé à Charleroi, le 30
novembre 1944, Emile, Tes camarades de Breendonck sont ici... Ils sont venus pour t'accompagner dans ton dernier voyage... Ils sont présents pour entendre prononcer la louange de ton courage, l'abnégation totale de ton sacrifice. C'est au nom des rescapés de Breendonck que je viens parler. Emile Maufort est né à Fleurus le 9 janvier 1921. Il fit ses écoles à Charleroi et ses professeurs ont gardé de lui le souvenir d'un élève doux, studieux et foncièrement honnête. Dès qu'il fut en âge de travailler, il entra dans une usine de la région en qualité d'employé. A la déclaration de guerre, il entre à la police de Charleroi comme agent auxiliaire et le 1er mai 1941 il passe au corps des pompiers de la ville. Dès 1942,
Emile militait activement dans
Où nous conduit-on ?... Aucun ne le sait, mais lorsque après avoir traversé la capitale nous constatons que l'on emprunte l'autostrade qui conduit à Anvers, un nom sort de toutes les bouches et nous glace d'effroi. Ce nom... c'est Breendonck ! A l'arrivée, ce sont des S.S. qui nous frappent avec une sauvagerie, une brutalité inouïe, et pendant les longs mois que nous allons passer dans cet enfer, nous verrons des centaines de camarades tomber devant les poteaux d'exécution ou frappés à mort au travail. Nous verrons quasi chaque jour des prisonniers mourir d'épuisement, de privations, et nous verrons aussi, en une seule et même journée, jusqu'à onze malheureux compagnons enterrés vivants. Et de toutes ces horreurs que nous avons vues, de toutes ces tortures que nous avons subies, la faim n'était pas ce qu'il y avait de moins horrible à supporter. Nous étions affamés et plus d'un parmi nous a pleuré en travaillant lorsque, du haut d'une coupole, il voyait la longue file des mamans, des épouses, avançant sur la route de Willebroeck. Elles venaient ces mamans, la tienne, Emile, la nôtre ; elles venaient ces épouses, les bras chargés de victuailles que nous n'aurions jamais et nous le savions. On acceptait leurs colis, mais de ceux-ci on ne nous montrait que les emballages et leurs étiquettes qu'on faisait brûler devant nous. Ah ! comme nous aurions voulu leur crier de ne rien remettre, d'emporter ces bonnes choses, car nous pensions surtout aux privations sans nom que ceux que nous aimions avaient dû s'imposer, pour retenir sur leur ravitaillement les quantités nutritives qu'ils nous apportaient. La véridique histoire est là pour attester que le réalisme brutal des mots est encore bien au-dessous des brutales réalités dont elle est chargée de garder l'ignominieux et sanglant souvenir. Et toi aussi,
Emile, tu as prononcé, une heure
avant de mourir, un arrêt que l'histoire enregistrera. Tu avais communié,
tu avais entendu la messe, soixante minutes à peine te séparaient du
moment où, au cri de « Vive
Avant de faire cette touchante déclaration, tu avais écrit une lettre émouvante d'adieu à tes parents adorés, à ta sœurette (comme tu l'appelais), à ta tantine que tu chérissais beaucoup, à tes oncles aimés, à ta famille, à tes amis, et alors, libre enfin du monde, tu oublias ce que tu avais été, ton nom, tes services, tes regrets et tes désirs. et, avant même que tu nous eus dit adieu, il ne restait plus en ton âme que les vertus qu'elle avait acquises sur la terre en y passant. Oui, nous portons au-dedans de nous, sous une cicatrice saignante, le deuil profond de tous ceux qui, comme toi, sont tombés. Ah ! l'horrible guerre, et qui peut, mieux que
Et à côté de ces Boches il y avait les collaborateurs... L'ordre nouveau qu'ils préconisaient n'était pas la liberté, mais il en était l'antipode. Cet ordre nouveau préparait les peuples à la tyrannie, il les en rendait dignes ; il leur apprenait surtout à s'y résigner crainte de pire. Aujourd'hui,
Emile, ces criminels déclarent
n'avoir rien fait ou presque, mais le temps presse : les symptômes ont
surgi en foule à nos yeux. Il faudrait plaindre ceux qui croiraient à
une guérison apparente et trop prompte pour n'être pas superficielle,
ceux qui prendraient le silence de la défaite pour une conversion ;
ceux qui passeraient tout d'un coup de la terreur à une aveugle
confiance. Mais nous avons fait le serment de réaliser l'idéal de ceux
qui sont morts, et demain, quand se réunira
Quand notre ami Oscar, le papa
d'Emile, apprit que
son enfant pouvait avoir été enterré à Bruxelles, il s'y rendit. là,
au Tir National, il put rencontrer un témoin oculaire des exécutions,
dont voici le témoignage : « Lorsque les camions arrivaient avec leurs
transports de condamnés, je les voyais, et si cela peut vous être une
consolation, sachez que déjà, en descendant du camion, les prisonniers
chantaient Ainsi, au Tir National comme à
Breendonck, Huy,
Louvain, Beverloo, Marcinelle et partout où ils tombèrent, nos regrettés
camarades clamaient avec fierté leur amour du sol natal. « Vive
Dors en paix, Emile, tous les prisonniers politiques sont fermement décidés à ne permettre aucun déguisement du crime, à lui arracher tous ses masques. Ton nom entrera dans l'histoire de cette guerre, et à la veillée, jusque dans les foyers les plus éloignés, on prononcera ton nom avec émotion, avec respect. A Breendonck... tu m'avais demandé de voir ta maman, ton papa, ta sœurette, ta famille et de leur parler de toi. J'ai dit à ton brave père, à ta chère maman, combien ils devaient être fiers de t'avoir inculqué tant de vertus : Honnêteté, générosité, désir de servir, courage, devoir, sacrifice... Tes parents, ta sœurette, ta famille te pleurent chaque jour, mais qu'ils me permettent de leur dire que nous ressentons vivement leur douleur et qu'ils apprécient pour quelque chose l'amitié et l'intérêt que tous ceux de Breendonck prendront toujours aux parents de leur ancien et douloureux compagnon de. chaîne. Dors,
Emile, tes camarades de Breendonck vont
t'accompagner sur le chemin qui te conduira au repos, et là, au seuil
de ta dernière demeure, ils reviendront parfois se recueillir, car
jamais pour eux tu ne tomberas dans l'oubli. Adieu, Emile, brave petit,
et je termine par ces mots que tu nous répondrais si tu pouvais encore
parler : VIVE « Telle est la volonté du Führer ! Heil Hitler ! Feu ! » La mort a passé ! _ _ _ _ _ _ _ Nous avons voulu terminer par ce rappel d'un tableau sinistre qui, nous le sentons, ne pourra plus jamais s'effacer de notre mémoire. On voudrait la fin de la guerre pour vivre un peu pour les siens et pour soi, mais le repos ne. pourra venir qu'après l'exécution des tueurs et des traîtres. Ce reportage justifiera auprès des générations futures les représailles qui seront exercées contre ceux qui se sont rendus coupables du massacre de tant de nos camarades. _ _ _ _ _ _ _ Il nous est aussi une leçon finale de compréhension et de sympathie pour tous les autres prisonniers à qui la chance n'est pas venue sous la forme d'une lettre anonyme facilement réfutable. L’ « Affaire Daumeries » a eu son épilogue devant le Conseil de Guerre de Charleroi. M. Albert Robin nous donne le compte-rendu de la séance : Mercredi 29 novembre 1944. Une date qui marque dans les annales judiciaires de Charleroi avec I' « Affaire Daumeries ». Il fallait s'y attendre. C'est la foule, la très grande foule, venue de partout pour assister à ces débats sensationnels. Dès 6 heures du matin, des curieux faisaient déjà la file sur les trottoirs de l'Université du Travail, dont la vaste Salle des Conférences a été aménagée en prétoire pour le Conseil de Guerre. A 9 heures, plus une
place n'est à trouver dans cette nef du temple où
A l'extérieur, deux mille retardataires restent là. désabusés, devant les portes closes et un mur de gendarmes. 9 heures 15. Cette assistance-record se lève comme mue par un gigantesque ressort : c'est le Conseil de Guerre qui fait son entrée, le Président Féron en tête. Prennent place au siège, à ses côtés, le juge civil Moriamé, le major de gendarmerie Sauvage, le commandant Gueulette, le lieutenant Guyot. Au siège du ministère public, le substitut de l'auditeur militaire Stocq. Au banc de la défense, M. Bierlaire, désigné d'office. — Amenez l'accusé ! Une porte s'ouvre et, tenu en laisse par un gendarme, apparaît un vieillard un peu voûté, claudiquant quelque peu. C'est Daumeries. Son état-civil révèle qu'il a quarante-cinq ans. Son état tout court en accuse soixante. La crime et le remords ne sont pas eau de Jouvence.— Assis ! assis ! crie-t-on dans la salle, qui s'est presque toute dressée pour mieux voir le phénomène. Le Président FERON,
qui a pris tout de suite la température du public, l'invite à
s'abstenir de toute manifestation et procède, sans plus attendre, à
l'interrogatoire d'identité de l'accusé, qui se cramponne à la barre
: Fernand Daumeries, 45 ans, boucher, domicilié rue de
_ _ _ _ _ _ D'une voix ferme et décidée, l'Auditeur STOCQ lit l'acte d'accusation. Un document volontairement sec et dépouillé de toute vaine littérature, dans lequel sont consignés en un tragique raccourci, toutes les turpitudes, tous les mouchardages criminels, toutes les abjectes lâchetés de Daumeries. Dans la salle on entendrait voler une mouche. Implacablement, l'auditeur fait tourner ce kaléidoscope d'horreur qui projette rapidement sur l'écran des consciences indignées des visions d'enfer, des images de martyrs : le Russe « Alexis », Désiré Mouffe, Roger Poquette, Fernand Huet, dont la mort ou la mutilation sont dues aux lâches dénonciations de ce pourvoyeur de supplices. La préméditation , L'auditeur la souligne en citant dans toute sa crudité le « principe de base » du Zug-Fùhrer : « Nous sommes quarante-huit dans cette chambre ; si je dois en faire crever quarante-sept pour sauver ma peau, je le ferai ! » Cet acte d'accusation a un mot de la fin. Il est fourni par une déclaration de Daumeries lui-même faite au lendemain de sa mise en liberté, le 23 avril 1943 : « Je suis heureux d'avoir été à Breendonck ; ce séjour m'a permis de me guérir d'une maladie d'estomac » !... Une cure merveilleuse. Vittel est dépassée. Un mouvement d'horreur court à travers l'assistance. L'œil torve, la tête penchée, les deux mains agrippées à la barre, l'accusé a écouté, sans même frémir, cette brève évocation de ses crimes. Tout au plus son chef pivotait sur ses épaules en des signes de dénégation. M. Victor TRIDO est aussitôt appelé à la barre. D'une voix ferme, qui porte loin, ce premier témoin brosse des descriptions réalistes de la vie imposée par les S.S. à la malheureuse chiourme de Breendonck. Les horreurs succèdent aux horreurs, comme à une revue du Grand-Guignol. Daumeries l'écoute, les bras croisés, comme le ferait un honnête homme indigné. Quelquefois même, une esquisse de sourire naît sous sa petite moustache poivre et sel. Puis Trido, tout à coup : — Je vous l'avais bien dit, Daumeries, que je vous poursuivrais jusqu'au poteau ! |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Daumeries
accuse le coup et détourne les yeux du regard de son accusateur, qui le
vrille. —
Le Conseil de Guerre, déclare le
Président Féron,
rend hommage à toutes les victimes de
Breendonck. Il salue leur patriotisme et s'incline devant leur mémoire ou devant leurs
souffrances. M. Trido a fini. Il s'écarte. Mais pour faire place à d'autres témoins, d'autres victimes, d'autres accusateurs qui viennent successivement rapporter, sans passion apparente, les sévices subis au terrible bagne, les scènes cruellement vécues, les sinistres propos tenus par l'accusé, ses odieux mouchardages pour s'attirer les bonnes grâces des S.S. cruels et surtout sauvegarder sa peau. Dix-huit témoins. Groupe émouvant. Phalange terrible dont les témoignages successifs faisaient passer un frisson dans le dos de chacun du bon millier d'auditeurs présents. Un des témoins nous apporte même de l'inédit. - C'est
ce brigand-là, déclare le
sexagénaire Oscar
Jourdain, de Jumet, qui me frappait tous les jours, sans Daumeries reçoit l'avalanche sans sourciller. —
Monsieur le Président, continue
Jourdain, je dois vous
avouer que c'est par erreur que ce « brigand » se L'auditoire est visiblement ému. Le dernier témoin entendu, le Président demande : - Daumeries, avez-vous
quelque chose à dire ? Contestez-vous tous ces faits ? Le Président est donc bien obligé de reprendre l'un après l'autre chacun des faits consignés dans l'acte d'accusation. Sans autorité excessive, mais aussi sans faiblesse, le Président tourne et retourne l'accusé sur le gril. Daumeries répond, en demi-teintes, comme s'il parlait à un monsieur avec lequel il n'est pas d'accord. L'assistance tend l'oreille. Elle entend mal. Le moindre bruit est réprimé par un « chut ! » poussé par cent bouches. Daumeries a nié tout en bloc. Il nie aussi tout dans le détail, ou se dérobe par un faux-fuyant aux estocades du Président. Tout de même, il reconnaît avoir poussé un Heil d'honneur pour l'oberleutnant qui avait offert une cigarette à chacun des quatre lauréats d'un match de remplissage de benne. - J'ai voulu le remercier pour une faveur qui ne s'était jamais produite. LE PRESIDENT. - Et vous n'avez jamais manifesté votre joie quand les S.S. promenaient des cadavres dans le camp ? - Non. J'ai prié pour eux ! LE PRESIDENT. - ...avec un gourdin en main ! M. Féron évoque la fin de Poquette martyrisé à mort par les S.S. à la suite d'une dénonciation de Daumeries. LE PRESIDENT. - Ce n'était pas une raison de lui faire donner le « sac ». Mais Daumeries nie. C'est plus commode. Le Président lui demande ce qu'il sait de la mort du pauvre Mouffe, succombant, lui aussi, sous le poids du « sac » farci de pavés ? Daumeries ne se souvient plus de rien non plus. LE PRESIDENT. — Vous aboyiez comme un mauvais chien pour attirer l'attention des S.S. sur vos camarades ! — J'ai reçu plus de coups qu'eux, répond Daumeries, à l'indignation de l'assistance. Le Président, faisant allusion aux coups qui firent perdre l'usage d'un œil à Huet : — Vous n'êtes pas éborgné, vous ! Mais à l'entendre, l'accusé n'a jamais dénoncé Huet. Il n'a d'ailleurs dénoncé personne. — J'ai essayé à trois reprises de ne plus être Zug-Führer ! Mais TRIDO, de son coin, s'écrie : —
Mais alors, il aurait dû travailler ! M. Trido, du tac au tac, lève encore un coin du voile de la géhenne : — Des aveugles travaillaient à Breendonck. Des manchots travaillaient. Un éventré même travaillait. Daumeries se cantonne dans son système de tout nier, même l'évidence. Il n'a jamais menacé ni Poquette, ni Mouffe d'avoir le sac anytos Quant au Russe « Alexis », que le boucher frappa d'un coup de bâton alors qu'il était en train de mourir à la suite de cruels sévices, il l'a simplement poussé. Un tout petit peu. Il ne dit pas « du petit doigt ». Mais c'est tout comme. — J'ai été désolé quand j'ai su qu'il était mort ! Puis, se redressant, il accuse Trido de lui avoir volé sa part de beurre. Victor TRIDO. — Le contraire est vrai. C'est vous, Daumeries, qui voliez les maigres rations de beurre qui nous étaient destinées. L'accusé a vidé son sac. Plus exactement, il en a laissé tomber ce qu'il a bien voulu, c'est-à-dire pas grand'chose, sinon rien du tout. L'interrogatoire est terminé. Le Président FERON s'incline devant le courage avec lequel les témoins ont supporté ce long et cruel martyre, et rend un hommage ému aux victimes qui ont payé de leur vie leur édifiante obstination à vouloir rester des Belges fidèles. _ _ _ _ _ _ La parole est maintenant à la partie civile. Mm DESSENT représente la veuve de Désiré Mouffe et sa fille Alice. En une plaidoirie sobre mais dure, il dépiaute « cette bête puante et malfaisante qui déshonore l'humanité ». Sans vouloir accabler davantage l'accusé dont les traits indiquent suffisamment que les coups portent, l'honorable avocat ramasse les différents témoignages pour les jeter à la tête de Daumeries. Celui-ci se cramponne à la barre comme un naufragé. — Sans lui, Roger Poquette et Désiré Mouffe ne seraient pas morts... Nous sommes ici quarante-huit, mais s'il faut en faire crever quarante-sept pour sauver ma peau, je le ferai... Les citations accablantes tombent dru sur le crâne blanchi et a demi-dénudé du chien-courant des tortionnaires. Mm Dessent, au milieu de l'émotion générale, lit enfin la page du Moustique où sont rapportés le supplice et la mort du pauvre Mouffe. A son banc, Mme Mouffe pleure, pleure... L'éloquent avocat dépose des conclusions par lesquelles il réclame à titre de dédommagement 250.000 francs pour la veuve, 50.000 francs pour l'orpheline. _ _ _ _ _ _ Au débotté, M' ANDRE, rescapé lui aussi de Breendonck, se constitue partie civile pour l'agent de police Fernand Huet. Sa plaidoirie sera brève, mais non moins convaincante. - J'ai connu la vie lamentable et cruelle de ce camp de la mort, dit-il ; je ne connais pas le dossier, mais je connais Breendonck... Cela suffit au jeune avocat pour bâtir sa plaidoirie. Les faits parlent d'eux-mêmes. Si Huet a perdu un œil par la faute de Daumeries, c'est à lui de réparer en payant à sa victime 300.000 francs à titre de dommages-intérêts. _ _ _ _ _ _ - La parole est à M. l'Auditeur militaire ! Le substitut STOCQ, d'une voix qui se fait d'abord lyrique, évoque dans son exorde, l'Enfer du Dante et rappelle la fameuse citation : « 0 vous qui entrez ici, laissez toute espérance ! », qui pouvait être inscrite sur le portique de l'enfer de Breendonck, « dont Daumeries était un des démons ». En des tableaux saisissants, l'organe de la conscience publique dépeint la vie de la malheureuse chiourme et en vient ainsi tout naturellement à parler de Daumeries, « ce chien de Boche qui entrevoit maintenant le poteau, ce chien qui tremble parce qu'il a peur ». Se plaçant sur le terrain juridique, dans les arcanes duquel il se meut avec aisance, l'auditeur démontre que les faits tombent sous l'application de l'arrêté de Londres du 17 décembre 1942, qui sanctionne de la peine de mort les dénonciations criminelles de l'accusé. Cette première conclusion est émise avec une telle éloquente conviction que le public tout entier la ratifie par une salve unanime d'applaudissements. Cette manifestation, toute spontanée, est aussitôt réprimée par le Président, qui menace de faire évacuer la salle en cas de récidive. L'auditeur Stocq continue son exécution d'un ton sec, tranchant comme un couperet de guillotine, ne contestant pas que Daumeries fut d'abord un patriote dont les relations avec le feldgendarme Karl pourraient tout de même paraître suspectes, mais dont la conduite au bagne n'en fut pas moins odieuse. « Daumeries paraît maintenant aplati comme un chien battu, alors qu'à Breendonck il prenait un malin plaisir à mordre les autres ! »M. Stocq, très en forme, cite une fois de plus la trop fameuse déclaration de l'ex-Zug-Führer : « Nous sommes ici quarante-huit ; s'il faut en faire crever quarante-sept... » Sa peau. « II n'y avait que ça qui comptait pour lui alors. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte pour moi ! » Ces mots, lancés avec force, déclenchent un nouveau tonnerre d'applaudissements dans la salle véritablement rivée aux lèvres de l'accusateur public Une fois c'est assez ; deux, c'est trop. Le Président ordonne l'évacuation du prétoire, ce qui ne se fait d'ailleurs pas sans peine. Après vingt minutes de suspension d'audience, l'auditeur militaire, reprenant devant un quart de salle le fil de son réquisitoire, réclame, avec Mouffe et Poquette, vengeance et justice, et adjure les cinq membres du Conseil de Guerre de décréter la peine de mort contre Daumeries, « contre ce damné ». _ _ _ _ _ _ Après une courte suspension d'audience qui permet à la foule expulsée de reprendre place dans le prétoire, l'avocat de la défense a la parole. La tâche de Mtre BIEELAIRE est rude. L'honorable avocat s'en rend compte lui-même qui présente une plaidoirie digne, habile, éloquente. Tout de suite se dessine sa thèse. La psychose de la terreur et de la faim peut expliquer bien des choses. C'est le climat lui-même du bagne qui a changé Daumeries et en a fait une épave. Mtre Bierlaire a l'élégance de ne pas rencontrer la matérialité des faits reprochés à son « client », ni encore de se mesurer avec les parties civiles. Tout au plus demande-t-il si on peut reprocher à Daumeries le fait de n'avoir pas été un héros. Placé entre l'enclume et le marteau, en raison de ses fonctions de Zug-Führer, l'héroïsme, qu'on lui reproche de n'avoir pas eu, aurait dépassé les limites des possibilités humaines. L'éloquent défenseur évoque le patriotisme antérieur de Daumeries, qui l'a conduit à Breendonck. « Et s'il n'avait été dans cette géhenne, il ne serait pas à cette barre aujourd'hui. » Argument assez spécieux, qui semble faire fi de la vertu de persévérance. Pour essayer de sauver la tête de l'accusé, Mtre Bierlaire se lance maintenant dans de longues considérations juridiques pour prétendre — plutôt timidement — que les faits reprochés à l'accusé sont justiciables de l'arrêté du 8 avril 1917, prévoyant un maximum de 20 ans de travaux forcés, et non de l'arrêté de Londres du 17 décembre 1942 décrétant la peine capitale. L'avocat va terminer. Lui aussi rend un vibrant hommage d'admiration aux innocentes victimes de la répression nazie. Puis, avant de se rasseoir, il déclare confier Daumeries au calme, à la sérénité, à la justice des membres du Conseil de Guerre. Le Président s'adressant à Daumeries :- N'avez-vous plus rien
à dire pour votre défense ? - Non. Les débats sont clos. Il est 1 heure 40. Le Conseil de Guerre se retire pour délibérer. La foule attend fiévreuse, tout en commentant cette audience sensationnelle. Pendant ce temps, nous allons voir Daumeries dans la petite pièce où il est planté face au mur, comme un enfant qui n'a pas été sage. - Eh bien ! Daumeries, qu'espérez-vous ? - A la grâce de Dieu !... Mon avocat a si bien plaidé ! Pour une fois, cet homme n'a pas menti. Mais sa résignation ne paraît guère cadrer avec l'angoisse que nous lisons dans son regard. A 2 h. 30, le Conseil de Guerre reparaît. Un silence de mort succède au brouhaha. La foule est anxieuse de savoir. Quand, à l'issue d'un jugement longuement motivé, lu par le Président Féron, elle entend : « ...est condamné à la peine de mort. L'exécution aura lieu à Charleroi... » elle exulte en de nouveaux applaudissements qu'elle arrête d'ailleurs d'elle-même. Mme Mouffe obtient les 300.000 francs qu'elle réclamait pour elle-même et sa fille. Huet, 200.000 francs. L'audience est levée. Daumeries, encore plus voûté, disparaît avec son gendarme... Le souffle vivifiant de
FIN 16 septembre 1944 ------------------------- Maison d'Edition J. DUPUIS, Fils et Cie - Marcinelle Charleroi. |
|||||||||||||||||
|
(1)
Vite ! Vite! (2) J'aurais tant voulu embrasser ma femme et mon enfant avant de mourir. (3) Sortez pour le travail. (4) Grand fainéant, le jour où je sortirai d'ici, à peine auras-tu mis les pieds sur la rue, que je te casserai ta gu... (5) Demain, Poquette. quand tu arriveras sur le travail, on mettra le bac. (6) Quelle nouvelle. Désiré, vous sentez-vous mieux ? (7) Pensez-vous que nous les verrons ? (8) Tristesse d'Olympio (9) Mes yeux s'en vont, je vais mourir ! (10) Frère, je suis tout bleu de faim. (11) Léonide (son nom me fut communiqué en septembre 1944, alors que mes manuscrits étaient en possession de l'éditeur.) (12) Garde à vous. (Still stehen). (13) Du courage cinq minutes, papa, et après on s'occupera de vous. (14) Attention, tu sais (néerlandais). (15) Weiss, Leleux a froid. (16) Tape-le dans l'eau, il se réchauffera. (17) Mais comme « smokeler » ou mercanti et avant que donck ne soit réservé aux détenus politiques. (18) Musin fut transféré en Allemagne en juin 1943. Il y est mort en février 1944. (19) Joseph, ils m'ont eu. (20) Banni par les 30 tyrans, Anytos devint en (21) Terme wallon qui veut dire « Bouclé ». (22) Vous irez embrasser mon enfant, hein, Victor, et donner des nouvelles a ma femme. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||